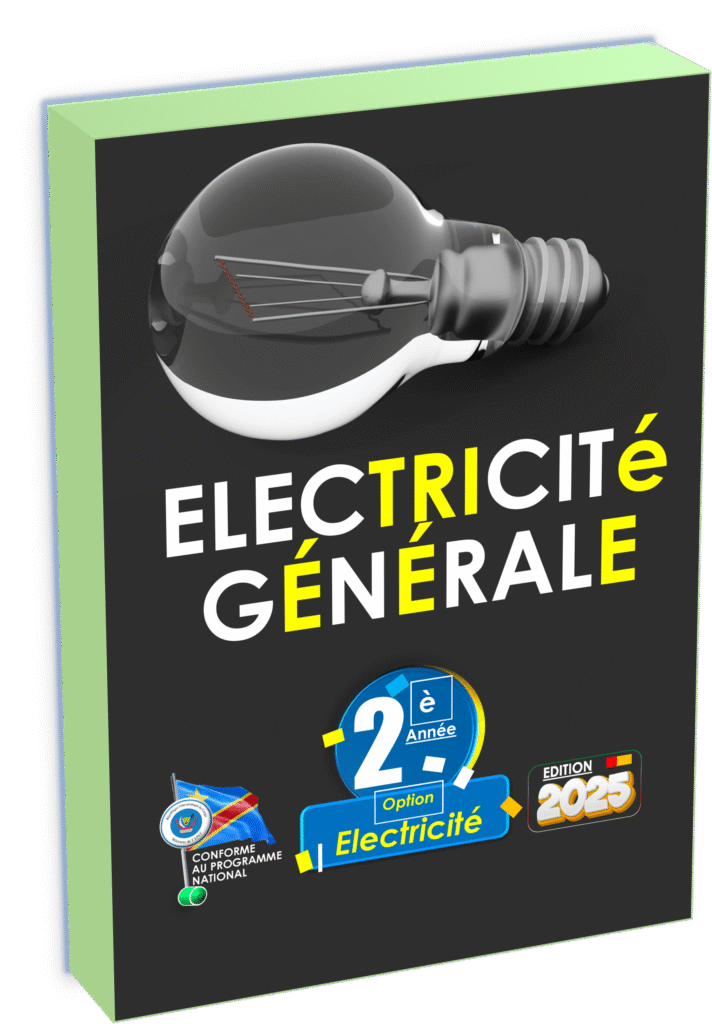
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE, 2ÈME ANNÉE, OPTION ÉLECTRICITÉ
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
PRÉLIMINAIRES
1. Objectifs Généraux du Cours 🎯
Ce cours de deuxième année a pour objectif de faire passer l’élève d’une compréhension qualitative des phénomènes électriques à une maîtrise quantitative et analytique des circuits en courant continu et des systèmes électromagnétiques. L’ambition est de doter le futur technicien d’outils de calcul puissants, lui permettant de résoudre des réseaux électriques complexes et de comprendre en profondeur les principes qui régissent le fonctionnement des machines électriques et des composants de stockage d’énergie. Au terme du module, l’apprenant sera capable d’appliquer les lois de Kirchhoff, d’analyser le comportement transitoire des circuits, et de calculer un circuit magnétique, préparant ainsi le terrain pour l’étude du courant alternatif et des machines tournantes.
2. Approche Pédagogique Recommandée 🧑🏫
L’approche pédagogique doit consolider la démarche expérimentale de la première année tout en renforçant la modélisation mathématique. Chaque nouveau théorème ou loi (Kirchhoff, Thévenin) sera d’abord illustré par un montage simple en laboratoire pour en vérifier la validité, avant de passer à la résolution d’exercices théoriques de complexité croissante. L’utilisation d’analogies, comme celle du circuit magnétique et du circuit électrique, sera un outil didactique puissant. L’enseignant s’attachera à démontrer l’utilité de ces outils analytiques dans des contextes congolais concrets, par exemple en utilisant les lois de Kirchhoff pour analyser la répartition des courants dans un mini-réseau de distribution alimenté par des panneaux solaires à Mbuji-Mayi, ou en étudiant le circuit magnétique d’un transformateur de la SNEL à Likasi.
3. Prérequis du Cours 📚
Une maîtrise complète du programme d’électricité générale de première année est impérative, notamment la loi d’Ohm, les associations de résistances et les bases du magnétisme. Des compétences solides en algèbre, en particulier la résolution de systèmes d’équations linéaires à plusieurs inconnues, sont indispensables pour aborder l’analyse des réseaux par les lois de Kirchhoff.
PARTIE 1 : ANALYSE AVANCÉE DES CIRCUITS EN COURANT CONTINU
Cette partie équipe l’élève avec l’arsenal complet des lois et théorèmes permettant de « résoudre » n’importe quel circuit en courant continu, c’est-à-dire de calculer la tension aux bornes de chaque composant et le courant qui le traverse. C’est le passage de la simple observation à l’ingénierie des circuits.
Chapitre 1 : Généralisation de la Loi d’Ohm
1.1. Circuit avec Générateur et Résistance Pure
La loi d’Ohm est étendue pour décrire un circuit complet, en tenant compte de la résistance interne du générateur. La notion de chute de tension interne est introduite, expliquant pourquoi la tension aux bornes d’une pile diminue lorsqu’elle débite du courant.
1.2. Le Générateur Électrique en Convention Générateur
Le modèle électrique du générateur réel est formalisé, incluant sa force électromotrice (f.é.m.) et sa résistance interne. L’équation caractéristique est établie comme la loi d’Ohm aux bornes d’un générateur.
1.3. Le Récepteur Actif en Convention Récepteur
Le concept de récepteur actif (un composant qui possède sa propre force contre-électromotrice, f.c.é.m.) est introduit, l’exemple type étant un moteur ou un électrolyseur. L’équation à ses bornes, , est développée.
1.4. Loi de Pouillet pour un Circuit Complet
La loi de Pouillet est généralisée pour calculer l’intensité dans une boucle simple contenant des générateurs et des récepteurs : . Cette formule synthétise l’analyse d’un circuit série complexe.
Chapitre 2 : Les Lois de Kirchhoff pour l’Analyse des Réseaux
2.1. Définitions : Nœud, Branche, Maille
Le vocabulaire topologique des circuits est défini de manière rigoureuse. Un nœud est un point de connexion de plus de deux conducteurs, une branche est un tronçon de circuit entre deux nœuds, et une maille est une boucle fermée dans le réseau.
2.2. Première Loi de Kirchhoff (Loi des Nœuds)
La loi de la conservation de la charge électrique en un nœud est énoncée : la somme des courants qui entrent dans un nœud est égale à la somme des courants qui en sortent (). Cette loi est fondamentale pour analyser les circuits parallèles.
2.3. Deuxième Loi de Kirchhoff (Loi des Mailles)
La loi de l’additivité des tensions dans une boucle fermée est établie : la somme algébrique des tensions le long d’une maille est nulle (). L’application correcte de cette loi requiert une méthode rigoureuse pour flécher les tensions et parcourir la maille.
2.4. Méthodologie d’Application des Lois de Kirchhoff
Une procédure systématique en plusieurs étapes est enseignée pour résoudre n’importe quel réseau : identifier les nœuds et les branches, choisir les courants d’inconnue, appliquer la loi des nœuds et la loi des mailles pour obtenir un système d’équations, et enfin résoudre ce système mathématiquement.
Chapitre 3 : Mesures Électriques Avancées en Continu
3.1. Précision et Classes des Appareils de Mesure
La notion de classe de précision d’un voltmètre ou d’un ampèremètre est introduite, permettant de calculer l’incertitude absolue d’une mesure. L’importance de choisir un appareil adapté à la précision requise est soulignée.
3.2. Mesure de Résistance par le Pont de Wheatstone
Le principe du pont de Wheatstone est détaillé comme une méthode de mesure de résistance par « annulation » (détection d’un courant nul dans le galvanomètre). Sa grande précision en fait un instrument de choix en laboratoire pour l’étalonnage.
3.3. Le Potentiomètre : Mesure de f.é.m.
Le montage potentiométrique est présenté comme la méthode de référence pour mesurer une force électromotrice sans faire débiter de courant à la source, annulant ainsi l’erreur due à la résistance interne.
3.4. Shunts et Résistances Additionnelles
Les techniques pour étendre la gamme de mesure d’un appareil sont expliquées. Le shunt (résistance en parallèle) permet à un ampèremètre de mesurer de plus forts courants, tandis que la résistance additionnelle (en série) permet à un voltmètre de mesurer de plus hautes tensions.
PARTIE 2 : LE CONDENSATEUR ET LES RÉGIMES TRANSITOIRES
Cette section introduit un nouveau composant fondamental, le condensateur, capable de stocker de l’énergie électrique. Son étude ouvre la porte à l’analyse des régimes transitoires, c’est-à-dire le comportement des circuits pendant les quelques instants qui suivent un changement brutal comme la fermeture d’un interrupteur.
Chapitre 4 : Le Condensateur et la Capacité Électrique
4.1. Principe et Constitution d’un Condensateur
Un condensateur est décrit comme un composant formé de deux armatures conductrices séparées par un diélectrique (isolant). Sa fonction principale est d’emmagasiner des charges électriques opposées sur ses armatures.
4.2. Capacité et Énergie emmagasinée
La capacité (C), mesurée en Farads (F), est définie comme le rapport entre la charge stockée (Q) et la tension (U) aux bornes du condensateur (). La formule de l’énergie stockée dans le condensateur () est établie.
4.3. Associations de Condensateurs
Les formules pour calculer la capacité équivalente d’un groupement de condensateurs sont développées. Pour une association en parallèle, les capacités s’ajoutent (), tandis qu’en série, ce sont leurs inverses qui s’ajoutent ().
4.4. Différents Types de Condensateurs
Une vue d’ensemble des technologies de condensateurs est présentée en fonction de leur diélectrique : céramique, film plastique, électrolytique (polarisé), tantale. Leurs domaines d’application respectifs (filtrage, temporisation) sont discutés.
Chapitre 5 : Le Circuit RC en Régime Transitoire
5.1. La Charge d’un Condensateur à travers une Résistance
L’analyse du circuit série RC soumis à un échelon de tension est effectuée. Il est montré que la tension aux bornes du condensateur et le courant dans le circuit suivent des lois exponentielles et ne s’établissent pas instantanément.
5.2. La Constante de Temps (Tau)
La constante de temps, égale au produit , est introduite comme la grandeur qui caractérise la rapidité de la charge ou de la décharge. Au bout d’un temps , le condensateur atteint 63% de sa charge finale.
5.3. Équations de la Charge et de la Décharge
Les équations mathématiques décrivant l’évolution de la tension et du courant pendant la charge et la décharge sont établies et leurs courbes représentatives sont tracées.
5.4. Applications des Circuits RC
Les applications pratiques des circuits RC sont explorées, notamment dans les circuits de temporisation (minuteries), les filtres de base, et les circuits de lissage d’alimentation, essentiels dans tout appareil électronique, comme ceux réparés quotidiennement à Kinshasa.
PARTIE 3 : ÉLECTROMAGNÉTISME ET CIRCUITS MAGNÉTIQUES
Cette partie approfondit l’étude du magnétisme en introduisant des outils d’analyse quantitative. Le concept de circuit magnétique est développé par analogie avec le circuit électrique, une étape indispensable pour comprendre la conception des transformateurs, moteurs et électro-aimants.
Chapitre 6 : Le Champ Magnétique et ses Grandeurs
6.1. Le Vecteur Induction Magnétique
L’induction magnétique (en Teslas, T) est définie comme le vecteur qui décrit complètement le champ magnétique en un point. Ses caractéristiques (direction, sens, module) sont précisées. Le flux magnétique est redéfini rigoureusement comme le flux du vecteur à travers une surface.
6.2. Le Vecteur Excitation Magnétique
L’excitation magnétique (en Ampères par mètre, A/m) est introduite comme la grandeur qui représente la « cause » du champ magnétique, liée aux courants. Dans le vide, et sont simplement proportionnels ().
6.3. Perméabilité et Aimantation de la Matière
Dans la matière, la relation devient , où est la perméabilité magnétique du matériau. Les matériaux sont classifiés en diamagnétiques, paramagnétiques et, surtout, ferromagnétiques (qui canalisent et amplifient fortement le champ magnétique).
6.4. Le Théorème d’Ampère
Le théorème d’Ampère est présenté comme l’équivalent de la loi des mailles pour le magnétisme. Il relie la circulation du vecteur le long d’une boucle fermée à la somme des courants qui la traversent, permettant de calculer le champ dans des configurations simples (solénoïde).
Chapitre 7 : Le Circuit Magnétique
7.1. Analogie entre Circuit Électrique et Circuit Magnétique
Une analogie formelle est établie entre les deux types de circuits : la force magnétomotrice (f.m.m.) est l’analogue de la f.é.m., le flux magnétique est l’analogue du courant, et la réluctance est l’analogue de la résistance.
7.2. La Force Magnétomotrice (f.m.m.)
La f.m.m., produite par une bobine de N spires parcourue par un courant I, est définie par . C’est elle qui « pousse » le flux magnétique à travers le circuit.
7.3. La Réluctance Magnétique
La réluctance () d’un matériau est définie comme son opposition au passage du flux magnétique (). Elle dépend de la géométrie et de la perméabilité du matériau.
7.4. La Loi d’Hopkinson
La loi d’Hopkinson, ou « loi d’Ohm des circuits magnétiques », est énoncée : . Elle permet d’analyser des circuits magnétiques simples, comme le noyau d’un transformateur, en utilisant des méthodes similaires à celles des circuits électriques.
Chapitre 8 : Phénomènes d’Aimantation et Pertes
8.1. La Courbe de Première Aimantation
La relation non-linéaire entre B et H pour un matériau ferromagnétique est étudiée. La courbe de première aimantation montre une saturation : au-delà d’une certaine excitation H, l’induction B n’augmente presque plus.
8.2. Le Cycle d’Hystérésis
Le phénomène d’hystérésis est décrit : lorsqu’on fait décroître H, le matériau « mémorise » une partie de son aimantation (rémanence). Pour le désaimanter, il faut appliquer un champ coercitif. Le parcours complet décrit une boucle appelée cycle d’hystérésis.
8.3. Les Pertes par Hystérésis
L’énergie dissipée sous forme de chaleur à chaque cycle d’hystérésis est démontrée comme étant proportionnelle à l’aire de la boucle. Le choix de matériaux à cycle étroit (fer doux) pour les transformateurs et à cycle large (aciers durs) pour les aimants permanents est expliqué.
8.4. Les Courants de Foucault
La création de courants induits (dits de Foucault) au sein même d’une masse métallique soumise à un flux variable est expliquée. Ces courants provoquent des pertes par effet Joule et sont réduits en utilisant des tôles feuilletées, comme dans les machines tournantes des centrales hydroélectriques de la région des Grands Lacs.
PARTIE 4 : INDUCTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE ET APPLICATIONS
Cette dernière partie se concentre sur le phénomène de l’induction, en particulier l’auto-induction, et son composant associé, la bobine d’inductance. L’étude du comportement des circuits RL complète l’analyse des régimes transitoires et prépare à la compréhension des circuits en alternatif.
Chapitre 9 : L’Auto-Induction et l’Inductance
9.1. Le Phénomène d’Auto-Induction
L’auto-induction est définie comme le phénomène par lequel un circuit s’oppose à la variation de son propre courant. La variation du courant crée une variation du flux propre, qui à son tour induit une f.é.m. qui s’oppose à la variation initiale du courant (loi de Lenz).
9.2. L’Inductance Propre (L)
L’inductance (L), mesurée en Henrys (H), est définie comme le coefficient de proportionnalité entre le flux propre et le courant qui le crée (). C’est la caractéristique principale d’un enroulement ou d’une bobine.
9.3. La f.é.m. d’Auto-Induction
La tension qui apparaît aux bornes d’une bobine soumise à une variation de courant est établie : . Cette tension est nulle en régime continu (di/dt=0), mais peut devenir très grande lors de coupures de courant brutales.
9.4. Énergie Magnétique Stockée dans une Bobine
Une bobine parcourue par un courant stocke de l’énergie dans son champ magnétique. La formule de cette énergie () est développée, complétant le trio des composants passifs de base (résistance qui dissipe l’énergie, condensateur et bobine qui la stockent).
Chapitre 10 : Le Circuit RL en Régime Transitoire
10.1. Établissement du Courant dans une Bobine
L’analyse du circuit série RL soumis à un échelon de tension montre que le courant ne s’établit pas instantanément mais suit une loi de croissance exponentielle, « freiné » par l’effet de l’auto-induction.
10.2. La Constante de Temps
La constante de temps du circuit RL, , est introduite pour caractériser la rapidité d’établissement du courant. Après un temps , le courant atteint 63% de sa valeur finale.
10.3. La Rupture du Courant et la Surtension
Le phénomène de la rupture du courant dans un circuit inductif est analysé. La variation rapide du courant crée une f.é.m. d’auto-induction très élevée, expliquant l’arc électrique qui se forme à l’ouverture d’un interrupteur et la nécessité d’installer des circuits de protection sur les relais et contacteurs.
10.4. Applications des Circuits RL
Les applications des bobines et des circuits RL sont présentées : lissage de courants, création de champs magnétiques intenses (électro-aimants), et leur rôle fondamental dans les ballasts des anciens tubes fluorescents ou comme éléments de filtrage dans les alimentations à découpage.
ANNEXES
Les annexes fournissent des outils de référence pour l’analyse de circuits. Elles incluent un formulaire complet des lois de l’électricité en courant continu et de l’électromagnétisme, des abaques pour déterminer la constante de temps des circuits RC et RL, et des exemples de courbes d’aimantation pour différents matériaux ferromagnétiques. Un glossaire détaillé des termes techniques est également fourni.