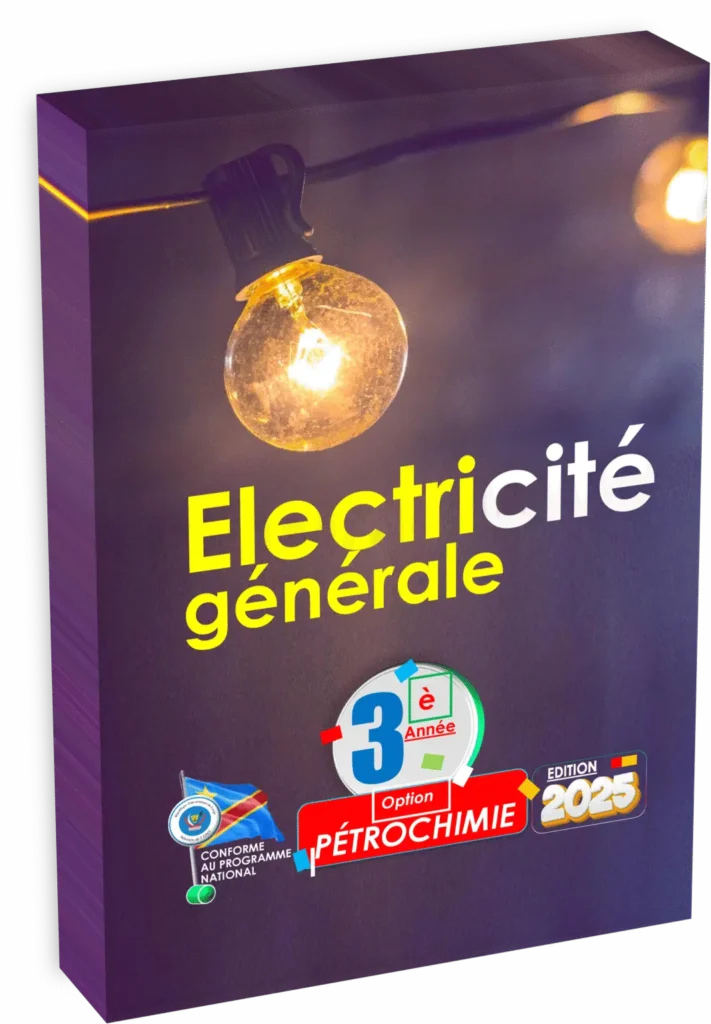
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE, 3ÈME ANNÉE / OPTION : ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
Préliminaires
1. Finalités de la formation
La formation en électricité générale de troisième année a pour finalité de faire passer l’élève de l’analyse des circuits à la compréhension des convertisseurs d’énergie électromécaniques et électromagnétiques. L’objectif est de le rendre capable d’analyser le fonctionnement, de modéliser le comportement et de comprendre les applications des machines électriques tournantes et des transformateurs, qui constituent l’épine dorsale de toute la chaîne de l’énergie électrique, de la production à l’utilisation finale.
2. Compétences visées
À l’issue de cette année terminale, l’élève devra être capable d’expliquer le principe de fonctionnement d’un transformateur, d’un moteur asynchrone et d’un alternateur. Il saura interpréter une plaque signalétique, réaliser les essais à vide et en court-circuit pour déterminer les éléments du modèle équivalent d’une machine, et analyser les bilans de puissance pour en calculer le rendement. Enfin, il pourra choisir une machine pour une application donnée et décrire les principaux modes de démarrage et de protection.
3. Approche Pédagogique
L’enseignement est centré sur la machine électrique comme système physique. Chaque machine est abordée selon une démarche systématique : étude de sa constitution, établissement de son modèle mathématique, validation expérimentale du modèle par des essais en laboratoire, et analyse de ses caractéristiques de fonctionnement en charge. Des exemples concrets, tels que l’étude des transformateurs du réseau de la SNEL ou des moteurs asynchrones utilisés par les industries de Kinshasa (Bralima, Utexafrica), ancrent la théorie dans des applications industrielles réelles.
4. Sécurité Électrique Appliquée aux Machines
Un volet essentiel du cours est dédié à la sécurité lors des interventions sur les machines électriques. L’élève apprendra les procédures de consignation spécifiques aux machines tournantes, les risques liés aux champs magnétiques intenses, aux tensions élevées et aux forts courants de démarrage. La mise à la terre des carcasses, l’utilisation des équipements de protection individuelle et les interventions hors tension sont des règles impératives qui seront rigoureusement appliquées.
Partie I : Électromagnétisme Appliqué et Transformateurs Statiques ⚙️
Cette partie établit les fondements de l’électrotechnique en étudiant les circuits magnétiques, qui sont le siège des phénomènes de conversion d’énergie dans toutes les machines. Elle applique ensuite ces principes à l’étude de la machine électrique la plus simple et la plus répandue : le transformateur. La maîtrise de son fonctionnement est un prérequis indispensable avant d’aborder les machines tournantes.
Chapitre 1 : Circuits Magnétiques et Matériaux Ferromagnétiques
Ce chapitre fournit les outils pour analyser le comportement du flux magnétique dans les machines.
1.1. Grandeurs et Lois Fondamentales du Magnétisme
Les grandeurs fondamentales (champ H, induction B, flux Φ) et les lois de l’électromagnétisme (théorème d’Ampère, loi de Faraday) sont révisées et appliquées à des configurations industrielles.
1.2. Le Circuit Magnétique Parfait
L’analogie entre circuit électrique et circuit magnétique sera établie. L’élève apprendra à utiliser la loi d’Hopkinson (analogue à la loi d’Ohm) et à calculer la réluctance pour analyser des circuits magnétiques simples.
1.3. Les Matériaux Ferromagnétiques
Le comportement non linéaire des matériaux ferromagnétiques sera étudié à travers la courbe de première aimantation et le cycle d’hystérésis. La notion de saturation du circuit magnétique sera mise en évidence.
1.4. Les Pertes dans les Circuits Magnétiques
L’élève apprendra à quantifier les deux types de pertes dans le fer : les pertes par hystérésis (dues au cycle B-H) et les pertes par courants de Foucault. La nécessité d’utiliser des tôles feuilletées pour réduire ces dernières sera expliquée.
Chapitre 2 : Le Transformateur Monophasé
Ce chapitre est consacré à l’étude détaillée du convertisseur électromagnétique statique.
2.1. Principe, Constitution et Symbole
Le principe de l’induction mutuelle entre deux enroulements couplés par un circuit magnétique sera expliqué. La constitution (enroulements primaire/secondaire, noyau de fer) et le symbole normalisé du transformateur seront décrits.
2.2. Le Transformateur Parfait (Idéal)
Le modèle du transformateur parfait (sans pertes, sans fuites de flux) sera établi. L’élève maîtrisera les formules fondamentales reliant les tensions, les courants et le rapport de transformation (m = V₂/V₁ = N₂/N₁ = I₁/I₂).
2.3. Le Transformateur Réel et son Schéma Équivalent
Les imperfections du transformateur réel (résistance des enroulements, fuites de flux, pertes fer) seront modélisées. L’élève apprendra à construire et à utiliser le schéma équivalent ramené au secondaire (modèle de Kapp).
2.4. Essais à Vide et en Court-Circuit
Les deux essais fondamentaux qui permettent de déterminer expérimentalement les éléments du schéma équivalent seront détaillés : l’essai à vide (pour mesurer les pertes fer et le rapport de transformation) et l’essai en court-circuit (pour mesurer les pertes cuivre et l’impédance de fuite).
Chapitre 3 : Le Transformateur Triphasé
Ce chapitre étend l’étude aux transformateurs utilisés dans les réseaux de transport et de distribution d’énergie.
3.1. Constitution et Avantages
La constitution d’un transformateur triphasé (soit par trois unités monophasées, soit par un noyau à trois colonnes) sera présentée. Ses avantages en termes de puissance et de compacité seront soulignés.
3.2. Les Couplages des Enroulements
L’élève étudiera les quatre couplages possibles des enroulements primaire et secondaire : Étoile-étoile (Yy), Triangle-triangle (Dd), Étoile-triangle (Yd) et Triangle-étoile (Dy).
3.3. L’Indice Horaire
La notion d’indice horaire, qui caractérise le déphasage entre les tensions primaires et secondaires, sera introduite. L’élève apprendra à déterminer cet indice, essentiel pour le couplage en parallèle des transformateurs.
3.4. Le Couplage en Parallèle des Transformateurs
Les conditions à respecter pour mettre en parallèle plusieurs transformateurs (même rapport de transformation, même indice horaire, tensions de court-circuit proches) seront expliquées. Cette opération est courante dans les postes du réseau de la SNEL pour augmenter la puissance disponible.
Partie II : Les Machines Asynchrones Triphasées 🏭
Cette partie est dédiée à l’étude de la machine électrique tournante la plus robuste, la plus économique et la plus utilisée dans l’industrie : le moteur asynchrone. L’élève y découvrira le principe ingénieux du champ magnétique tournant et apprendra à analyser le comportement de ce moteur, depuis son démarrage jusqu’à son fonctionnement en charge.
Chapitre 4 : Principe et Constitution des Machines Asynchrones
Ce chapitre explique comment un mouvement peut être créé sans aucun contact électrique avec la partie tournante.
4.1. Le Théorème de Ferraris : Le Champ Magnétique Tournant
Le principe fondamental de la création d’un champ magnétique tournant à partir de trois enroulements statoriques décalés dans l’espace et alimentés par un système de courants triphasés sera démontré.
4.2. Constitution de la Machine Asynchrone
La constitution de la machine sera détaillée. L’élève distinguera le stator (partie fixe, contenant les enroulements triphasés) du rotor (partie tournante), et apprendra à différencier les deux types de rotors : le rotor à cage d’écureuil (le plus courant) et le rotor bobiné.
4.3. Le Principe de Fonctionnement du Moteur Asynchrone
L’élève comprendra le fonctionnement du moteur : le champ tournant du stator induit des courants dans le rotor (comme dans un transformateur), et l’interaction de ces courants avec le champ tournant (force de Laplace) crée le couple moteur qui met le rotor en rotation.
4.4. La Notion de Glissement
Le concept de glissement (g) sera défini comme la différence de vitesse relative entre le champ tournant (vitesse de synchronisme Ns) et le rotor (vitesse N). L’élève comprendra que le glissement est indispensable à la création du couple (0 < g < 1 en moteur).
Chapitre 5 : Modélisation et Bilan de Puissances du Moteur Asynchrone
Ce chapitre fournit les outils pour analyser quantitativement le comportement du moteur.
5.1. Le Schéma Équivalent Monophasé
L’élève apprendra que le moteur asynchrone peut être modélisé, pour une phase, par un schéma équivalent très similaire à celui d’un transformateur, où la charge représente la puissance mécanique.
5.2. Le Bilan des Puissances
Le cheminement de la puissance à travers le moteur sera analysé en détail. L’élève apprendra à identifier et à calculer chaque terme : la puissance absorbée au stator, les pertes Joule statoriques, les pertes fer, la puissance transmise au rotor, les pertes Joule rotoriques et enfin, la puissance mécanique utile.
5.3. Le Calcul du Couple Électromagnétique
La relation fondamentale entre la puissance transmise au rotor, le couple et la vitesse de synchronisme sera établie. L’élève apprendra à calculer le couple moteur à partir du bilan de puissances.
5.4. Le Calcul du Rendement
Le rendement du moteur sera défini comme le rapport de la puissance mécanique utile à la puissance électrique absorbée. L’élève s’exercera à le calculer à partir du bilan de puissances, une donnée clé pour évaluer l’efficacité énergétique de la machine.
Chapitre 6 : Caractéristiques et Procédés de Démarrage
Ce chapitre étudie le comportement du moteur en fonctionnement et les techniques pour le mettre en service.
6.1. La Caractéristique Mécanique C(n)
La courbe du couple en fonction de la vitesse sera tracée et analysée. L’élève identifiera les points importants : le couple de démarrage, le couple maximal (couple de décrochage) et le point de fonctionnement stable à l’intersection avec la caractéristique de la charge.
6.2. Le Problème du Démarrage
L’élève étudiera le principal inconvénient du démarrage direct du moteur asynchrone : l’appel de courant très important (5 à 8 fois le courant nominal), qui peut perturber le réseau électrique.
6.3. Les Procédés de Démarrage
Différentes méthodes visant à réduire le courant de démarrage seront présentées : le démarrage étoile-triangle (le plus courant), le démarrage par insertion de résistances statoriques et le démarrage par autotransformateur.
6.4. Le Moteur à Rotor Bobiné
Les avantages du moteur à rotor bobiné, qui permet un démarrage par insertion de résistances rotoriques offrant un fort couple de démarrage avec un faible appel de courant, seront étudiés. Cette technologie est utilisée pour l’entraînement de fortes inerties, comme les convoyeurs dans l’industrie minière de la GECAMINES.
Partie III : Les Machines Synchrones Triphasées 💡
Cette partie est consacrée à l’étude de la seconde grande famille de machines à courant alternatif : les machines synchrones. Contrairement aux machines asynchrones, elles tournent à une vitesse rigoureusement imposée par la fréquence du réseau. L’élève découvrira leur double facette : elles sont utilisées comme alternateurs pour produire la quasi-totalité de l’énergie électrique mondiale, mais aussi comme moteurs pour des applications spécifiques.
Chapitre 7 : Principe et Constitution des Machines Synchrones
Ce chapitre introduit les caractéristiques fondamentales de ces machines.
7.1. Principe de Fonctionnement
Le principe de la machine synchrone sera expliqué : le rotor, qui est un électroaimant alimenté en courant continu (l’excitation), est « accroché » au champ tournant créé par le stator et tourne exactement à la même vitesse (vitesse de synchronisme). Il n’y a pas de glissement.
7.2. Constitution de la Machine Synchrone
La constitution de la machine sera décrite. L’élève identifiera le stator (ou induit), similaire à celui de la machine asynchrone, et le rotor (ou inducteur), qui peut être à pôles lisses (pour les turboalternateurs à grande vitesse) ou à pôles saillants (pour les alternateurs de centrales hydroélectriques comme à Inga).
7.3. La Nécessité d’une Source d’Excitation
L’élève comprendra que la machine synchrone nécessite une source de courant continu externe pour alimenter l’électroaimant du rotor. Les différents systèmes d’excitation (statique, par machine tournante) seront présentés.
7.4. Réversibilité : Alternateur et Moteur
La parfaite réversibilité de la machine sera mise en évidence : si on l’entraîne mécaniquement, elle produit de l’électricité (fonctionnement en alternateur) ; si on l’alimente électriquement, elle produit un travail mécanique (fonctionnement en moteur).
Chapitre 8 : L’Alternateur : Modélisation et Essais
Ce chapitre se concentre sur le fonctionnement de la machine en générateur.
8.1. Le Schéma Équivalent Monophasé (Modèle de Behn-Eschenburg)
Le modèle le plus simple de l’alternateur par phase sera établi, le représentant par une force électromotrice (f.é.m.) E en série avec une impédance synchrone Zs. L’élève apprendra que la f.é.m. est proportionnelle au courant d’excitation et à la vitesse.
8.2. L’Essai à Vide
L’essai à vide, qui consiste à mesurer la tension aux bornes de l’alternateur en fonction du courant d’excitation, sera réalisé. Il permet de tracer la caractéristique à vide, qui illustre la saturation du circuit magnétique.
8.3. L’Essai en Court-Circuit
L’essai en court-circuit, qui consiste à mesurer le courant de court-circuit en fonction du courant d’excitation, sera effectué. Il permet de tracer la caractéristique en court-circuit et de déterminer la valeur de l’impédance synchrone.
8.4. Le Diagramme de Potier
Le diagramme de Potier sera présenté comme une méthode graphique permettant de séparer l’impédance synchrone en sa réactance de fuite et l’effet de la réaction magnétique d’induit, offrant un modèle plus précis de l’alternateur.
Chapitre 9 : Fonctionnement de l’Alternateur sur le Réseau
Ce chapitre analyse le comportement de l’alternateur lorsqu’il est connecté au réseau électrique.
9.1. Le Couplage au Réseau
Les quatre conditions de couplage d’un alternateur à un réseau infini (même ordre des phases, même tension, même fréquence, concordance de phase) seront rigoureusement énoncées. L’utilisation du synchronoscope pour vérifier ces conditions sera expliquée.
9.2. Le Bilan de Puissances et le Rendement
Le bilan de puissances de l’alternateur sera établi. L’élève identifiera les différentes pertes (mécaniques, fer, excitation, Joule statoriques) et calculera le rendement, qui est généralement très élevé pour les grosses machines.
9.3. Le Réglage de la Puissance Active
L’élève apprendra que, une fois couplé au réseau, la puissance active fournie par l’alternateur est directement contrôlée par la puissance de la machine qui l’entraîne (turbine hydraulique, turbine à vapeur, moteur diesel).
9.4. Le Réglage de la Puissance Réactive
L’élève découvrira que la puissance réactive fournie par l’alternateur au réseau est contrôlée par son courant d’excitation. L’alternateur peut ainsi fournir ou absorber de la puissance réactive, jouant un rôle crucial dans le réglage de la tension du réseau.
Partie IV : Applications et Mise en Œuvre des Machines Électriques ⚡️
Cette dernière partie synthétise les connaissances acquises en se concentrant sur les aspects pratiques de l’utilisation des machines électriques. Elle aborde le fonctionnement du moteur synchrone, les critères de choix d’un moteur pour une application donnée et les aspects essentiels de maintenance et de protection, complétant ainsi la formation du technicien en électrotechnique.
Chapitre 10 : Le Moteur Synchrone et Applications Spécifiques
Ce chapitre explore le fonctionnement de la machine synchrone en moteur.
10.1. Principe et Caractéristiques du Moteur Synchrone
Le fonctionnement en moteur sera analysé. L’élève notera sa principale caractéristique : une vitesse de rotation rigoureusement constante quelle que soit la charge. Le problème du démarrage (le moteur synchrone n’a pas de couple de démarrage propre) sera exposé.
10.2. Les Méthodes de Démarrage
Les techniques permettant de démarrer un moteur synchrone seront présentées : démarrage asynchrone à l’aide d’un enroulement amortisseur, ou démarrage par un entraîneur auxiliaire ou un variateur de fréquence.
10.3. Le Moteur Synchrone comme Compensateur
Une application importante du moteur synchrone surexcité, fonctionnant à vide, sera étudiée : il se comporte comme un condensateur de grande capacité et peut être utilisé pour améliorer le facteur de puissance d’une installation industrielle.
10.4. Les Moteurs Spéciaux (Pas-à-pas, Brushless)
Une introduction aux moteurs dérivés de la technologie synchrone sera proposée, comme le moteur pas-à-pas (utilisé en positionnement de précision) et le moteur « brushless » DC (utilisé dans l’informatique et les véhicules électriques).
Chapitre 11 : Introduction au Choix et à la Commande des Moteurs
Ce chapitre aborde les questions pratiques que se pose l’ingénieur lors de la conception d’un entraînement électrique.
11.1. L’Association Moteur-Charge
L’importance d’adapter la caractéristique mécanique du moteur à celle de la machine entraînée sera soulignée. L’élève apprendra à déterminer le point de fonctionnement et à vérifier les conditions de stabilité.
11.2. Le Choix d’un Moteur Électrique
Les critères de choix d’un moteur pour une application donnée seront listés : puissance, vitesse, couple, type de service (continu, intermittent), classe d’isolation, indice de protection (IP) et contraintes de l’environnement.
11.3. La Lecture de la Plaque Signalétique
L’élève s’exercera à lire et à interpréter toutes les informations contenues sur la plaque signalétique d’une machine électrique, qui constitue sa véritable carte d’identité technique.
11.4. Introduction à la Variation de Vitesse
Les principes de base de la variation de vitesse des moteurs à courant alternatif, principalement par variation de la fréquence d’alimentation à l’aide d’onduleurs électroniques, seront introduits comme une ouverture vers l’électronique de puissance.
Chapitre 12 : Maintenance et Protection des Machines Électriques
Ce chapitre final est consacré à la durabilité et à la sécurité de fonctionnement des machines.
12.1. Les Protections Électriques des Moteurs
Les principaux dispositifs de protection seront décrits : la protection contre les courts-circuits (fusibles, disjoncteurs magnétiques) et la protection contre les surcharges (relais thermiques).
12.2. La Maintenance Préventive
Les opérations de maintenance préventive courantes seront listées : contrôle de l’isolement des enroulements, surveillance des vibrations, vérification de l’état des roulements et graissage.
12.3. Les Principales Pannes des Machines Électriques
L’élève apprendra à identifier les symptômes des pannes les plus fréquentes (échauffement, bruit, vibrations) et à en diagnostiquer les causes probables (défaut d’isolement, usure d’un roulement, surcharge mécanique).
12.4. Le Bobinage des Moteurs
Une introduction à la technique de rebobinage d’un moteur sera proposée, expliquant comment remplacer les enroulements d’un stator endommagé, une activité de maintenance importante dans le contexte industriel congolais.
Annexes
Cette section fournit des documents de référence pour une consultation rapide et une meilleure assimilation des concepts.
1. Glossaire des Termes des Machines Électriques
Une définition claire des termes techniques clés (ex: glissement, réluctance, indice horaire, excitation) est fournie pour assurer la maîtrise du vocabulaire spécialisé.
2. Plaques Signalétiques des Machines Électriques
Des exemples de plaques signalétiques de transformateurs, de moteurs asynchrones et synchrones, avec une explication détaillée de chaque information.
3. Symboles Normalisés pour les Machines Électriques
Un récapitulatif des symboles graphiques normalisés pour représenter les différents types de machines et leurs enroulements dans les schémas électriques.
4. Formulaire des Machines à Courant Alternatif
Un aide-mémoire regroupant les formules essentielles pour le calcul des rapports de transformation, du glissement, des puissances, des couples et des rendements pour les différentes machines étudiées.



