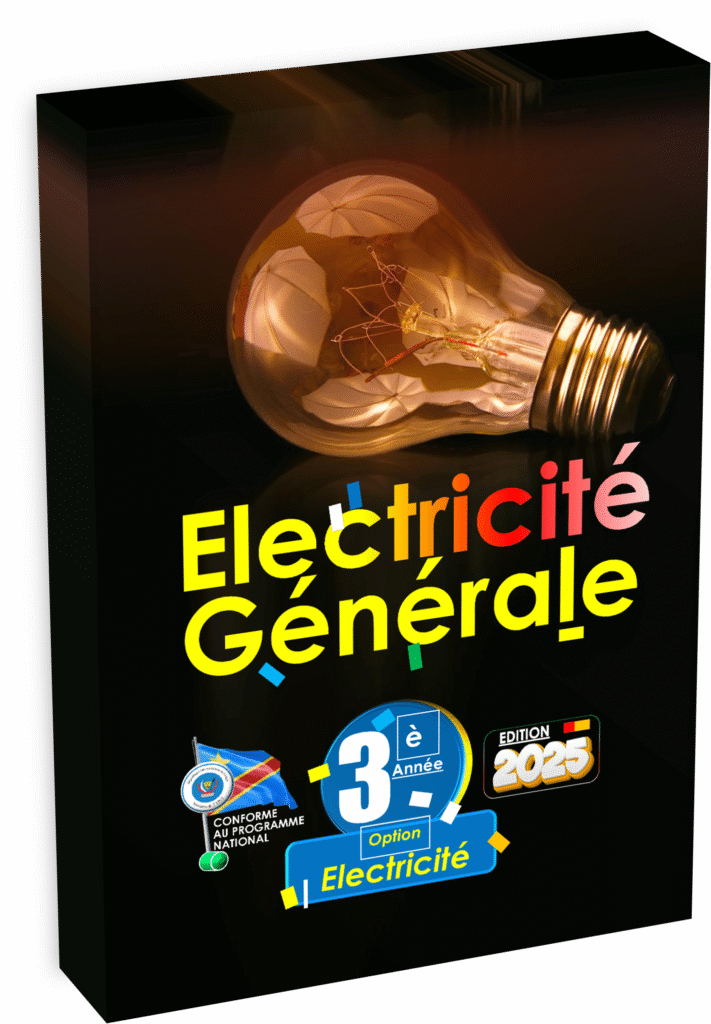
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE, 3ÈME ANNÉE, OPTION ÉLECTRICITÉ
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
PRÉLIMINAIRES
1. Objectifs Généraux du Cours 🎯
Ce cours marque un tournant décisif dans la formation de l’électricien, en abordant l’étude du courant alternatif sinusoïdal, qui constitue la forme d’énergie électrique la plus utilisée dans le monde. L’objectif est de doter l’élève des outils théoriques et analytiques pour comprendre et calculer les circuits en régime alternatif monophasé et triphasé. Au terme de ce module, l’apprenant doit maîtriser la représentation vectorielle et complexe des grandeurs alternatives, analyser le comportement des circuits RLC, comprendre les notions de puissance et de facteur de puissance, et savoir analyser les systèmes triphasés, qui sont à la base de toute distribution de puissance industrielle.
2. Approche Pédagogique Recommandée 🧑🏫
La nature abstraite du courant alternatif exige une pédagogie qui s’appuie fortement sur la visualisation et l’expérimentation. L’utilisation de l’oscilloscope devient centrale pour visualiser les signaux, les déphasages et les formes d’onde. Chaque concept théorique (impédance, résonance, puissances) doit être validé par des mesures en laboratoire. L’enseignant doit privilégier la résolution de problèmes concrets pour ancrer les savoirs : calcul du condensateur de relèvement du facteur de puissance pour un atelier de menuiserie à Mbandaka, analyse des courants dans un récepteur triphasé déséquilibré, ou encore la compréhension des pertes de transport d’énergie sur le réseau de la SNEL reliant Inga à d’autres provinces.
3. Prérequis du Cours 📚
Une maîtrise absolue de l’ensemble du programme d’électricité des deux années précédentes est impérative. L’élève doit être particulièrement à l’aise avec les lois de l’électromagnétisme, le fonctionnement des composants passifs (R, L, C) et l’analyse des circuits en courant continu. Des compétences solides en mathématiques, notamment en trigonométrie et, idéalement, une introduction aux nombres complexes, sont indispensables pour aborder l’analyse des circuits en régime sinusoïdal.
PARTIE 1 : INTRODUCTION AU COURANT ALTERNATIF MONOPHASÉ
Cette partie établit les fondations de l’étude du courant alternatif. Elle explique pourquoi cette forme de courant domine le paysage énergétique mondial et introduit les grandeurs et les outils mathématiques spécifiques nécessaires à sa description et à son analyse.
Chapitre 1 : Production et Avantages du Courant Alternatif
1.1. Le Principe de l’Alternateur
Le principe de la production d’une tension sinusoïdale par la rotation d’une spire dans un champ magnétique uniforme est étudié en détail. La relation entre la vitesse de rotation, le nombre de pôles et la fréquence de la tension générée est établie.
1.2. Avantages du Courant Alternatif
Les raisons de la prédominance du courant alternatif sont expliquées, en particulier la facilité de transformation de la tension grâce aux transformateurs. Cet avantage permet de transporter l’énergie sur de longues distances à très haute tension (pour minimiser les pertes par effet Joule) et de l’abaisser ensuite pour une distribution et une utilisation locales.
1.3. Les Effets du Courant Alternatif
Les effets du courant alternatif (thermique, magnétique, chimique) sont comparés à ceux du courant continu. L’effet thermique est conservé, mais l’effet chimique (électrolyse) disparaît en moyenne, tandis que les effets magnétiques deviennent variables.
1.4. Sécurité Spécifique aux Installations Alternatives
Les dangers spécifiques du courant alternatif pour le corps humain sont introduits. L’influence de la fréquence sur les seuils de danger (fibrillation ventriculaire) est discutée, soulignant la nécessité de mesures de protection renforcées.
Chapitre 2 : Grandeurs Sinusoïdales et Représentations
2.1. Définition Mathématique et Caractéristiques
Une grandeur sinusoïdale (tension ou courant) est décrite par son équation temporelle . Ses caractéristiques sont définies : valeur maximale, pulsation , période T, fréquence f, et phase à l’origine .
2.2. La Notion de Valeur Efficace
La valeur efficace d’un courant ou d’une tension est définie comme la valeur d’un courant ou d’une tension continus qui produirait le même effet thermique. La relation fondamentale pour un signal sinusoïdal est démontrée.
2.3. Déphasage entre Deux Grandeurs
Le concept de déphasage (avance, retard, en phase, en opposition de phase) entre deux grandeurs sinusoïdales de même fréquence est introduit. Il s’agit d’une notion capitale pour comprendre le comportement des circuits RLC.
2.4. La Représentation de Fresnel (Vecteurs Tournants)
La représentation vectorielle de Fresnel est enseignée comme un outil graphique puissant. Chaque grandeur sinusoïdale est représentée par un vecteur dont la longueur est la valeur efficace et l’angle est la phase. Cet outil transforme les additions trigonométriques complexes en de simples additions de vecteurs.
PARTIE 2 : ANALYSE DES CIRCUITS RLC EN MONOPHASÉ
Cette section constitue le cœur de l’analyse des circuits AC. Elle étudie le comportement de chaque composant passif de base en régime sinusoïdal, puis analyse leur association dans les circuits RLC série et parallèle, en mettant en évidence le phénomène crucial de la résonance.
Chapitre 3 : Comportement des Composants R, L, C en Alternatif
3.1. La Résistance Pure
Dans une résistance pure, le courant et la tension sont toujours en phase. La loi d’Ohm s’applique directement aux valeurs efficaces : .
3.2. La Bobine Parfaite (Inductance Pure)
Dans une inductance pure, le courant est en retard de 90° ( radians) sur la tension. La notion de réactance inductive (), qui représente l’opposition de la bobine au passage du courant alternatif, est introduite.
3.3. Le Condensateur Parfait (Capacité Pure)
Dans une capacité pure, le courant est en avance de 90° ( radians) sur la tension. La notion de réactance capacitive (), qui diminue lorsque la fréquence augmente, est définie.
3.4. L’Impédance Complexe
Pour unifier l’analyse, l’outil des nombres complexes est introduit. L’impédance complexe est définie pour chaque composant : , , . La loi d’Ohm généralisée simplifie tous les calculs.
Chapitre 4 : Le Circuit RLC Série et la Résonance
4.1. Calcul de l’Impédance Totale
L’impédance totale d’un circuit RLC série est calculée par addition vectorielle (Fresnel) ou complexe : . Le module de l’impédance et le déphasage total sont déterminés.
4.2. Construction du Diagramme de Fresnel
Le diagramme de Fresnel des tensions du circuit RLC série est construit, montrant la composition vectorielle de la tension aux bornes de la résistance, de l’inductance et de la capacité pour obtenir la tension totale.
4.3. Le Phénomène de Résonance en Intensité
La résonance série est étudiée. Elle se produit à la fréquence où la réactance inductive et capacitive s’annulent (). À cette fréquence, l’impédance est minimale (égale à R) et le courant est maximal.
4.4. Facteur de Qualité et Bande Passante
Le facteur de qualité (ou de surtension) Q du circuit est défini. Il caractérise l’acuité de la résonance. La notion de bande passante, qui décrit la plage de fréquences où le courant reste important, est introduite, concept de base des filtres en électronique.
Chapitre 5 : Puissances et Facteur de Puissance en Monophasé
5.1. La Puissance Instantanée et la Puissance Active
La puissance instantanée est analysée. Sa valeur moyenne, appelée puissance active (P) et mesurée en Watts (W), représente la puissance réellement consommée par le circuit (transformée en chaleur ou en travail). Elle est donnée par .
5.2. La Puissance Réactive
La puissance réactive (Q), mesurée en Volts Ampères Réactifs (VAR), est définie comme la puissance échangée entre la source et les composants réactifs (bobines, condensateurs). Elle ne produit pas de travail utile mais est nécessaire au fonctionnement du circuit. Elle est donnée par .
5.3. La Puissance Apparente et le Triangle des Puissances
La puissance apparente (S), mesurée en Volts Ampères (VA), est le produit des valeurs efficaces . Le triangle des puissances est construit, montrant la relation vectorielle entre P, Q et S : .
5.4. Le Facteur de Puissance
Le facteur de puissance () est défini comme le rapport entre la puissance active et la puissance apparente. Il mesure l’efficacité avec laquelle l’énergie est utilisée. Un facteur de puissance proche de 1 est souhaitable.
Chapitre 6 : Amélioration du Facteur de Puissance
6.1. Causes et Inconvénients d’un Mauvais Facteur de Puissance
Les charges inductives (moteurs, transformateurs), très présentes dans l’industrie, sont la cause principale d’un faible facteur de puissance (en retard). Les inconvénients sont une augmentation du courant appelé, des pertes en ligne accrues et des pénalités de la part du fournisseur d’énergie.
6.2. Principe de la Compensation d’Énergie Réactive
Le principe de l’amélioration du facteur de puissance est d’installer une source de puissance réactive capacitive (des batteries de condensateurs) en parallèle avec la charge inductive, pour « fournir » localement l’énergie réactive dont la charge a besoin.
6.3. Calcul de la Batterie de Condensateurs
La méthode de calcul de la capacité des condensateurs nécessaires pour relever le facteur de puissance d’une valeur initiale à une valeur cible est détaillée, à partir de la puissance active de l’installation et des angles de déphasage.
6.4. Applications Industrielles
L’importance de la compensation d’énergie réactive est illustrée par des exemples concrets, comme dans les grandes industries de la région du Katanga, où la présence de nombreux moteurs de forte puissance rend cette pratique économiquement indispensable.
PARTIE 3 : INTRODUCTION AUX SYSTÈMES TRIPHASÉS
Cette section introduit les systèmes polyphasés, et plus particulièrement le triphasé, qui est le mode de transport et de distribution de l’énergie électrique par excellence pour les puissances importantes.
Chapitre 7 : Production et Caractéristiques des Tensions Triphasées
7.1. Le Réseau Triphasé de Tensions
Un système de tensions triphasées est défini comme un ensemble de trois tensions sinusoïdales de même fréquence et de même amplitude, mais déphasées entre elles de 120°.
7.2. Tensions Simples et Tensions Composées
La distinction entre les tensions simples (mesurées entre une phase et le neutre, V) et les tensions composées (mesurées entre deux phases, U) est établie. La relation fondamentale pour un système équilibré est démontrée.
7.3. Couplages de la Source : Étoile et Triangle
Les deux manières de coupler les enroulements du générateur (ou du secondaire d’un transformateur) sont présentées. Le couplage étoile (Y) met à disposition le fil neutre, tandis que le couplage triangle (Δ) ne le fait pas.
7.4. Ordre des Phases et Champ Tournant
La notion d’ordre des phases est introduite. Il est démontré que l’alimentation de trois bobines décalées dans l’espace par un système de courants triphasés crée un champ magnétique tournant, principe de base de la quasi-totalité des moteurs industriels.
Chapitre 8 : Couplages des Récepteurs Triphasés
8.1. Le Couplage en Étoile (Y)
Le montage d’une charge triphasée en étoile est analysé. Chaque élément du récepteur est soumis à la tension simple V et est parcouru par le courant de ligne I.
8.2. Le Couplage en Triangle (Δ)
Le montage en triangle est étudié. Chaque élément du récepteur est soumis à la tension composée U, et le courant de ligne I se divise en courants de phase J, avec la relation .
8.3. Comparaison des Couplages
Les deux couplages sont comparés pour une même charge. Le couplage triangle absorbe trois fois plus de puissance que le couplage étoile, une propriété utilisée dans le démarrage étoile-triangle des moteurs.
8.4. Cas des Récepteurs Déséquilibrés
Le cas d’une charge déséquilibrée (impédances différentes sur les trois phases) est introduit. En montage étoile, le déséquilibre crée un courant dans le fil neutre, ce qui souligne l’importance de ce dernier pour la stabilité des tensions, un enjeu majeur dans les réseaux de distribution urbaine comme celui de Goma.
Chapitre 9 : Puissances en Régime Triphasé
9.1. Puissance Active Triphasée
La formule de la puissance active totale pour un système triphasé équilibré est établie : . Elle est valable que le couplage soit en étoile ou en triangle.
9.2. Puissance Réactive Triphasée
De même, la formule de la puissance réactive totale est .
9.3. Puissance Apparente Triphasée
La puissance apparente totale est . Le triangle des puissances reste valable pour le système triphasé dans son ensemble.
9.4. Mesure de la Puissance : Méthode des Deux Wattmètres
La méthode des deux wattmètres est présentée comme la méthode universelle pour mesurer la puissance active dans un système triphasé à trois fils, qu’il soit équilibré ou non. La puissance totale est la somme algébrique des lectures des deux wattmètres.
ANNEXES
Les annexes regroupent des outils et des mémentos pour l’analyse des circuits alternatifs. Elles contiennent un formulaire complet sur les grandeurs sinusoïdales, les impédances et les puissances, des diagrammes de Fresnel types pour les circuits RLC, et des fiches de synthèse sur les couplages et les formules du triphasé. Un lexique des termes spécifiques au courant alternatif est également inclus.