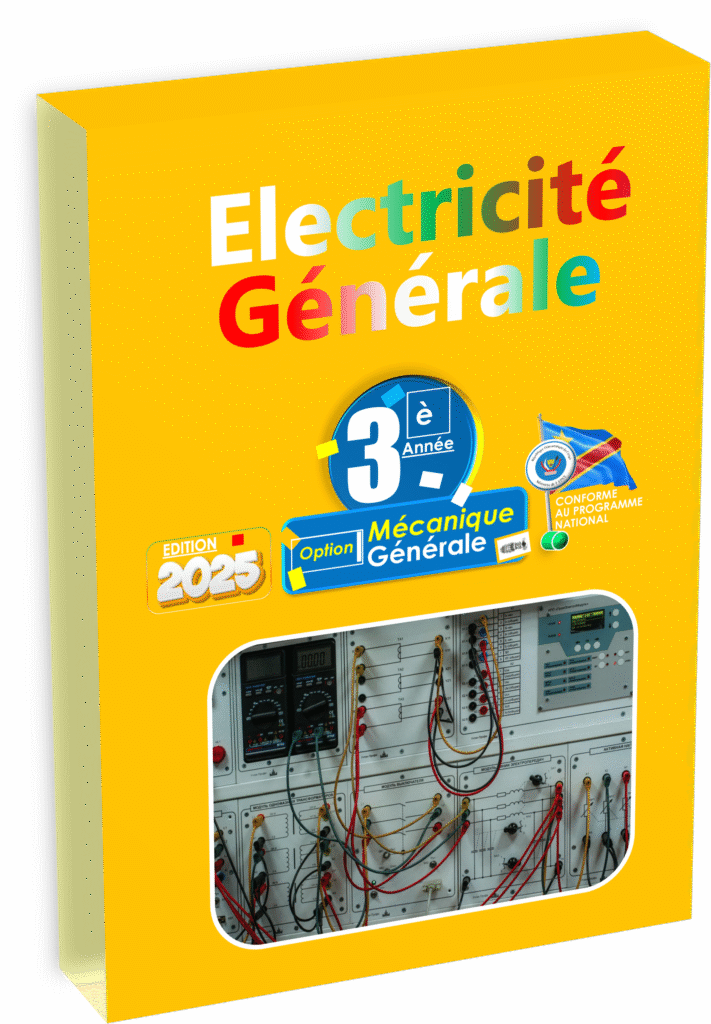
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE, 3 ÈME ANNEE, OPTION MECANIQUE GENERALE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
Préliminaires
Objectifs Pédagogiques du Cours 🎯
Ce cours a pour objectif de doter le technicien mécanicien d’une compréhension approfondie des machines électriques tournantes, qu’elles soient à courant alternatif ou continu. Au terme de cette année, l’élève doit être capable de différencier les types de machines, d’expliquer leur principe de fonctionnement, d’interpréter leurs caractéristiques et de comprendre les schémas de commande et de puissance associés. L’accent est mis sur la connaissance pratique nécessaire à l’installation, au réglage, à la maintenance et au dépannage des moteurs et génératrices qui animent l’outil industriel national.
Approche Didactique et Méthodologique ⚙️
L’enseignement adopte une démarche qui lie systématiquement la théorie à la technologie et aux applications. Chaque type de machine est introduit par son principe physique fondamental, immédiatement suivi par l’étude technologique de sa constitution et l’analyse de ses courbes caractéristiques. L’approche est résolument qualitative et vise la compréhension des phénomènes plutôt que la virtuosité dans des calculs complexes. Des séances de travaux pratiques en laboratoire sont intégrées au cours pour permettre aux élèves de réaliser les câblages, de mesurer les grandeurs pertinentes et de visualiser le comportement réel des machines.
Contexte Industriel et Sécurité ⚠️
La pertinence du cours est assurée par des exemples et des études de cas tirés du tissu industriel congolais, qu’il s’agisse des moteurs de forte puissance utilisés dans les cimenteries du Kongo Central, des systèmes de traction des engins miniers du Lualaba ou des génératrices de secours assurant l’autonomie énergétique des entreprises à Kinshasa. Une attention absolue est portée aux règles de sécurité électrique lors des manipulations, en insistant sur les procédures de consignation et les risques liés aux machines tournantes et aux tensions mises en jeu.
Partie I : Consolidation des Fondamentaux en Courant Alternatif
Cette partie initiale assure que tous les élèves disposent d’un socle solide en courant alternatif sinusoïdal, indispensable pour aborder l’étude des machines tournantes. Elle révise et approfondit les notions vues l’année précédente en se concentrant sur les outils d’analyse et les concepts de puissance.
Chapitre 1 : Le Signal Sinusoïdal et sa Représentation
Ce chapitre a pour but de consolider la maîtrise de la modélisation mathématique et graphique des grandeurs alternatives, qui est le langage de base de l’électrotechnique.
1.1. De la Périodicité Mécanique à la Sinusoïde Électrique
L’analogie entre le mouvement circulaire uniforme et la génération d’une tension sinusoïdale est réexaminée en détail pour assurer une compréhension intuitive et durable des phénomènes périodiques.
1.2. Grandeurs Caractéristiques : Amplitude, Fréquence et Phase
Les définitions d’amplitude, de période, de fréquence, de pulsation et de phase sont rigoureusement revues, en insistant sur leurs unités et leur signification physique dans le contexte du réseau électrique national (50 Hz).
1.3. La Valeur Efficace : Signification Physique et Calcul
La notion de valeur efficace est réaffirmée comme la grandeur d’intérêt pratique pour quantifier l’effet d’un courant ou d’une tension. Sa relation avec la valeur maximale est appliquée dans des exercices concrets.
1.4. Représentation Vectorielle de Fresnel
L’outil des vecteurs de Fresnel est introduit comme une méthode graphique puissante et intuitive pour représenter l’amplitude et le déphasage des grandeurs sinusoïdales, simplifiant ainsi l’analyse des circuits.
Chapitre 2 : Comportement des Circuits en Régime Sinusoïdal
Ce chapitre passe en revue le comportement des circuits de base et approfondit la notion fondamentale de puissance en régime alternatif, un enjeu économique majeur pour toute entreprise.
2.1. Révision des Circuits R, L, C et Notion de Déphasage
Le comportement des résistances, des inductances et des capacités en courant alternatif est synthétisé, en se concentrant sur le déphasage caractéristique que chaque composant introduit entre le courant et la tension.
2.2. Le Triangle des Puissances : Active, Réactive et Apparente
Les trois puissances sont définies et leur relation est illustrée par le triangle des puissances. La puissance active (W) représente le travail utile, la puissance réactive (VAR) est liée à l’énergie magnétique des moteurs, et la puissance apparente (VA) représente la charge totale sur le réseau.
2.3. Le Facteur de Puissance et son Importance Économique
Le facteur de puissance () est présenté comme un indicateur de l’efficacité énergétique d’une installation. L’importance de le maintenir élevé pour optimiser la facturation de la SNEL et la capacité des lignes de transport est expliquée.
2.4. Instruments de Mesure en Courant Alternatif
Un rappel sur les différents types d’appareils de mesure (voltmètres, ampèremètres, wattmètres) et leurs principes de fonctionnement est effectué pour préparer les séances de laboratoire.
Partie II : Systèmes Triphasés et Production d’Énergie
Cette partie se concentre sur les systèmes triphasés, qui sont la colonne vertébrale de la production, du transport et de l’utilisation de l’énergie électrique dans le monde industriel. Elle aborde ensuite leur source : l’alternateur.
Chapitre 3 : Principes et Avantages du Triphasé
Ce chapitre établit les fondements des systèmes triphasés et justifie leur prédominance dans les applications de puissance.
3.1. Génération d’un Système de Tensions Triphasées
Le principe de production de trois tensions de même amplitude, de même fréquence et déphasées de 120°, est expliqué à partir d’un alternateur élémentaire à trois enroulements.
3.2. Représentation Temporelle et Vectorielle
Les trois tensions sont représentées sur un même graphique en fonction du temps, puis sous forme d’un système de vecteurs de Fresnel équilibré, illustrant leur succession et leur somme vectorielle nulle.
3.3. Relations entre Grandeurs Simples et Composées
Les notions de tensions simples (entre phase et neutre) et composées (entre phases) sont définies, et la relation fondamentale est établie pour un réseau équilibré.
3.4. Puissance et Mesure en Triphasé
La formule de la puissance active totale en triphasé () est introduite, et la méthode de mesure à deux wattmètres est présentée comme une application pratique.
Chapitre 4 : L’Alternateur – Le Générateur de Courant Alternatif
Ce chapitre étudie la machine qui est à l’origine de la quasi-totalité de l’énergie électrique, depuis les gigantesques unités des barrages d’Inga jusqu’aux groupes électrogènes de secours.
4.1. Principe de Fonctionnement et Constitution
La structure de l’alternateur synchrone est décrite, en distinguant l’inducteur (rotor, créant le champ magnétique) et l’induit (stator, où la tension est générée). Les deux types de rotors (à pôles lisses et à pôles saillants) sont présentés.
4.2. Caractéristiques de la Force Électromotrice (F.É.M.)
La relation entre la fréquence de la tension produite, la vitesse de rotation et le nombre de paires de pôles () est établie (relation de synchronisme). L’expression de la valeur de la F.É.M. est donnée en fonction du flux magnétique et de la vitesse.
4.3. Fonctionnement en Charge et Réglage de la Tension
Le comportement de l’alternateur lorsqu’il débite du courant est analysé, en montrant l’effet de la chute de tension interne. Les méthodes de régulation de la tension de sortie par action sur le courant d’excitation sont expliquées.
4.4. Couplage des Alternateurs au Réseau
Les conditions impératives à respecter pour coupler un alternateur au réseau (même tension, même fréquence, même ordre des phases et concordance de phase) sont énumérées, et les procédures de couplage sont décrites.
Partie III : La Machine à Courant Continu : Principe et Fonctionnement en Générateur (Dynamo)
Cette partie est une étude approfondie de la machine à courant continu, une technologie robuste et offrant de grandes possibilités de régulation, en commençant par son fonctionnement en tant que génératrice d’électricité.
Chapitre 5 : Structure et Principes de la Machine à Courant Continu
Ce chapitre dissèque la machine à courant continu pour en comprendre les éléments constitutifs et les principes physiques fondamentaux qui régissent son comportement.
5.1. Constitution : Inducteur, Induit et Collecteur
La structure est détaillée : l’inducteur (stator) crée un champ magnétique fixe, l’induit (rotor) est le siège des phénomènes électromagnétiques, et le collecteur, associé aux balais, est l’organe mécanique essentiel qui assure la conversion de la tension alternative interne en tension continue externe.
5.2. Principe de la Réversibilité : Moteur et Générateur
Le principe de réversibilité est énoncé : la même machine peut fonctionner soit en générateur (dynamo), convertissant une puissance mécanique en puissance électrique, soit en moteur, réalisant la conversion inverse.
5.3. Force Électromotrice et Couple Électromagnétique
Les deux équations fondamentales de la machine sont établies : la formule de la force électromotrice (F.É.M.), proportionnelle au flux et à la vitesse, et la formule du couple électromagnétique, proportionnel au flux et au courant d’induit.
5.4. Réaction Magnétique d’Induit et Commutation
Les deux phénomènes limitant les performances sont expliqués : la réaction magnétique d’induit (déformation du champ magnétique principal par le courant d’induit) et la commutation (inversion du courant dans les sections d’enroulement), qui peut provoquer des étincelles aux balais.
Chapitre 6 : La Dynamo à Excitation Indépendante
Ce chapitre analyse le mode de fonctionnement le plus simple de la dynamo, où le champ magnétique est créé par une source de tension extérieure et indépendante.
6.1. Schéma de Câblage et Principe de Fonctionnement
Le schéma de montage est présenté, montrant les deux circuits électriques distincts : le circuit d’excitation et le circuit d’induit. Le principe de fonctionnement est expliqué.
6.2. Caractéristique à Vide : Courbe d’Aimantation
L’essai à vide (sans charge) permet de tracer la F.É.M. en fonction du courant d’excitation, à vitesse constante. Cette courbe, qui reflète la saturation magnétique du circuit, est une caractéristique intrinsèque de la machine.
6.3. Caractéristique en Charge et Chute de Tension
L’essai en charge permet de tracer la tension aux bornes en fonction du courant débité. La chute de tension observée est expliquée par la chute ohmique dans l’induit et par la réaction magnétique.
6.4. Applications et Limites d’Utilisation
Ce type d’excitation offre une excellente régulation de tension mais nécessite une source auxiliaire, ce qui limite son usage à des applications spécifiques comme les groupes de soudage ou certains bancs d’essais.
Chapitre 7 : La Dynamo à Excitation Shunt (Dérivation)
Ce chapitre étudie le cas le plus courant de la dynamo auto-excitée, où la machine produit elle-même le courant nécessaire à son excitation.
7.1. Principe d’Auto-Amorçage
Les conditions nécessaires à l’auto-amorçage de la tension (magnétisme rémanent, sens de branchement de l’inducteur, vitesse de rotation suffisante) sont expliquées.
7.2. Schéma de Câblage et Point de Fonctionnement
Le schéma de câblage, où l’enroulement d’excitation est branché en parallèle (en shunt) sur l’induit, est présenté. Le point de fonctionnement à vide est déterminé graphiquement.
7.3. Caractéristique Externe et Réglage de la Tension
La caractéristique en charge (tension en fonction du courant débité) est analysée, montrant une chute de tension plus prononcée que pour l’excitation indépendante. Le réglage de la tension par un rhéostat de champ est démontré.
7.4. Le Compoundage pour la Stabilisation de la Tension
Le principe du compoundage, qui consiste à ajouter un enroulement série pour compenser la chute de tension en charge et obtenir une tension quasi constante, est expliqué.
Partie IV : Le Moteur à Courant Continu et ses Applications
Cette dernière partie se concentre sur le fonctionnement de la machine à courant continu en moteur, en analysant les caractéristiques des différents types d’excitation et leurs domaines d’application privilégiés.
Chapitre 8 : Caractéristiques Générales des Moteurs CC
Ce chapitre établit les lois générales qui gouvernent tous les moteurs à courant continu, quel que soit leur mode d’excitation.
8.1. Formules Fondamentales en Régime Moteur
Les équations de la force contre-électromotrice (F.C.É.M.), du courant d’induit et du couple moteur sont établies. La F.C.É.M. est présentée comme le phénomène clé de l’autorégulation du moteur.
8.2. Le Démarrage : Nécessité du Rhéostat
Le problème de la forte pointe de courant au démarrage (F.C.É.M. nulle) est expliqué. La nécessité d’insérer un rhéostat de démarrage en série avec l’induit pour limiter ce courant est démontrée.
8.3. Inversion du Sens de Rotation
Les deux méthodes pour inverser le sens de rotation sont présentées : soit en inversant le sens du courant dans l’induit, soit en inversant le sens du courant dans l’inducteur, mais jamais les deux simultanément.
8.4. Stabilité de Fonctionnement et Bilan de Puissances
Le bilan des puissances (absorbée, électromagnétique, utile) et les différents postes de pertes (effet Joule, pertes fer, pertes mécaniques) sont décrits, menant à la définition du rendement du moteur.
Chapitre 9 : Le Moteur à Excitation Shunt
Ce chapitre étudie le moteur shunt, caractérisé par une vitesse de rotation relativement constante, ce qui le destine à l’entraînement de nombreuses machines-outils.
9.1. Caractéristiques Vitesse-Couple et Vitesse-Courant
Les courbes caractéristiques du moteur shunt sont analysées, montrant une légère diminution de la vitesse lorsque le couple augmente. Cette propriété en fait un moteur stable et facile à contrôler.
9.2. Réglage de la Vitesse par le Champ d’Excitation
La méthode de réglage de la vitesse par variation du courant d’excitation à l’aide d’un rhéostat de champ est expliquée. Il est montré qu’une diminution du courant d’excitation provoque une augmentation de la vitesse.
9.3. Applications : Entraînements à Vitesse Constante
Les applications typiques du moteur shunt sont listées : tours, fraiseuses, ventilateurs, pompes centrifuges, c’est-à-dire toutes les machines nécessitant une vitesse de fonctionnement stable quelle que soit la charge.
9.4. Principe du Freinage Rhéostatique
Le principe du freinage en faisant fonctionner le moteur en génératrice débitant sur une résistance est expliqué. C’est une méthode de freinage efficace pour de nombreuses applications.
Chapitre 10 : Le Moteur à Excitation Série
Ce chapitre analyse le moteur série, dont la propriété remarquable est de fournir un couple de démarrage extrêmement élevé, le prédestinant aux applications de traction et de levage.
10.1. Caractéristiques Vitesse-Couple : Le Couple de Démarrage Élevé
La caractéristique principale du moteur série est étudiée : le couple est approximativement proportionnel au carré du courant à faible charge, ce qui lui confère une capacité de démarrage exceptionnelle.
10.2. Le Risque d’Emballement à Vide
Le danger fondamental du moteur série est expliqué : en l’absence de couple résistant, la vitesse augmente de manière exponentielle et peut conduire à la destruction de la machine par effets centrifuges. Un moteur série ne doit jamais fonctionner sans charge.
10.3. Applications : Traction Électrique et Levage
Ses applications de prédilection sont décrites : traction ferroviaire (locomotives de la SNCC), tramways, démarreurs de véhicules, et tous les appareils de levage (treuils, ponts roulants) qui nécessitent de vaincre une forte inertie au démarrage.
10.4. Méthodes de Réglage de la Vitesse
Les méthodes de variation de vitesse, notamment par insertion de résistances en série avec l’induit ou par couplage de plusieurs moteurs (série-parallèle), sont présentées dans le contexte de la traction.
Chapitre 11 : Applications Technologiques des Machines CC
Ce chapitre de synthèse présente des systèmes et des applications concrètes qui combinent les connaissances acquises sur les moteurs et les génératrices à courant continu.
11.1. Le Groupe Ward-Léonard pour la Variation de Vitesse
Ce système, composé de trois machines, est présenté comme une solution classique et performante pour la variation de vitesse précise et réversible des moteurs à courant continu, utilisée par exemple pour les machines d’extraction des puits de mine.
11.2. Le Groupe de Soudage Rotatif (Convertisseur)
Le principe du groupe convertisseur, où un moteur entraîne une dynamo à caractéristique plongeante, est expliqué comme une source de courant continu robuste et adaptée au soudage à l’arc.
11.3. La Dynamo d’Automobile et son Conjoncteur-Disjoncteur
L’étude technologique de la dynamo de véhicule est menée, en se concentrant sur le rôle du conjoncteur-disjoncteur, l’appareil électromécanique qui assure la connexion à la batterie et la régulation de la charge.
11.4. Notions sur les Moteurs Compound
Le moteur compound, qui combine un enroulement shunt et un enroulement série, est présenté comme une solution de compromis qui allie le bon couple de démarrage du moteur série et la stabilité de vitesse du moteur shunt.
Annexes
Les annexes regroupent des informations de référence et des schémas synthétiques pour faciliter la compréhension et les applications pratiques.
Schémas de Câblage des Machines CC 🔌
Cette section fournit les schémas de connexion normalisés pour les différents types de dynamos et de moteurs à courant continu, incluant les circuits de puissance et de commande pour le démarrage et l’inversion de marche.
Tableau Comparatif des Moteurs Électriques 📊
Un tableau synthétique compare les caractéristiques principales (vitesse, couple de démarrage, régulation, coût) des différents moteurs étudiés (shunt, série, asynchrone) pour guider le choix en fonction de l’application.
Guide de Maintenance des Machines Tournantes 🔧
Une fiche pratique résume les opérations de maintenance préventive essentielles pour les machines électriques tournantes : contrôle de l’état des balais et du collecteur, vérification de l’usure des roulements, et mesure de l’isolement des enroulements.