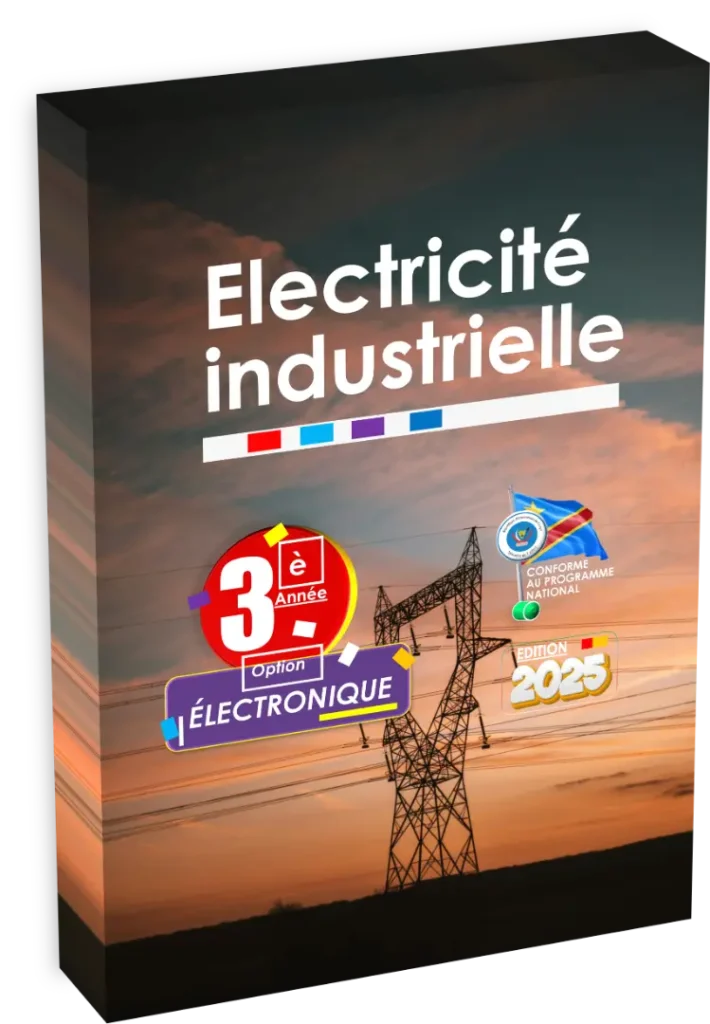
ELECTRICITE INDUSTRIELLE
3ÈME ANNÉE – OPTION ÉLECTRONIQUE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
Préliminaires
1. Objectifs Généraux du Cours
Ce manuel a pour finalité de doter l’élève des connaissances fondamentales relatives aux systèmes électriques de forte puissance, qui constituent le socle de toute application industrielle. Le cours aborde l’étude des réseaux triphasés, l’analyse des circuits magnétiques, et culmine avec une étude approfondie de la première grande famille de convertisseurs d’énergie : les machines à courant continu. L’objectif est de permettre à l’élève de comprendre, d’analyser et de justifier les choix technologiques liés à la production, la conversion et l’utilisation de l’énergie électrique dans un contexte industriel.
2. Compétences Visées
Au terme de cette année d’étude, l’élève détiendra la capacité de :
- [cite_start]Analyser un réseau triphasé équilibré, calculer les courants et les tensions pour les couplages étoile et triangle[cite: 613, 615].
- [cite_start]Calculer les différentes puissances (active, réactive, apparente) dans une installation triphasée[cite: 618].
- [cite_start]Appliquer les lois des circuits magnétiques pour analyser le fonctionnement d’un électroaimant[cite: 623, 628].
- [cite_start]Décrire la constitution d’une machine à courant continu et expliquer le principe de la conversion électromécanique d’énergie[cite: 637, 652].
- [cite_start]Analyser les caractéristiques de fonctionnement d’une machine à courant continu, que ce soit en mode moteur ou en mode génératrice (dynamo)[cite: 648, 656].
3. Approche Pédagogique
La démarche pédagogique est construite sur une progression logique allant des systèmes de distribution de l’énergie (triphasé) aux convertisseurs électromécaniques (machines). Chaque concept théorique est systématiquement illustré par des applications technologiques concrètes. L’analyse des machines électriques est menée en permanence sous le double aspect de la constitution matérielle et du modèle de fonctionnement. Des études de cas, comme le choix du couplage d’un moteur pour une usine de textile à Kisangani ou l’analyse des caractéristiques d’une dynamo pour un système d’excitation d’alternateur à la centrale d’Inga, permettent d’ancrer les savoirs dans la réalité industrielle congolaise.
PREMIÈRE PARTIE : LES SYSTÈMES TRIPHASÉS ET LEURS APPLICATIONS 🔌
Cette partie est dédiée à l’étude du mode de transport et de distribution de l’énergie électrique le plus répandu dans le monde industriel : le système triphasé. L’élève y découvrira les raisons de la prédominance de ce système, apprendra à représenter et à manipuler les grandeurs sinusoïdales triphasées, et maîtrisera l’analyse des différents couplages possibles pour les récepteurs. L’étude se conclut par le calcul des puissances, un enjeu économique et technique majeur pour toute installation industrielle.
CHAPITRE 1 : PRODUCTION ET REPRÉSENTATION DES GRANDEURS TRIPHASÉES
1.1. Intérêt et avantage du triphasé
Ce sous-chapitre justifie le choix du triphasé pour la production et le transport de l’énergie : économie de conducteurs, puissance instantanée constante, et facilité de création de champs magnétiques tournants pour les moteurs.
1.2. Production d’un système de tensions triphasées
Le principe de la génération de trois tensions sinusoïdales de même fréquence, de même amplitude et déphasées de 120° par un alternateur est expliqué. [cite_start]Les notions de tensions simples (entre phase et neutre) et de tensions composées (entre phases) sont introduites[cite: 612].
1.3. Représentation temporelle et vectorielle
[cite_start]L’élève apprendra à représenter un système triphasé équilibré sous deux formes : la représentation temporelle (trois sinusoïdes décalées) et la représentation vectorielle (diagramme de Fresnel avec trois vecteurs formant une étoile à 120°), un outil essentiel pour l’analyse. [cite: 619]
1.4. Relations entre tensions simples et composées
La relation fondamentale liant les valeurs efficaces des tensions simples (V) et composées (U) dans un réseau triphasé équilibré () est démontrée géométriquement à l’aide du diagramme de Fresnel.
CHAPITRE 2 : COUPLAGES DES RÉCEPTEURS EN ÉTOILE
2.1. Le montage étoile (Y)
Le principe du couplage en étoile est présenté : les trois phases du récepteur sont connectées à un point commun, le point neutre. [cite_start]Le schéma de ce montage est dessiné, en distinguant le cas avec et sans fil de neutre. [cite: 613]
2.2. Relations des courants et tensions en couplage étoile
Dans un couplage étoile, l’élève apprendra que chaque phase du récepteur est soumise à la tension simple (V) du réseau. [cite_start]La relation entre le courant en ligne (I) et le courant dans une phase (J) est établie : en montage étoile, . [cite: 614]
2.3. Le cas du récepteur équilibré
Lorsque les trois impédances du récepteur sont identiques (cas équilibré), les courants de ligne forment également un système triphasé équilibré. [cite_start]L’élève démontrera que dans ce cas, le courant dans le fil de neutre est nul. [cite: 613]
2.4. Le cas du récepteur déséquilibré
Si les impédances sont différentes, le système de courants est déséquilibré, et un courant circule dans le neutre. [cite_start]L’importance du fil de neutre pour maintenir l’équilibre des tensions aux bornes du récepteur est soulignée. [cite: 613]
CHAPITRE 3 : COUPLAGES DES RÉCEPTEURS EN TRIANGLE
3.1. Le montage triangle (Δ)
Le principe du couplage en triangle est expliqué : les trois phases du récepteur sont connectées en série pour former une boucle fermée, chaque sommet de la boucle étant relié à une phase du réseau. [cite_start]Le schéma de ce montage, qui ne possède pas de point neutre, est dessiné. [cite: 615]
3.2. Relations des courants et tensions en couplage triangle
Dans un couplage triangle, chaque phase du récepteur est soumise à la tension composée (U) du réseau. [cite_start]L’élève démontrera à l’aide de la loi des nœuds et du diagramme de Fresnel la relation fondamentale entre le courant en ligne (I) et le courant dans une phase (J) : . [cite: 616]
3.3. Le cas du récepteur équilibré
Pour un récepteur triangle équilibré, les courants de phase (J) sont identiques en module et déphasés de 120°. [cite_start]L’élève analysera le diagramme vectoriel pour comprendre le déphasage de 30° entre les courants de ligne et les courants de phase. [cite: 615]
3.4. Choix du couplage étoile ou triangle
Ce sous-chapitre synthétise les critères de choix. [cite_start]L’élève apprendra à choisir le couplage d’un récepteur triphasé en fonction de la tension nominale de ses enroulements et de la tension du réseau auquel il doit être raccordé, une compétence de base pour tout technicien intervenant sur un parc de moteurs dans une usine de la BRALIMA à Bukavu. [cite: 620]
CHAPITRE 4 : PUISSANCES EN RÉGIME TRIPHASÉ
4.1. La puissance active (P)
La puissance active totale consommée par une installation triphasée est la somme des puissances actives de chaque phase. [cite_start]L’élève établira la formule générale, valable pour les deux couplages en régime équilibré : . [cite: 618]
4.2. La puissance réactive (Q)
De même, la puissance réactive totale est la somme des puissances réactives par phase. La formule générale est établie.
4.3. La puissance apparente (S)
La puissance apparente triphasée est définie par la relation . L’élève comprendra son importance pour le dimensionnement des transformateurs et des lignes électriques. Le triangle des puissances () reste valable.
4.4. La mesure des puissances (méthode des deux wattmètres)
La méthode des deux wattmètres est présentée comme une technique universelle pour mesurer la puissance active dans un circuit triphasé, qu’il soit équilibré ou non. Le principe du montage et la manière d’interpréter les lectures des deux appareils sont expliqués.
DEUXIÈME PARTIE : LES CIRCUITS MAGNÉTIQUES ET ÉLECTROMAGNÉTIQUES 🧲
Cette partie établit les fondements du magnétisme appliqué à l’électrotechnique. Elle s’intéresse à la manière de créer, de canaliser et d’utiliser les champs magnétiques à des fins industrielles. L’étude des circuits magnétiques, qui sont les analogues magnétiques des circuits électriques, est la première étape. L’application la plus directe de ces principes, l’électroaimant, est ensuite analysée en détail, en se concentrant sur sa capacité à produire des forces mécaniques.
CHAPITRE 5 : LOIS FONDAMENTALES DES CIRCUITS MAGNÉTIQUES
5.1. Constitution d’un circuit magnétique
Un circuit magnétique est un ensemble de matériaux ferromagnétiques destiné à canaliser les lignes de champ magnétique. [cite_start]Sa constitution de base (noyau et enroulement d’excitation) est décrite[cite: 624]. La distinction entre circuits magnétiques homogènes et hétérogènes (avec entrefer) est introduite.
5.2. Grandeurs magnétiques et analogie électrique
Une analogie formelle est établie entre les circuits électriques et magnétiques : la force magnétomotrice () est l’analogue de la f.é.m., le flux magnétique () est l’analogue du courant, et la réluctance () est l’analogue de la résistance.
5.3. La loi d’Hopkinson
La loi d’Hopkinson, ou « loi d’Ohm des circuits magnétiques », est énoncée : . [cite_start]L’élève apprendra à utiliser cette loi pour calculer la réluctance d’un circuit et déterminer le courant d’excitation nécessaire pour produire un flux donné. [cite: 623]
5.4. Calcul de circuits magnétiques avec entrefer
La présence d’un entrefer (une coupure d’air) augmente considérablement la réluctance du circuit. L’élève s’exercera à calculer la réluctance totale d’un circuit hétérogène en additionnant les réluctances du fer et de l’entrefer, un calcul typique pour le dimensionnement des électroaimants et des machines électriques.
CHAPITRE 6 : LES ÉLECTROAIMANTS : CONSTITUTION ET FORCE PORTANTE
6.1. Définition et constitution de l’électroaimant
[cite_start]L’électroaimant est défini comme un dispositif utilisant un courant électrique pour générer un champ magnétique contrôlé[cite: 628]. [cite_start]Sa constitution (une bobine d’excitation enroulée sur un noyau de fer doux) est détaillée[cite: 629].
6.2. Les différents types d’électroaimants
[cite_start]Les principaux types d’électroaimants sont présentés : les électroaimants de levage (utilisés pour manipuler de la ferraille dans le port de Matadi), les électroaimants de commande (pour actionner des vannes ou des contacteurs), et les électroaimants de maintien (pour les serrures magnétiques). [cite: 630]
6.3. La force portante
La force d’attraction exercée par un électroaimant sur une pièce ferromagnétique est étudiée. [cite_start]La formule de la force portante () est introduite, montrant que la force est proportionnelle au carré de l’induction magnétique et à la surface des pôles. [cite: 631]
6.4. Applications des électroaimants
[cite_start]Ce sous-chapitre synthétise les multiples applications des électroaimants dans l’industrie et la vie courante : relais, contacteurs, électrovannes, sonnettes, freins électromagnétiques, tri sélectif des déchets, etc., illustrant l’importance de ce composant de base. [cite: 632]
TROISIÈME PARTIE : LA MACHINE À COURANT CONTINU : PRINCIPES ET CONSTITUTION ⚙️
Cette partie entame l’étude détaillée du premier grand type de convertisseur électromécanique. La machine à courant continu est un dispositif réversible, capable de fonctionner soit en moteur (convertir l’énergie électrique en énergie mécanique), soit en génératrice (dynamo). L’élève y découvrira sa constitution, les principes physiques qui régissent son fonctionnement, et les phénomènes complexes qui se déroulent en son sein, comme la réaction d’induit et la commutation.
CHAPITRE 7 : CONSTITUTION ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE CC
7.1. Description générale de la machine
[cite_start]La machine à courant continu est décrite comme étant composée de deux parties principales : une partie fixe, le stator (ou inducteur), qui crée le champ magnétique, et une partie tournante, le rotor (ou induit), qui est le siège des phénomènes de conversion d’énergie. [cite: 637]
7.2. Le principe de la réversibilité
Le principe de réversibilité est expliqué. L’élève comprendra que la même machine peut, selon la manière dont elle est utilisée, fonctionner en moteur (en appliquant la loi de Laplace) ou en génératrice (en appliquant la loi de Faraday).
7.3. Le rôle du collecteur et des balais
Le système collecteur-balais est présenté comme l’organe caractéristique de la machine à courant continu. [cite_start]Son rôle mécanique est d’assurer la connexion électrique avec le rotor, et son rôle électrique est de redresser les tensions et les courants induits pour qu’ils soient continus vus de l’extérieur. [cite: 639]
7.4. Les différents types d’excitation
La manière dont le champ magnétique de l’inducteur est créé détermine le type de la machine. [cite_start]L’élève apprendra à distinguer l’excitation indépendante (source externe), l’excitation shunt (en parallèle avec l’induit), l’excitation série (en série avec l’induit) et l’excitation compound (mixte). [cite: 648, 656]
CHAPITRE 8 : LE CIRCUIT INDUCTEUR ET LA CRÉATION DU FLUX MAGNÉTIQUE
8.1. Le stator et les pôles inducteurs
Le stator est décrit en détail. Il est constitué d’une carcasse ferromagnétique et de pôles principaux (saillants) sur lesquels sont enroulées les bobines d’excitation qui, parcourues par un courant continu, génèrent le flux magnétique principal.
8.2. Les enroulements d’excitation
Les caractéristiques des enroulements d’excitation sont étudiées en fonction du type de machine. Les enroulements shunt sont constitués de nombreuses spires de fil fin, tandis que les enroulements série sont faits de peu de spires de gros fil.
8.3. La ligne neutre magnétique
La ligne neutre est la position géométrique dans l’entrefer où le champ magnétique créé par l’inducteur est nul. En l’absence de courant dans l’induit, elle se situe à mi-chemin entre deux pôles consécutifs.
8.4. La saturation du circuit magnétique
La relation entre le flux magnétique et le courant d’excitation n’est pas linéaire à cause de la saturation du circuit magnétique du stator. La courbe d’aimantation de la machine est présentée pour illustrer ce phénomène.
CHAPITRE 9 : LE CIRCUIT INDUIT ET LA FORCE ÉLECTROMOTRICE
9.1. Le rotor et ses enroulements
Le rotor est décrit : un cylindre de tôles ferromagnétiques feuilletées, comportant des encoches dans lesquelles sont logés les conducteurs de l’enroulement d’induit. L’extrémité des sections de cet enroulement est connectée aux lames du collecteur.
9.2. La force électromotrice (f.é.m.) induite
Lorsque le rotor tourne dans le champ magnétique, une f.é.m. est induite dans chaque conducteur (phénomène de Faraday). [cite_start]L’élève apprendra à déterminer le sens de cette f.é.m. et à comprendre comment le collecteur permet de sommer les f.é.m. des conducteurs en série. [cite: 638, 640]
9.3. Formule de la f.é.m.
La formule donnant la f.é.m. totale aux bornes de l’induit est établie : (ou plus simplement ). [cite_start]Elle montre que la f.é.m. est proportionnelle à la vitesse de rotation (n) et au flux magnétique (). [cite: 641, 642]
9.4. La f.é.m. en fonctionnement moteur et génératrice
L’élève comprendra que cette f.é.m. existe dans les deux modes de fonctionnement. En génératrice, elle est la source de la tension produite. En moteur, elle s’oppose à la tension d’alimentation et est alors appelée force contre-électromotrice (f.c.é.m.).
CHAPITRE 10 : PHÉNOMÈNES DE RÉACTION D’INDUIT ET DE COMMUTATION
10.1. Le champ magnétique de l’induit
Lorsque la machine débite un courant, les conducteurs de l’induit créent leur propre champ magnétique, appelé champ de réaction d’induit. [cite_start]Ce champ vient se superposer au champ principal créé par l’inducteur. [cite: 644]
10.2. Conséquences de la réaction d’induit
[cite_start]La superposition des deux champs a deux conséquences néfastes : une distorsion du champ résultant dans l’entrefer, qui décale la ligne neutre, et un effet démagnétisant qui peut réduire le flux total. [cite: 645]
10.3. Remèdes à la réaction d’induit
[cite_start]Pour contrer ces effets, des solutions technologiques sont présentées : le décalage des balais (sur les anciennes machines) et, surtout, l’utilisation de pôles auxiliaires de commutation et d’enroulements de compensation logés dans les pôles principaux. [cite: 646]
10.4. Le phénomène de la commutation
La commutation est le processus d’inversion du courant dans une section de l’enroulement d’induit lorsque celle-ci passe sous un balai. [cite_start]Les difficultés liées à cette inversion rapide (phénomènes d’auto-induction) et les problèmes d’étincelles au collecteur sont expliqués, ainsi que le rôle des pôles de commutation pour y remédier. [cite: 647]
QUATRIÈME PARTIE : LES MACHINES À COURANT CONTINU EN FONCTIONNEMENT 🏭
Cette dernière partie analyse le comportement de la machine à courant continu lorsqu’elle est intégrée dans un circuit, que ce soit pour produire de l’énergie (dynamo) ou pour en consommer (moteur). Les caractéristiques externes, qui lient les grandeurs électriques (tension, courant) et mécaniques (vitesse, couple), sont étudiées pour chaque type d’excitation. L’analyse se conclut par l’établissement du bilan des puissances, qui permet de quantifier les pertes et de calculer le rendement de la machine.
CHAPITRE 11 : LA MACHINE CC EN FONCTIONNEMENT GÉNÉRATRICE (DYNAMO)
11.1. L’équation électrique de la dynamo
L’équation de fonctionnement d’une dynamo est établie en appliquant la loi des mailles à son circuit d’induit : la tension aux bornes (U) est égale à la f.é.m. (E) [cite_start]diminuée de la chute de tension dans la résistance de l’induit (). [cite: 643]
11.2. La caractéristique à vide
La caractéristique à vide trace la tension aux bornes de la dynamo en fonction du courant d’excitation, à vitesse constante. [cite_start]Sa forme, qui est directement celle de la courbe d’aimantation du circuit magnétique, est analysée. [cite: 650]
11.3. Les caractéristiques en charge
La caractéristique en charge () montre comment la tension aux bornes de la dynamo évolue lorsque le courant débité augmente. [cite_start]La chute de tension due à la résistance de l’induit et à la réaction d’induit est expliquée. [cite: 651]
11.4. Comparaison des types de dynamos
Les caractéristiques en charge des dynamos à excitation indépendante, shunt et série sont comparées. [cite_start]L’élève comprendra leurs domaines d’application respectifs, par exemple l’utilisation de la dynamo shunt pour la recharge de batteries dans les systèmes de secours des centres de données à Kinshasa. [cite: 648]
CHAPITRE 12 : LA MACHINE CC EN FONCTIONNEMENT MOTEUR : PRINCIPES ET COUPLE
12.1. L’équation électrique du moteur
L’équation électrique du moteur est établie : la tension d’alimentation (U) sert à vaincre la f.c.é.m. (E) [cite_start]et à compenser la chute de tension interne (). [cite: 643]
12.2. Le couple électromagnétique
Le couple moteur est le résultat des forces de Laplace s’exerçant sur les conducteurs du rotor. [cite_start]La formule du couple électromagnétique () est établie, montrant qu’il est proportionnel au flux et au courant d’induit. [cite: 654]
12.3. La puissance électromagnétique
La puissance électromagnétique (), transmise du stator au rotor, est définie. L’élève démontrera la relation fondamentale qui la lie au couple et à la vitesse de rotation : .
12.4. La vitesse de rotation
À partir de l’équation électrique et de la formule de la f.é.m., l’expression de la vitesse de rotation est déduite : . [cite_start]Cette formule est essentielle car elle montre les deux moyens de régler la vitesse d’un moteur CC : en agissant sur la tension d’induit (U) ou sur le courant d’excitation (qui influe sur ). [cite: 654, 655]
CHAPITRE 13 : CARACTÉRISTIQUES ET DÉMARRAGE DES MOTEURS À COURANT CONTINU
13.1. Les caractéristiques électromécaniques et mécaniques
[cite_start]Les principales caractéristiques d’un moteur sont étudiées graphiquement : la caractéristique de vitesse (), la caractéristique de couple () et la caractéristique mécanique (), qui est la plus importante pour le choix d’un moteur. [cite: 660, 661]
13.2. Comparaison des moteurs série et shunt
Les caractéristiques des moteurs série et shunt sont comparées. Le moteur shunt a une vitesse quasi constante, tandis que le moteur série a un très fort couple de démarrage mais une vitesse qui varie énormément avec la charge. [cite_start]Leurs applications spécifiques (machine-outil pour le shunt, traction pour le série) sont déduites. [cite: 662]
13.3. Le problème du démarrage
L’élève comprendra qu’au démarrage (n=0), la f.c.é.m. est nulle, et que si l’on appliquait la pleine tension U, le courant d’induit serait dangereusement élevé. [cite_start]La nécessité d’un dispositif de démarrage pour limiter ce courant est justifiée. [cite: 657]
13.4. Le rhéostat de démarrage
La solution classique, le rhéostat de démarrage, est présentée. Il s’agit d’une résistance variable insérée en série avec l’induit au moment du démarrage, puis progressivement court-circuitée à mesure que la vitesse augmente. [cite_start]Le schéma de raccordement est étudié. [cite: 658]
CHAPITRE 14 : BILAN DES PUISSANCES ET RENDEMENT DES MACHINES CC
14.1. Inventaire des puissances et des pertes
Le cheminement de la puissance à travers la machine est formalisé par un diagramme des flux de puissance (diagramme de Sankey). [cite_start]Les différentes catégories de pertes sont identifiées : pertes électriques par effet Joule (dans l’inducteur et l’induit), pertes magnétiques (dans le fer), et pertes mécaniques (frottements). [cite: 664]
14.2. Bilan de puissance en fonctionnement moteur
Pour le moteur, la puissance absorbée au réseau électrique est la puissance d’entrée. Après soustraction de toutes les pertes, la puissance restante est la puissance utile disponible sur l’arbre.
14.3. Bilan de puissance en fonctionnement génératrice
Pour la génératrice, la puissance mécanique fournie à l’arbre est la puissance d’entrée. Après déduction des pertes, la puissance restante est la puissance électrique utile fournie à la charge.
14.4. Le calcul du rendement
Le rendement est défini comme le rapport de la puissance utile à la puissance absorbée. L’élève s’exercera à calculer le rendement global d’une machine à partir du bilan des puissances. Des méthodes de mesure des pertes par des essais spécifiques (à vide, en court-circuit) sont également introduites.
Annexes
1. Mémento des Formules des Systèmes Triphasés
Cette section fournirait un formulaire complet récapitulant les relations entre tensions et courants pour les couplages étoile et triangle, ainsi que les formules des trois puissances en régime triphasé équilibré.
2. Guide de Câblage des Moteurs CC
Des schémas de câblage clairs et commentés illustreraient le raccordement correct des moteurs à excitation shunt, série et indépendante, incluant le branchement du rhéostat de démarrage et les connexions pour l’inversion du sens de rotation.
3. Tableau Comparatif des Moteurs Électriques
Un tableau synthétique comparerait les caractéristiques principales (vitesse, couple de démarrage, complexité, coût) du moteur à courant continu avec celles des autres grands types de moteurs (asynchrones, synchrones), afin de le positionner dans le paysage global des machines électriques.
4. Analyse du Point de Fonctionnement Mécanique
Ce complément (enrichissement) expliquerait comment déterminer le point de fonctionnement d’un groupe moteur-charge. L’élève apprendrait à superposer sur un même graphique la caractéristique mécanique du moteur () et la caractéristique du couple résistant de la machine entraînée. [cite_start]Le point d’intersection donne la vitesse et le couple de l’ensemble en régime établi. [cite: 663]



