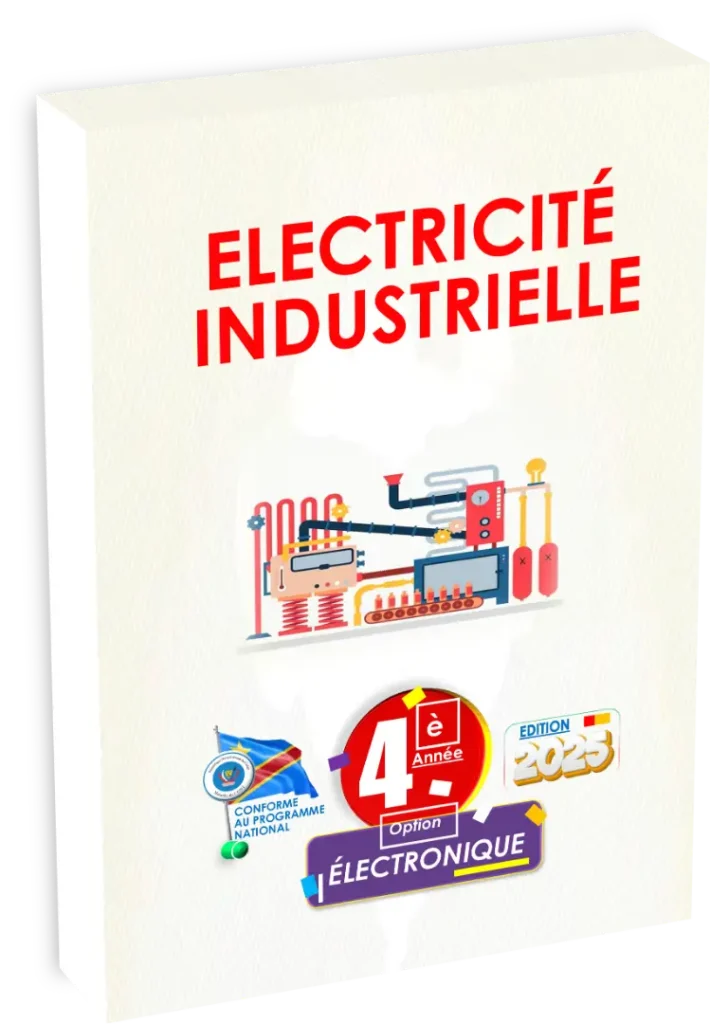
ELECTRICITE INDUSTRIELLE
4ÈME ANNÉE – OPTION ÉLECTRONIQUE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
Préliminaires
1. Objectifs Généraux du Cours
Ce manuel a pour objectif de fournir à l’élève une connaissance approfondie des machines électriques tournantes et des transformateurs, qui constituent le cœur des systèmes de conversion de l’énergie électrique industrielle. Le cours aborde en détail la modélisation et l’analyse du comportement des transformateurs, des alternateurs, ainsi que des moteurs synchrones et asynchrones. Il se conclut par une vision d’ensemble des réseaux électriques, de la production à la commande. La finalité est de former un technicien de haut niveau, capable d’analyser, de choisir et de mettre en œuvre les convertisseurs électromécaniques et statiques dans un environnement industriel.
2. Compétences Visées
Au terme de cette année de formation, l’élève détiendra la capacité de :
- Modéliser un transformateur monophasé et triphasé, déterminer ses caractéristiques par des essais et calculer son rendement.
- Expliquer le fonctionnement d’un alternateur, tracer ses caractéristiques et comprendre les conditions de son couplage au réseau.
- Analyser le fonctionnement du moteur asynchrone, interpréter sa caractéristique mécanique et maîtriser ses différents procédés de démarrage.
- Comprendre l’architecture globale d’un réseau électrique, de la centrale de production jusqu’à l’utilisateur final.
- Concevoir des circuits de commande électromécanique (télécommande, signalisation) à base de contacteurs.
3. Approche Pédagogique
La démarche pédagogique est centrée sur l’étude des convertisseurs d’énergie. Chaque machine est abordée sous un triple angle : sa constitution technologique, les lois physiques qui régissent son fonctionnement, et son modèle mathématique qui permet de prédire son comportement en charge. L’analyse des caractéristiques externes (tension-courant, vitesse-couple) est systématiquement mise en relation avec les applications industrielles. Des études de cas concrets, comme l’analyse des transformateurs de puissance du barrage de Zongo, le choix d’un moteur asynchrone pour un broyeur dans une cimenterie du Kongo Central, ou la conception de la commande d’une station de pompage pour la REGIDESO à Mbuji-Mayi, ancrent les savoirs dans la réalité des infrastructures et de l’industrie congolaises.
PREMIÈRE PARTIE : LE TRANSFORMATEUR STATIQUE ⚡
Cette partie est entièrement consacrée à l’étude du convertisseur d’énergie électrique le plus simple et le plus efficace : le transformateur. Bien qu’il soit statique, il est la pierre angulaire de tout réseau électrique, permettant d’adapter les niveaux de tension pour le transport et la distribution de l’énergie. L’élève y découvrira son principe de fonctionnement, apprendra à le modéliser, à évaluer ses performances et à analyser ses variantes triphasées et spéciales.
CHAPITRE 1 : LE TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ PARFAIT ET RÉEL
1.1. Constitution et principe de fonctionnement
La structure du transformateur (circuit magnétique, enroulements primaire et secondaire) est détaillée. Son principe, basé sur l’induction mutuelle entre deux circuits couplés magnétiquement, est expliqué. L’intérêt de son utilisation pour le transport de l’énergie est justifié.
1.2. Le modèle du transformateur parfait (idéal)
Le modèle du transformateur parfait est introduit comme une première approximation. Les hypothèses (pas de pertes, perméabilité infinie) et les relations fondamentales qui en découlent (rapport de transformation, conservation de la puissance apparente) sont établies.
1.3. Le modèle du transformateur réel en charge
Les imperfections du transformateur réel sont prises en compte : résistance des enroulements et flux de fuite. L’élève apprendra à établir le schéma électrique équivalent ramené au secondaire (modèle de Kapp) et à tracer le diagramme vectoriel des tensions.
1.4. La chute de tension en charge
À partir du diagramme de Kapp, la notion de chute de tension en charge est expliquée. L’élève analysera comment cette chute de tension dépend du courant de charge et du facteur de puissance de la charge (inductive ou capacitive).
CHAPITRE 2 : ESSAIS ET RENDEMENT DU TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ
2.1. L’essai à vide (en circuit ouvert)
L’essai à vide est décrit : on alimente le primaire sous sa tension nominale, le secondaire étant ouvert. L’élève apprendra que cet essai permet de mesurer le rapport de transformation et de déterminer les pertes dans le fer (pertes à tension constante).
2.2. L’essai en court-circuit
L’essai en court-circuit est réalisé en alimentant le primaire sous une tension réduite, le secondaire étant en court-circuit, de manière à faire circuler le courant nominal. Cet essai permet de déterminer les pertes par effet Joule (pertes cuivre) et les éléments du modèle de Kapp.
2.3. Le calcul du rendement
Le rendement d’un transformateur est défini comme le rapport de la puissance de sortie à la puissance d’entrée. L’élève apprendra à le calculer à partir des résultats des deux essais, pour n’importe quel point de fonctionnement, et à déterminer la condition de rendement maximal.
2.4. Le diagramme de Kapp
Le diagramme de Kapp est présenté comme une construction graphique qui permet de déterminer simplement la chute de tension et le rendement d’un transformateur pour n’importe quelle charge, sans calculs complexes.
CHAPITRE 3 : LE TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ : COUPLAGES ET INDICES HORAIRES
3.1. Constitution et types
La constitution des transformateurs triphasés (à colonnes ou cuirassé) est décrite. L’avantage d’utiliser un seul appareil triphasé plutôt que trois appareils monophasés est expliqué.
3.2. Les couplages des enroulements
Les quatre couplages standards des enroulements primaire et secondaire sont étudiés : Étoile (Y), Triangle (D), et Zig-zag (Z). L’élève apprendra à dessiner les schémas de ces couplages.
3.3. Le rapport de transformation et l’indice horaire
Le rapport de transformation d’un transformateur triphasé dépend non seulement des rapports de spires, mais aussi des couplages. La notion d’indice horaire, qui caractérise le déphasage entre les tensions primaire et secondaire, est introduite et sa détermination est expliquée.
3.4. Groupes de couplage
Les transformateurs sont classifiés en groupes de couplage en fonction de leur indice horaire. L’élève apprendra à identifier ces groupes et à comprendre leur importance pour la mise en parallèle.
CHAPITRE 4 : TRANSFORMATEURS SPÉCIAUX ET MISE EN PARALLÈLE
4.1. L’autotransformateur
L’autotransformateur, qui ne possède qu’un seul enroulement avec une prise intermédiaire, est étudié. Ses avantages (plus léger, meilleur rendement) et ses inconvénients (pas d’isolation galvanique) sont analysés, justifiant son usage pour l’interconnexion de réseaux à tensions voisines.
4.2. Les transformateurs de mesure
Les transformateurs de courant (TC) et de tension (TT) sont présentés comme des appareils de précision destinés à ramener les courants et tensions élevés des réseaux à des valeurs faibles et non dangereuses, compatibles avec les appareils de mesure et de protection.
4.3. Conditions de mise en parallèle
Pour augmenter la puissance d’une installation, on peut coupler des transformateurs en parallèle. Les conditions impératives pour un couplage correct sont énoncées : mêmes tensions, même rapport de transformation, même indice horaire et même tension de court-circuit.
4.4. Répartition de la charge
L’élève apprendra comment la charge totale se répartit entre deux transformateurs en parallèle. Il démontrera que si les tensions de court-circuit sont égales, la charge se répartit proportionnellement aux puissances nominales des transformateurs.
DEUXIÈME PARTIE : LA MACHINE SYNCHRONE : ALTERNATEURS ET MOTEURS 🔄
Cette partie est consacrée à l’étude de la machine synchrone, un convertisseur d’énergie réversible dont la vitesse de rotation est rigoureusement liée à la fréquence du réseau auquel elle est connectée. Elle est étudiée dans ses deux modes de fonctionnement : en génératrice, où elle prend le nom d’alternateur et constitue le moyen quasi exclusif de production de l’énergie électrique dans les centrales ; et en moteur, où elle est utilisée pour des applications de forte puissance à vitesse constante.
CHAPITRE 5 : LA MACHINE SYNCHRONE : CONSTITUTION ET PRINCIPE
5.1. Constitution de la machine synchrone
La structure de la machine synchrone est décrite. Elle est composée d’un stator (ou induit) qui porte un enroulement triphasé similaire à celui d’un transformateur, et d’un rotor (ou inducteur) qui est un électroaimant créant le champ magnétique principal et qui est alimenté en courant continu.
5.2. Principe de fonctionnement en alternateur
Le principe de la production d’un système de tensions triphasées est expliqué. En entraînant le rotor à une vitesse constante, son champ magnétique tournant balaye les conducteurs du stator et y induit, par application de la loi de Faraday, trois f.é.m. sinusoïdales et déphasées de 120°.
5.3. Relation entre vitesse et fréquence
La relation fondamentale de synchronisme est établie : la fréquence (f) des tensions produites est directement proportionnelle à la vitesse de rotation (n) du rotor et au nombre de paires de pôles (p) de la machine ().
5.4. Le champ tournant statorique
Inversement, lorsque le stator est alimenté par un réseau triphasé, il crée un champ magnétique tournant à la vitesse de synchronisme. L’élève comprendra que c’est l’interaction entre ce champ tournant et le champ du rotor qui est à la base du fonctionnement en moteur.
CHAPITRE 6 : L’ALTERNATEUR TRIPHASÉ (FONCTIONNEMENT GÉNÉRATRICE)
6.1. Fonctionnement à vide
Le fonctionnement de l’alternateur à vide (non connecté à une charge) est analysé. La f.é.m. induite à vide (E) est directement proportionnelle à la vitesse et au flux, donc au courant d’excitation. La caractéristique à vide () est tracée et interprétée.
6.2. Fonctionnement en charge et réaction d’induit
Lorsqu’il débite un courant, l’induit (stator) crée son propre champ tournant (réaction d’induit) qui vient modifier le champ de l’inducteur. L’effet de cette réaction (magnétisante ou démagnétisante) dépend du déphasage du courant par rapport à la tension.
6.3. Le modèle de Behn-Eschenburg
Pour modéliser le comportement en charge, le modèle de Behn-Eschenburg est introduit. Il représente chaque phase de l’alternateur par sa f.é.m. à vide (E) en série avec une impédance interne appelée réactance synchrone (), qui modélise les effets des flux de fuite et de la réaction d’induit.
6.4. Couplage sur le réseau
Les conditions de couplage d’un alternateur sur le réseau infini d’une centrale comme celle d’Inga sont détaillées : égalité des tensions, des fréquences, des phases et de l’ordre des phases. Les actions sur le courant d’excitation (pour régler la puissance réactive) et sur le couple de la turbine (pour régler la puissance active) sont expliquées.
CHAPITRE 7 : LE MOTEUR SYNCHRONE (FONCTIONNEMENT MOTEUR)
7.1. Principe du couple moteur
Le principe du couple moteur est expliqué comme un « accrochage » magnétique entre le champ tournant créé par le stator et le champ créé par le rotor. L’élève comprendra que ce couple n’existe que si le rotor tourne exactement à la même vitesse que le champ statorique.
7.2. Le problème du démarrage
Le moteur synchrone ne possédant pas de couple de démarrage, des procédés spécifiques sont nécessaires pour l’amener à sa vitesse de synchronisme. Le démarrage asynchrone, utilisant une cage d’écureuil amortisseur sur le rotor, est présenté comme la méthode la plus courante.
7.3. Fonctionnement à couple constant et excitation variable
L’une des caractéristiques les plus remarquables du moteur synchrone est sa capacité à faire varier son facteur de puissance en agissant sur son courant d’excitation. Les courbes en V, qui tracent le courant statorique en fonction du courant d’excitation, sont analysées.
7.4. Le compensateur synchrone
En le faisant fonctionner à vide et surexcité, le moteur synchrone se comporte comme un condensateur de forte puissance. Cette propriété est utilisée dans les grands réseaux industriels, où il prend le nom de compensateur synchrone, pour relever le facteur de puissance global de l’installation.
TROISIÈME PARTIE : LA MACHINE ASYNCHRONE 🏃
Cette partie est dédiée à l’étude de la machine asynchrone, qui est de loin le moteur électrique le plus utilisé dans l’industrie en raison de sa robustesse, de son faible coût et de sa simplicité d’entretien. Son nom provient du fait que sa vitesse de rotation n’est jamais rigoureusement égale à la vitesse du champ tournant. L’élève y découvrira son principe de fonctionnement, analysera sa caractéristique mécanique et maîtrisera les différents procédés de démarrage nécessaires pour limiter l’appel de courant.
CHAPITRE 8 : PRINCIPE DU CHAMP TOURNANT ET STRUCTURE DU MOTEUR ASYNCHRONE
8.1. Le théorème de Leblanc (ou de Ferraris)
Le théorème du champ tournant est énoncé : trois enroulements statoriques décalés de 120° dans l’espace et alimentés par des courants triphasés déphasés de 120° dans le temps génèrent un champ magnétique résultant d’amplitude constante et tournant à la vitesse de synchronisme.
8.2. Constitution du moteur asynchrone
La structure du moteur est décrite. Le stator est identique à celui de la machine synchrone. Le rotor est la partie caractéristique : il ne possède aucune connexion électrique externe et est le siège de courants induits.
8.3. Les deux types de rotors
Les deux technologies de rotor sont présentées. Le rotor à cage d’écureuil, le plus courant, est constitué de barres conductrices court-circuitées par deux anneaux. Le rotor bobiné porte un enroulement triphasé dont les sorties sont connectées à des bagues, permettant d’insérer des résistances externes.
8.4. Principe de fonctionnement et glissement
Le principe est expliqué : le champ tournant statorique induit des courants dans le rotor (comme dans le secondaire d’un transformateur). L’interaction de ces courants avec le champ crée les forces de Laplace qui produisent le couple moteur. L’élève comprendra que pour qu’il y ait induction, le rotor doit tourner à une vitesse légèrement inférieure à celle du champ, cet écart étant quantifié par le glissement (g).
CHAPITRE 9 : ÉTUDE DU FONCTIONNEMENT ET BILAN DES PUISSANCES
9.1. Fréquence des courants rotoriques et f.é.m. induite
L’élève établira que la fréquence des courants induits au rotor est proportionnelle au glissement (). Il analysera également comment la f.é.m. induite au rotor varie avec le glissement.
9.2. Le schéma équivalent monophasé
Le fonctionnement du moteur asynchrone peut être modélisé par un schéma équivalent par phase, très similaire à celui d’un transformateur, mais où la charge du secondaire dépend du glissement.
9.3. Bilan des puissances et diagramme des flux
Le cheminement de la puissance est analysé. La puissance absorbée au stator se divise en pertes statoriques et en puissance transmise au rotor. Cette dernière se divise à son tour en pertes Joule rotoriques et en puissance mécanique. L’élève établira la relation clé : Pertes Joule Rotor = g × Puissance Transmise.
9.4. Couple et rendement
L’expression du couple électromagnétique est établie à partir du bilan de puissances. Le rendement global du moteur est défini. L’élève comprendra comment les différentes pertes affectent l’efficacité de la conversion d’énergie.
CHAPITRE 10 : CARACTÉRISTIQUES ET PROCÉDÉS DE DÉMARRAGE
10.1. La caractéristique mécanique C(n)
La courbe du couple en fonction de la vitesse est la « carte d’identité » du moteur asynchrone. Sa forme caractéristique, avec un couple de démarrage, un couple maximal et un point de fonctionnement stable à faible glissement, est analysée en détail.
10.2. Le problème du démarrage direct
Le démarrage direct d’un moteur asynchrone, en particulier à cage, provoque un appel de courant très important (4 à 8 fois le courant nominal), ce qui peut perturber le réseau électrique. La nécessité de procédés de démarrage à courant réduit est justifiée.
10.3. Les procédés de démarrage statoriques
Les méthodes qui agissent sur la tension d’alimentation du stator sont étudiées : le démarrage étoile-triangle (qui divise le courant et le couple par 3), le démarrage par résistances statoriques et le démarrage par autotransformateur.
10.4. Le démarrage par rhéostat rotorique
Cette méthode, applicable uniquement aux moteurs à rotor bobiné, consiste à insérer des résistances en série avec le rotor au démarrage. L’élève analysera comment cette technique permet d’obtenir un couple de démarrage très élevé avec un appel de courant réduit, une solution privilégiée pour le démarrage de charges très inertielles, comme les grands broyeurs de la Gecamines.
CHAPITRE 11 : LES MOTEURS MONOPHASÉS ET UNIVERSELS
11.1. Le moteur asynchrone monophasé
Le moteur monophasé simple ne possède pas de champ tournant et donc pas de couple de démarrage. L’élève apprendra qu’il faut créer artificiellement un second champ déphasé à l’aide d’un enroulement auxiliaire et d’un condensateur pour lancer le moteur.
11.2. Le moteur universel
Le moteur universel est un moteur série à courant continu spécialement adapté pour fonctionner également en courant alternatif. Sa capacité à atteindre de très grandes vitesses de rotation justifie son utilisation massive dans l’électroportatif (perceuses, meuleuses) et l’électroménager.
11.3. Le moteur à bague de déphasage (spire de Frager)
Cette technologie très simple et économique est utilisée pour les très petits moteurs de ventilateurs ou de pompes. Le principe de la spire de Frager, une boucle de cuivre en court-circuit qui crée un flux déphasé, est expliqué.
11.4. Moteurs particuliers (pas à pas, brushless)
Ce sous-chapitre (enrichissement) introduit brièvement d’autres types de moteurs importants en électronique et en automatisme : le moteur pas à pas, qui tourne d’un angle précis à chaque impulsion, et le moteur « brushless » DC, qui combine la robustesse de l’asynchrone et le contrôle du moteur à courant continu.
Annexes
1. Mémento des Formules des Machines Électriques
Cette section fournirait un formulaire complet récapitulant les équations fondamentales pour chaque machine étudiée : rapports et rendement du transformateur, relation vitesse-fréquence et modèle de Behn-Eschenburg de la machine synchrone, formules du glissement, du couple et des puissances de la machine asynchrone.
2. Guide de Lecture de Plaques Signalétiques de Moteurs
Un guide pratique expliquerait comment décoder toutes les informations figurant sur la plaque signalétique d’un moteur triphasé : puissances, tensions et courants pour les couplages étoile et triangle, vitesse, facteur de puissance, classe d’isolation et indice de protection.
3. Schémas de Câblage pour le Démarrage Étoile-Triangle
Des schémas de puissance et de commande clairs et commentés seraient fournis pour le câblage d’un démarreur étoile-triangle, en version manuelle et automatique (avec temporisateur). Ce montage étant un grand classique, ces schémas serviraient de référence pour les travaux pratiques.
4. Introduction à la Variation de Vitesse Électronique
Ce complément (enrichissement) ouvrirait une perspective sur les solutions modernes de commande de moteurs. Le principe du variateur de fréquence pour moteur asynchrone, qui permet un contrôle souple de la vitesse et des économies d’énergie substantielles, serait introduit, montrant ainsi le lien direct entre l’électricité industrielle et l’électronique de puissance.



