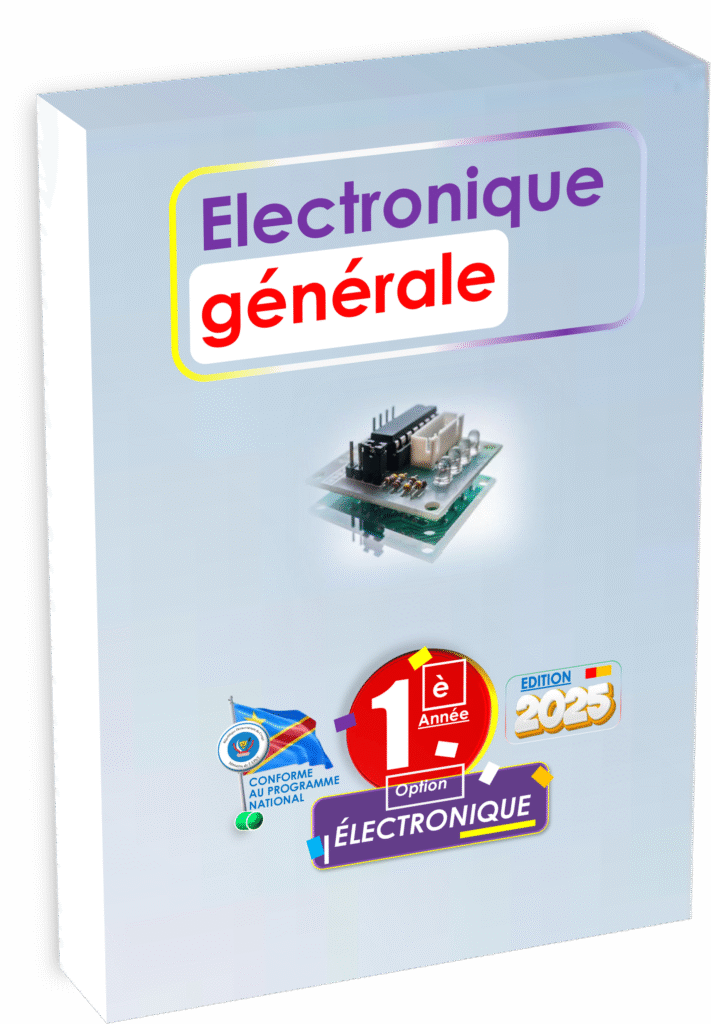
ELECTRONIQUE GENERALE
1ÈRE ANNÉE – OPTION ÉLECTRONIQUE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
Préliminaires
1. Objectifs Généraux du Cours
Ce manuel a pour objectif principal de fournir à l’élève les fondements théoriques de l’électronique, en partant de l’étude de la structure intime de la matière pour aboutir à la compréhension du premier composant actif fondamental : la diode à jonction. La finalité est de construire une base de savoirs solide et cohérente, permettant de démystifier le fonctionnement des semi-conducteurs et de préparer l’élève à l’analyse de circuits électroniques plus complexes dans les années futures.
2. Compétences Visées
À l’issue de cette année d’étude, l’élève détiendra la capacité de :
- Décrire la structure de l’atome et expliquer le rôle des électrons de valence dans la conduction électrique.
- Différencier sur la base de la théorie des bandes d’énergie les matériaux conducteurs, isolants et semi-conducteurs.
- Expliquer le mécanisme de dopage des semi-conducteurs pour obtenir des matériaux de type N et de type P.
- Analyser le comportement d’une jonction P-N en équilibre, en polarisation directe et en polarisation inverse.
- Interpréter la caractéristique courant-tension d’une diode et l’utiliser dans des circuits de redressement simples.
3. Approche Pédagogique
La méthodologie employée est résolument progressive, construisant la connaissance par étapes logiques et interdépendantes. Chaque chapitre s’appuie sur les notions acquises dans le précédent, assurant une ascension conceptuelle sans rupture. L’approche part du modèle physique microscopique pour en déduire le comportement macroscopique des composants. Des analogies et des exemples concrets, tels que l’importance des semi-conducteurs dans les systèmes de gestion de l’énergie solaire pour un village près de Kananga ou le rôle des diodes dans l’alimentation des équipements de télécommunication à Matadi, sont utilisés pour contextualiser le savoir et en faciliter l’assimilation.
PREMIÈRE PARTIE : DE L’ATOME AUX MATÉRIAUX ÉLECTRONIQUES ⚛️
Cette partie fondamentale établit le socle de connaissances en physique des matériaux, indispensable à toute compréhension de l’électronique. L’exploration débute au cœur de la matière, avec l’étude de l’atome et du comportement des électrons, pour ensuite classifier les matériaux selon leur aptitude à conduire le courant électrique. L’objectif est de guider l’élève des concepts de la physique quantique élémentaire jusqu’à l’identification des propriétés uniques des semi-conducteurs, qui sont la pierre angulaire de toute la technologie électronique moderne.
CHAPITRE 1 : STRUCTURE ATOMIQUE ET NIVEAUX D’ÉNERGIE
1.1. Le modèle atomique de Bohr-Rutherford
Ce sous-chapitre présente un modèle planétaire simplifié de l’atome, composé d’un noyau central (protons et neutrons) et d’électrons gravitant sur des orbites définies. Les notions de numéro atomique, de neutralité électrique et d’ionisation par perte ou gain d’électrons sont introduites comme prérequis.
1.2. Couches électroniques et électrons de valence
La répartition des électrons en couches (K, L, M, etc.) et sous-couches énergétiques est détaillée. Une attention particulière est portée à la couche externe, ou couche de valence, car les électrons qui s’y trouvent, appelés électrons de valence, déterminent l’essentiel des propriétés chimiques et électriques du matériau.
1.3. Énergie d’ionisation
L’énergie d’ionisation est définie comme l’énergie minimale requise pour arracher un électron à un atome isolé. Ce concept permet de quantifier la force de la liaison entre le noyau et les électrons de valence, et d’anticiper la facilité avec laquelle un matériau pourra libérer des électrons pour la conduction.
1.4. La théorie des bandes d’énergie
Dans un solide cristallin, les niveaux d’énergie discrets des atomes isolés se transforment en bandes d’énergie continues. Les concepts de bande de valence (où se situent les électrons de valence liés) et de bande de conduction (où les électrons peuvent se mouvoir librement) sont introduits, séparés par une bande interdite.
CHAPITRE 2 : LES ÉLECTRONS DANS LA MATIÈRE : CONDUCTEURS ET ISOLANTS
2.1. Les conducteurs
Dans les matériaux conducteurs, comme le cuivre ou l’aluminium, la bande de valence et la bande de conduction se chevauchent. L’élève comprendra que cette configuration permet aux électrons de valence de passer très facilement dans la bande de conduction, expliquant ainsi leur excellente conductivité électrique.
2.2. Les isolants
Pour les matériaux isolants, tels que le verre ou le plastique, la bande interdite est très large. Une quantité d’énergie considérable est nécessaire pour faire passer un électron de la bande de valence à la bande de conduction. Cette caractéristique explique leur très faible conductivité et leur usage pour la sécurité électrique.
2.3. Mouvement des électrons dans les solides
Le concept de « mer d’électrons » ou de « gaz d’électrons » est utilisé pour décrire le mouvement désordonné des électrons libres dans un conducteur en l’absence de champ électrique. L’application d’une tension impose un mouvement d’ensemble ordonné, appelé courant de dérive, qui constitue le courant électrique.
2.4. Le nombre d’Avogadro et la densité de porteurs
Afin de quantifier le nombre de porteurs de charge potentiels, le nombre d’Avogadro est introduit pour relier l’échelle macroscopique (la mole) à l’échelle microscopique (le nombre d’atomes). L’élève sera initié au calcul de la densité d’atomes et, par extension, de la densité d’électrons libres dans les conducteurs.
CHAPITRE 3 : INTRODUCTION AUX MATÉRIAUX SEMI-CONDUCTEURS
3.1. Définition et position dans la classification
Les semi-conducteurs, comme le silicium (Si) et le germanium (Ge), sont définis comme des matériaux dont la bande interdite est de largeur intermédiaire. À basse température, ils se comportent comme des isolants, mais leur conductivité augmente significativement avec la température ou l’apport d’énergie (lumière).
3.2. Le silicium et le germanium
Les deux semi-conducteurs les plus importants sont étudiés. Leur position dans la colonne IV du tableau périodique, avec quatre électrons de valence, est mise en évidence. La structure cristalline tétraédrique qu’ils forment grâce aux liaisons de covalence est décrite.
3.3. Les liaisons de covalence
L’élève apprendra comment, dans un cristal de silicium, chaque atome met en commun ses quatre électrons de valence avec ses quatre plus proches voisins. Ces liaisons de covalence maintiennent les électrons en place, expliquant le comportement isolant du semi-conducteur pur à très basse température.
3.4. Génération de paires électron-trou
L’agitation thermique peut fournir suffisamment d’énergie pour rompre une liaison de covalence, libérant un électron qui passe dans la bande de conduction. Le départ de l’électron laisse derrière lui un « trou », une charge positive mobile dans la bande de valence. Ce concept de génération de paires électron-trou est le mécanisme de base de la conduction dans les semi-conducteurs.
DEUXIÈME PARTIE : LE COMPORTEMENT DES SEMI-CONDUCTEURS 🔬
Cette partie plonge au cœur de la technologie des semi-conducteurs en expliquant comment leurs propriétés électriques peuvent être contrôlées avec une précision remarquable. L’étude commence par le comportement du semi-conducteur pur (intrinsèque), puis détaille le processus de dopage qui permet de créer des matériaux de type N (riches en électrons) et de type P (riches en trous). L’aboutissement de cette section est la création de la structure la plus fondamentale de l’électronique : la jonction P-N.
CHAPITRE 4 : LES SEMI-CONDUCTEURS INTRINSÈQUES (PURS)
4.1. Conduction par électrons et par trous
Dans un semi-conducteur pur, la conduction est assurée par deux types de porteurs : les électrons libres dans la bande de conduction et les trous dans la bande de valence. Le mécanisme de déplacement des trous par sauts successifs d’électrons de valence est expliqué.
4.2. Équilibre dynamique et recombinaison
La génération de paires électron-trou par l’agitation thermique est un processus continu, mais il est contrebalancé par le phénomène de recombinaison, où un électron libre retombe dans un trou, annulant la paire. L’équilibre dynamique entre ces deux processus détermine la concentration de porteurs à une température donnée.
4.3. La concentration intrinsèque
La concentration d’électrons () est égale à la concentration de trous () dans un semi-conducteur intrinsèque. Cette concentration intrinsèque est une caractéristique du matériau qui dépend très fortement de la température, expliquant pourquoi la conductivité des semi-conducteurs augmente avec la chaleur.
4.4. Le courant dans un semi-conducteur intrinsèque
Le courant total dans un semi-conducteur intrinsèque est la somme du courant dû au déplacement des électrons et du courant dû au déplacement des trous. Ces deux courants s’additionnent, car les électrons et les trous se déplacent en sens opposés sous l’effet d’un champ électrique.
CHAPITRE 5 : LE DOPAGE : SEMI-CONDUCTEURS EXTRINSÈQUES DE TYPE N
5.1. Le principe du dopage
Le dopage est le processus contrôlé consistant à introduire une très faible quantité d’atomes d’impuretés dans un cristal de semi-conducteur pur pour en modifier radicalement la conductivité. Cette technique est le fondement de la fabrication de tous les composants électroniques.
5.2. Les impuretés donatrices (pentavalentes)
Pour créer un semi-conducteur de type N, on dope le silicium avec des atomes de la colonne V (pentavalents), comme le phosphore ou l’arsenic. Ces atomes possèdent cinq électrons de valence.
5.3. Création d’électrons libres
Lorsqu’un atome de phosphore remplace un atome de silicium dans le cristal, quatre de ses électrons de valence participent aux liaisons de covalence. Le cinquième électron est très faiblement lié et devient facilement un électron libre, augmentant massivement le nombre de porteurs négatifs.
5.4. Porteurs majoritaires et minoritaires (Type N)
Dans un semi-conducteur de type N, les électrons sont les porteurs majoritaires et les trous sont les porteurs minoritaires. La conductivité est presque exclusivement assurée par le déplacement des électrons fournis par les atomes donneurs.
CHAPITRE 6 : LE DOPAGE : SEMI-CONDUCTEURS EXTRINSÈQUES DE TYPE P
6.1. Les impuretés acceptrices (trivalentes)
Pour obtenir un semi-conducteur de type P, le silicium est dopé avec des atomes de la colonne III (trivalents), comme le bore ou l’aluminium, qui ne possèdent que trois électrons de valence.
6.2. Création de trous
Quand un atome de bore s’insère dans le réseau cristallin, il lui manque un électron pour compléter ses quatre liaisons de covalence. Ce « vide » ou « trou » peut facilement être comblé par un électron voisin, ce qui revient à créer un trou mobile dans la structure.
6.3. Porteurs majoritaires et minoritaires (Type P)
Dans un semi-conducteur de type P, les trous sont les porteurs majoritaires et les électrons sont les porteurs minoritaires. La conduction électrique est principalement due au mouvement des trous créés par les atomes accepteurs.
6.4. La loi d’action de masse
Même dans un semi-conducteur dopé, la relation reste valable à l’équilibre thermique. Cette loi d’action de masse montre que si la concentration d’un type de porteur augmente (par dopage), la concentration de l’autre type diminue.
CHAPITRE 7 : LA JONCTION P-N : CRÉATION ET BARRIÈRE DE POTENTIEL
7.1. Fabrication de la jonction
La jonction P-N est créée en mettant en contact intime un semi-conducteur de type P et un semi-conducteur de type N au sein d’un même monocristal. Ce processus est généralement réalisé par des techniques de diffusion ou d’implantation ionique.
7.2. Le phénomène de diffusion
À l’instant de la création de la jonction, en raison de la différence de concentration, les électrons majoritaires de la région N diffusent vers la région P, et les trous majoritaires de la région P diffusent vers la région N.
7.3. La zone de déplétion (ou de charge d’espace)
Ce courant de diffusion laisse derrière lui des ions fixes : des ions donneurs positifs dans la région N et des ions accepteurs négatifs dans la région P. Ces charges fixes créent une zone dépeuplée de porteurs mobiles de part et d’autre de la jonction, appelée zone de déplétion.
7.4. La barrière de potentiel
Le champ électrique qui s’établit dans la zone de déplétion s’oppose à la continuation de la diffusion. Ce champ crée une différence de potentiel, appelée barrière de potentiel (environ 0,7V pour le silicium), que les porteurs majoritaires doivent franchir pour traverser la jonction.
TROISIÈME PARTIE : LA DIODE À JONCTION ET SES CARACTÉRISTIQUES 🔌
Cette partie est entièrement dédiée à l’étude du premier composant électronique actif : la diode, qui n’est autre qu’une jonction P-N munie de contacts électriques. L’application d’une tension externe permet de moduler la barrière de potentiel et de contrôler le passage du courant. L’élève analysera en détail le comportement asymétrique de la diode, qui laisse passer le courant dans un sens mais le bloque dans l’autre, et étudiera ses caractéristiques électriques qui sont à la base de toutes ses applications.
CHAPITRE 8 : POLARISATION DE LA JONCTION P-N ET COMPORTEMENT DE LA DIODE
8.1. La jonction non polarisée (à l’équilibre)
Ce sous-chapitre revient sur l’état de la jonction sans tension extérieure appliquée. Le courant de diffusion des porteurs majoritaires est exactement compensé par un faible courant de dérive (ou de fuite) des porteurs minoritaires, résultant en un courant total nul.
8.2. La polarisation directe
L’application d’une tension positive sur la région P (anode) et négative sur la région N (cathode) constitue une polarisation directe. Cette tension s’oppose à la barrière de potentiel, la diminue, et permet un passage massif des porteurs majoritaires à travers la jonction, créant un courant important.
8.3. La polarisation inverse
En inversant la polarité de la tension (négative sur l’anode, positive sur la cathode), on renforce la barrière de potentiel et on élargit la zone de déplétion. Le passage des porteurs majoritaires est bloqué. Seul un très faible courant de fuite, dû aux porteurs minoritaires, peut circuler.
8.4. Identification de l’anode et de la cathode
L’élève apprendra à identifier les deux bornes de la diode, l’anode (A) et la cathode (K), à partir de son symbole schématique et du marquage physique sur le boîtier du composant (généralement une bague du côté de la cathode).
CHAPITRE 9 : CARACTÉRISTIQUES ET PARAMÈTRES DE LA DIODE
9.1. La caractéristique courant-tension
La courbe qui représente le courant traversant la diode en fonction de la tension à ses bornes est sa « carte d’identité ». L’élève apprendra à tracer et à interpréter cette courbe non linéaire, qui montre une croissance exponentielle du courant en polarisation directe et un courant quasi nul en inverse.
9.2. La tension de seuil
La tension de seuil (Vd ou Vf) est la tension directe à partir de laquelle la diode commence à conduire significativement. L’élève retiendra les valeurs typiques de cette tension : environ 0,7 V pour une diode au silicium et 0,3 V pour une diode au germanium.
9.3. Le courant de fuite inverse
Le faible courant qui circule en polarisation inverse est appelé courant de fuite (). Sa valeur est généralement très faible (de l’ordre du nanoampère ou du microampère) mais elle augmente avec la température, ce qui peut être un facteur limitant dans certaines applications sensibles.
9.4. La tension de claquage inverse
Si la tension inverse appliquée dépasse une certaine valeur, appelée tension de claquage (), un courant inverse très important et potentiellement destructeur peut s’établir. L’élève apprendra que ce paramètre, fourni par le constructeur, ne doit jamais être dépassé en usage normal.
CHAPITRE 10 : LE MODÈLE DE LA DIODE IDÉALE ET SES APPLICATIONS SIMPLES
10.1. Le concept de la diode idéale
Pour simplifier l’analyse des circuits, on utilise souvent le modèle de la diode idéale. L’élève apprendra que cette diode est un interrupteur parfait : fermé (court-circuit) lorsqu’elle est polarisée en direct, et ouvert (circuit ouvert) lorsqu’elle est polarisée en inverse.
10.2. Second modèle : la diode idéale avec tension de seuil
Un modèle plus réaliste considère la diode comme un interrupteur en série avec une source de tension égale à sa tension de seuil (0,7 V). Ce modèle, simple à utiliser, donne des résultats très proches de la réalité dans la plupart des circuits.
10.3. Analyse de circuits simples avec le modèle idéal
L’élève s’exercera à analyser des circuits contenant une diode et des résistances. La méthode consiste à faire une hypothèse sur l’état de la diode (passante ou bloquée), à calculer les tensions et courants qui en résultent, puis à vérifier si le résultat est cohérent avec l’hypothèse de départ.
10.4. La diode comme élément de protection
Une application simple et courante de la diode est la protection contre les inversions de polarité. L’élève étudiera comment placer une diode en série avec une alimentation pour protéger un circuit sensible, comme un équipement radio dans un village de l’Équateur, contre un branchement accidentel à l’envers de la batterie.
CHAPITRE 11 : DIODES SPÉCIALES : INTRODUCTION À LA DIODE ZENER
11.1. Le phénomène de claquage Zener et Avalanche
Ce sous-chapitre explique que le claquage en inverse peut être de deux natures : l’effet Zener (pour les faibles tensions) et l’effet d’avalanche (pour les tensions plus élevées). Contrairement au claquage thermique, ces claquages sont réversibles s’ils sont contrôlés.
11.2. La diode Zener
La diode Zener est spécialement conçue pour fonctionner dans sa zone de claquage inverse. Elle présente la particularité de maintenir une tension quasi constante à ses bornes, appelée tension Zener (), sur une large plage de courant inverse.
11.3. Caractéristique et symbole de la diode Zener
La caractéristique courant-tension de la diode Zener est similaire à celle d’une diode standard, mais avec une « cassure » très nette en inverse à la tension . Son symbole schématique spécifique est également présenté.
11.4. L’application en régulation de tension
La propriété la plus importante de la diode Zener est sa capacité à stabiliser une tension. L’élève découvrira le montage de base d’un régulateur « shunt », où une diode Zener est placée en parallèle avec la charge pour lui imposer une tension constante, malgré les variations de la tension d’alimentation.
Annexes
1. Mémento des Grandeurs et Modèles
Cette section fournirait un résumé visuel des concepts clés : la structure des bandes d’énergie pour les différents matériaux, les schémas de liaisons de covalence dans le silicium, et les modèles électriques équivalents de la diode (idéale, avec seuil, etc.). Cet outil servirait de synthèse graphique pour l’ensemble du cours.
2. Fiches Techniques de Diodes Courantes
Des extraits simplifiés de fiches techniques (datasheets) de diodes de redressement (ex: 1N4007) et de diodes Zener (ex: BZX55) seraient présentés. L’élève apprendrait à y retrouver les paramètres étudiés en cours : courant direct maximal (), tension inverse maximale (), tension Zener (), etc.
3. Tableau Périodique des Éléments (Partiel)
Un extrait du tableau périodique mettant en évidence la colonne IV (semi-conducteurs), ainsi que les colonnes III (dopants de type P) et V (dopants de type N), serait fourni. Cet outil visuel aiderait l’élève à mémoriser les éléments clés utilisés en technologie des semi-conducteurs.
4. Guide de Dépannage Élémentaire
Une section proposerait une méthodologie simple pour tester une diode avec un multimètre en position « test de diode » ou « ohmmètre ». Cette compétence pratique est la première étape du diagnostic en électronique, permettant de vérifier rapidement si une jonction P-N est fonctionnelle.