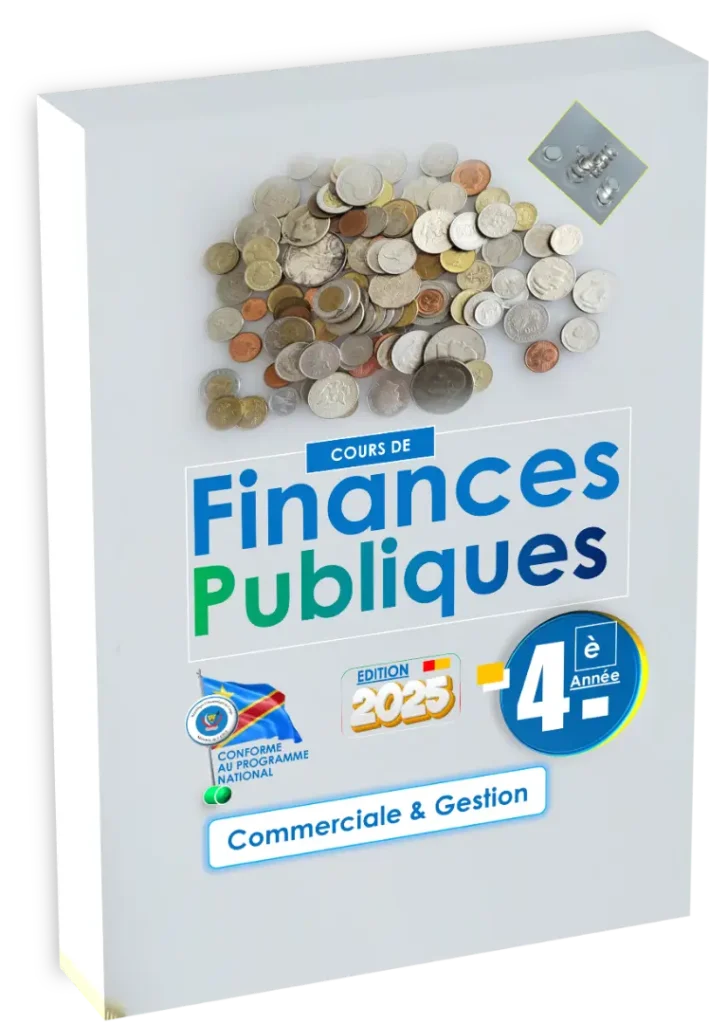
,,
PRÉLIMINAIRES
1. Objectif Terminal d’Intégration (OTI) de la 4ème Année 🎯
Ce préambule énonce la finalité du cours. Au terme de cette année, l’élève doit être capable de comprendre le cycle budgétaire de l’État et des entités décentralisées en République Démocratique du Congo. L’objectif est de former un citoyen et un futur acteur économique éclairé, apte à analyser les mécanismes d’élaboration, d’adoption, d’exécution et de contrôle du budget public. La formation vise à lui donner les clés de lecture pour appréhender comment les impôts et autres recettes de l’État sont collectés et utilisés pour financer les politiques publiques.
2. Compétences Visées 🧠
Cette section articule les savoirs et savoir-faire à acquérir. L’élève doit pouvoir identifier les grands principes budgétaires, décrire les étapes de la procédure budgétaire, distinguer les rôles des différents acteurs (ordonnateurs, comptables publics, organes de contrôle) et comprendre les mécanismes de contrôle de la gestion des finances publiques. Les compétences ciblées incluent l’analyse de la structure d’un budget, la compréhension des phases de la dépense et de la recette publique, et la connaissance des institutions de contrôle comme la Cour des Comptes et l’Inspection Générale des Finances.
3. Stratégies Pédagogiques Proposées 🧑🏫
L’enseignement des finances publiques, par nature technique, doit être rendu concret par l’analyse de documents et de situations réelles. Il est préconisé d’étudier des extraits de la loi de finances de l’année en cours, d’analyser les rapports de la Cour des Comptes, et de débattre des grandes masses budgétaires (éducation, santé, infrastructures). Des cas pratiques peuvent illustrer la chaîne de la dépense, comme le financement d’un projet de réhabilitation de la voirie à Mbuji-Mayi, ou le processus de recouvrement d’une taxe dans la province du Haut-Uele, rendant la matière plus tangible pour les élèves.
Partie 1 : Cadre Conceptuel et Principes des Finances Publiques
Cette première partie a pour objet de poser les fondations théoriques du cours. Elle définit le champ d’étude des finances publiques et présente les grands principes cardinaux qui en régissent l’organisation et le fonctionnement. La maîtrise de ces principes est indispensable pour comprendre la logique de l’ensemble du cycle budgétaire.
Chapitre 1 : Introduction aux Finances Publiques
1.1. Objet et Champ d’Application 🏛️
Ce point initial définit les finances publiques comme l’étude des règles et des opérations relatives aux deniers publics, c’est-à-dire les ressources et les charges de l’État, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Le champ d’application couvre ainsi l’ensemble des activités financières des personnes morales de droit public.
Chapitre 2 : Les Principes Budgétaires Classiques
2.1. Le Principe d’Annualité Budgétaire
Le principe de l’annualité est étudié comme la règle selon laquelle le budget est voté chaque année pour une année. Il impose au gouvernement de solliciter périodiquement l’autorisation du Parlement pour percevoir les impôts et engager les dépenses, garantissant ainsi un contrôle démocratique régulier.
2.2. Le Principe d’Unité Budgétaire
Le principe de l’unité exige que l’ensemble des recettes et des dépenses de l’État figurent dans un document unique, la loi de finances. Cette règle vise à offrir une vision claire et consolidée de la situation financière de l’État, évitant la dispersion des fonds dans des budgets annexes ou des comptes spéciaux non contrôlés.
2.3. Le Principe d’Universalité Budgétaire
Ce principe se décompose en deux règles : la non-compensation (ou non-contraction) des recettes et des dépenses, et la non-affectation des recettes. L’élève apprend que toutes les recettes doivent être inscrites pour leur montant brut et qu’elles servent à couvrir indistinctement l’ensemble des dépenses, sauf dérogation légale expresse.
2.4. Le Principe de Spécialité Budgétaire
Le principe de la spécialité impose que les crédits ouverts par la loi de finances soient détaillés et affectés à des dépenses précises. Le gouvernement ne peut utiliser les fonds alloués pour un objet autre que celui pour lequel ils ont été votés, assurant ainsi le respect de l’autorisation parlementaire.
2.5. Le Principe d’Équilibre Budgétaire
Ce dernier principe, traditionnellement fondamental, postule que le budget doit être présenté en équilibre, les recettes couvrant l’intégralité des dépenses. L’étude porte également sur la signification contemporaine de ce principe et sur les notions de déficit et d’excédent budgétaires.
Partie 2 : L’Élaboration et l’Adoption de la Loi de Finances
Cette deuxième partie se concentre sur la phase politique et administrative de la préparation du budget. Elle décrit le processus complexe par lequel les besoins de la nation sont traduits en chiffres, négociés au sein de l’exécutif, puis soumis à l’approbation du pouvoir législatif.
Chapitre 3 : La Préparation du Budget
3.1. Le Cycle de Préparation Budgétaire ✍️
L’étude détaille la procédure de préparation du projet de loi de finances, pilotée par le Ministère du Budget. Ce processus inclut la lettre de cadrage du Premier Ministre, les conférences budgétaires avec chaque ministère sectoriel pour arbitrer les demandes de crédits, et la consolidation du projet final.
3.2. La Présentation du Budget aux Différents Niveaux de Pouvoir
La distinction est faite entre la procédure applicable au budget du pouvoir central (loi de finances), aux budgets des provinces (édits budgétaires) et à ceux des entités territoriales décentralisées comme la ville de Kananga (décisions budgétaires), en soulignant les compétences de chaque niveau.
Chapitre 4 : L’Adoption de la Loi de Finances
4.1. Le Dépôt et l’Examen du Projet de Loi de Finances 🗳️
Ce point décrit le dépôt du projet de loi de finances par le gouvernement sur le bureau de l’Assemblée Nationale dans les délais constitutionnels. S’ensuit la phase d’examen en commission parlementaire, où le projet est analysé en détail, et les ministres sont auditionnés.
4.2. La Procédure de Vote
L’élève apprend les modalités du vote de la loi de finances par le Parlement (Assemblée Nationale et Sénat). La navette parlementaire en cas de désaccord entre les deux chambres et la promulgation de la loi par le Président de la République concluent ce processus législatif.
Partie 3 : L’Exécution de la Loi de Finances
Cette partie, au cœur de la gestion publique, explique comment les autorisations de dépenses et de recettes votées par le Parlement sont mises en œuvre concrètement par l’administration. Elle est essentielle pour comprendre le fonctionnement quotidien de l’État.
Chapitre 5 : Les Acteurs et les Phases de l’Exécution
5.1. La Séparation des Ordonnateurs et des Comptables Publics
Ce principe fondamental de la comptabilité publique est expliqué en détail. L’ordonnateur est l’administrateur qui décide de la dépense ou constate la recette, tandis que le comptable public est l’agent qui manie les fonds. Cette séparation vise à prévenir les malversations en instaurant un contrôle mutuel.
5.2. Les Phases d’Exécution de la Dépense Publique 📤
La chaîne de la dépense est décomposée en quatre phases successives : l’engagement (acte créant la dette de l’État), la liquidation (vérification de la dette et calcul de son montant), l’ordonnancement (ordre de payer donné au comptable) et le paiement (remise effective des fonds).
5.3. Les Phases d’Exécution de la Recette Publique 📥
La chaîne de la recette est également analysée en trois phases : la constatation (identification du redevable et de la matière imposable), la liquidation (calcul du montant dû) et le recouvrement (encaissement effectif des fonds par le comptable public).
Chapitre 6 : La Gestion Budgétaire
6.1. La Gestion des Crédits Budgétaires
Ce point aborde les techniques de gestion des crédits alloués aux services publics, notamment les notions de reports de crédits et les procédures de régulation budgétaire qui permettent d’ajuster le rythme des dépenses en fonction des rentrées de recettes.
Partie 4 : Le Contrôle de l’Exécution Budgétaire et la Reddition des Comptes
Cette dernière partie est consacrée aux mécanismes de vérification et de responsabilisation qui garantissent la bonne gestion des finances publiques. Elle montre comment l’action de l’administration est soumise à un triple contrôle : interne, juridictionnel et politique.
Chapitre 7 : Les Types de Contrôle
7.1. Le Contrôle Administratif 🧐
Le contrôle administratif est exercé par l’exécutif sur lui-même. L’élève étudie le rôle du contrôle des engagements de dépenses et surtout celui de l’Inspection Générale des Finances (IGF), organe supérieur de contrôle a posteriori de l’ensemble des services publics.
7.2. Le Contrôle Juridictionnel
Ce contrôle est exercé par une juridiction indépendante, la Cour des Comptes. Son rôle est de juger les comptes des comptables publics, de vérifier le bon emploi des crédits et de sanctionner les fautes de gestion.
7.3. Le Contrôle Parlementaire
Le contrôle parlementaire est l’expression du contrôle démocratique. Il s’exerce en cours d’exécution (questions au gouvernement, commissions d’enquête) et surtout a posteriori, lors de l’examen et du vote de la loi de règlement ou loi de reddition des comptes.
Chapitre 8 : La Reddition des Comptes
8.1. Le Projet de Loi de Règlement
La loi de règlement est présentée comme le document qui constate les résultats financiers définitifs de l’année écoulée et qui approuve les différences entre les prévisions du budget initial et l’exécution réelle.
8.2. Le Rôle de la Cour des Comptes dans la Certification des Comptes
Avant d’être soumis au Parlement, le projet de loi de règlement est accompagné du rapport de la Cour des Comptes, qui certifie la régularité et la sincérité des comptes de l’État. Ce rapport est un élément clé pour un vote éclairé des parlementaires.
ANNEXES
1. Structure Simplifiée d’une Loi de Finances
Cette annexe propose une présentation schématique de la structure d’une loi de finances en RDC, avec ses titres dédiés aux recettes, aux dépenses et à l’équilibre général. Elle permet de visualiser l’architecture du document budgétaire.
2. Glossaire des Finances Publiques
Un lexique définit les termes techniques essentiels du cours (ordonnateur, comptable public, engagement, liquidation, régulation budgétaire, reddition des comptes, etc.). Il constitue une référence indispensable pour la maîtrise du vocabulaire spécialisé.
3. Schéma du Cycle Budgétaire Annuel
Un diagramme chronologique illustre les différentes phases du cycle budgétaire sur une année, de la préparation en N-1 jusqu’au contrôle en N+1. Ce support visuel aide à mémoriser la séquence et l’articulation des procédures.



