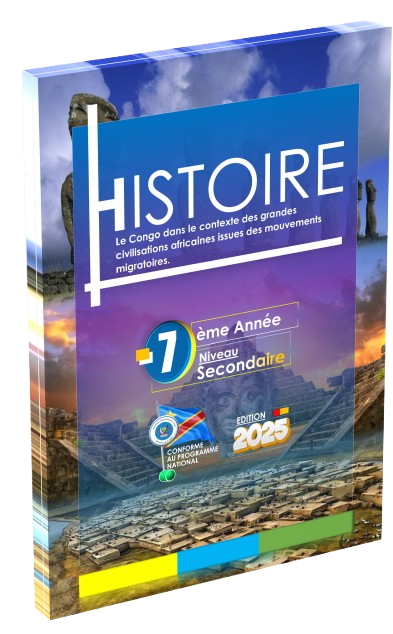
Préliminaires
1. Mode d’emploi du manuel
Ce manuel est conçu comme un outil d’investigation pour l’apprenti historien. Chaque chapitre s’articule autour de compétences à maîtriser, de documents à analyser et de situations-problèmes à résoudre. Il privilégie une approche active où l’élève, guidé par l’enseignant, construit son savoir en interprétant les traces du passé. L’objectif est de dépasser la mémorisation pour développer un raisonnement historique autonome.
2. Objectifs d’apprentissage de la 7ème année
Au terme de cette année, l’élève sera capable de situer les anciennes sociétés du Congo dans le contexte plus large des grandes civilisations africaines. Il maîtrisera les repères chronologiques et spatiaux fondamentaux, expliquera les dynamiques de peuplement du territoire congolais et décrira l’organisation politique, économique et sociale des principaux royaumes et empires qui s’y sont développés avant la période coloniale.
3. Compétences développées
L’étude de l’histoire en 7ème année vise à forger trois compétences intellectuelles majeures :
- L’esprit scientifique 🔬 : Savoir questionner une source, distinguer un fait d’une interprétation et comprendre la démarche de l’historien.
- L’esprit historique ⏳ : Se repérer dans le temps et l’espace, comprendre les notions de continuité et de rupture, et mettre en relation des événements de différentes périodes.
- L’esprit critique 🤔 : Analyser des documents de natures diverses, confronter des points de vue et formuler un jugement argumenté sur des situations historiques complexes.
Partie 1 : Les Fondements de l’Histoire et les Premières Civilisations 🌍
Cette partie introductive établit les bases de la discipline historique. Elle définit ce qu’est l’histoire, présente les outils indispensables à l’historien que sont le temps et l’espace, et explore les origines lointaines de l’humanité sur le continent africain. L’étude de la prestigieuse civilisation égyptienne et de ses liens avec les royaumes du Haut-Nil illustre la profondeur historique et la richesse des sociétés africaines antiques, posant ainsi les premiers jalons pour comprendre l’histoire du Congo.
Chapitre 1 : Introduction à la Science Historique
Ce chapitre fondamental positionne l’histoire comme une science humaine rigoureuse. Il explore son rôle essentiel dans la construction de la mémoire collective et de l’identité citoyenne, en montrant comment la connaissance du passé éclaire les enjeux du présent.
1.1. L’Histoire : Définition, Objet et Utilité
Cette section définit l’histoire comme l’étude scientifique du passé des sociétés humaines. Son objet principal est l’homme en société et son évolution à travers les âges. L’utilité de l’histoire réside dans sa capacité à forger une conscience collective, à expliquer les origines des réalités contemporaines et à développer le discernement. Par exemple, comprendre l’histoire des relations entre les peuples du Kivu permet d’analyser avec plus de justesse les dynamiques actuelles de la région.
1.2. Les Domaines de l’Histoire
Loin de se limiter aux récits de batailles et de rois, l’histoire couvre une multitude de domaines. Sont ici présentés l’histoire politique (étude du pouvoir), l’histoire économique (modes de production), l’histoire sociale (organisation des groupes) et l’histoire culturelle (croyances, arts, techniques), montrant la richesse et la complexité de l’analyse historique.
1.3. Les Sources de l’Information Historique
L’historien travaille à partir de traces du passé appelées « sources ». Cette section classifie les sources en plusieurs catégories : les sources matérielles ou archéologiques (outils, poteries, ruines comme celles de Bumbuli au Nord-Ubangi), les sources orales (récits, témoignages), les sources écrites (chroniques, archives) et les sources iconographiques (peintures rupestres, photos). Leur identification et leur critique sont la base du métier d’historien.
Chapitre 2 : Le Temps et l’Espace en Histoire
La maîtrise des cadres temporel et spatial est une compétence essentielle en histoire. Ce chapitre dote l’élève des outils conceptuels pour mesurer le temps, le représenter et localiser les événements sur une carte.
2.1. Les Notions et la Mesure du Temps
Sont expliquées les unités de mesure du temps utilisées par les historiens : l’année, le lustre (5 ans), la décennie (10 ans), le siècle (100 ans) et le millénaire (1000 ans). La distinction entre le temps court de l’événement et le temps long des civilisations est introduite.
2.2. La Ligne du Temps et les Grandes Périodes
La ligne du temps est présentée comme l’outil visuel permettant d’ordonner chronologiquement les faits. Ce chapitre introduit les quatre grandes périodes conventionnelles de l’histoire (Antiquité, Moyen Âge, Temps Modernes, Époque Contemporaine), en soulignant que cette périodisation est centrée sur l’histoire européenne et doit être adaptée et nuancée pour l’histoire africaine.
2.3. L’Espace Historique : Localisation et Cartographie
Un événement historique se déroule toujours dans un lieu. Cette section enseigne à lire une carte historique pour localiser les foyers de civilisation, les itinéraires de migration ou les limites d’un empire, comme celui des Lunda dont l’influence s’étendait sur une partie de l’Angola, de la Zambie et du sud de la RDC.
Chapitre 3 : Aux Origines de l’Humanité et des Civilisations
Ce chapitre explore les débuts de l’aventure humaine, en mettant en évidence le rôle primordial de l’Afrique. Il définit ensuite le concept de civilisation et analyse le passage fondamental d’un mode de vie nomade à un mode de vie sédentaire.
3.1. L’Afrique, Berceau de l’Humanité
Sur la base des découvertes archéologiques, cette section établit que le continent africain est le lieu d’origine de l’espèce humaine. Les sites des premiers hominidés (en Afrique de l’Est et du Sud) sont présentés, affirmant la contribution fondamentale de l’Afrique à l’histoire universelle.
3.2. La Notion de Civilisation
Une civilisation est définie comme l’ensemble des caractères propres à la vie sociale, culturelle, économique et politique d’une société. Sont abordés les cycles de vie d’une civilisation : naissance, apogée et déclin, illustrés par des exemples.
3.3. La Révolution Néolithique : de la Chasse à l’Agriculture
Cette section décrit le passage de la vie nomade (basée sur la chasse et la cueillette) à la vie sédentaire (permise par l’invention de l’agriculture et de l’élevage). Cette transformation majeure, qui s’est produite à différents moments selon les régions, a entraîné la création des premiers villages et le développement de nouvelles techniques comme la poterie et le tissage.
3.4. L’Invention de l’Écriture
L’écriture marque traditionnellement le passage de la Préhistoire à l’Histoire. Sont présentées les premières formes d’écriture (cunéiforme en Mésopotamie, hiéroglyphes en Égypte) et leur importance pour l’administration des États et la transmission du savoir.
Chapitre 4 : La Civilisation Égyptienne et les Royaumes du Nil 🏛️
Ce chapitre est consacré à l’une des plus brillantes civilisations de l’Antiquité africaine. Il détaille son organisation et met en lumière ses interactions constantes avec d’autres royaumes africains situés en amont du Nil, montrant un monde africain antique dynamique et connecté.
4.1. Cadre Géographique et Historique
L’Égypte antique est présentée comme un « don du Nil ». Son cadre géographique et les grandes étapes de son histoire (Ancien, Moyen et Nouvel Empire) sont exposés, de l’unification par le pharaon Narmer à sa conquête par Rome.
4.2. Organisation Politique, Économique et Sociale
L’organisation de la société égyptienne est décrite : le pharaon, dieu vivant au pouvoir absolu, les scribes, administrateurs de l’État, les prêtres, les soldats et le peuple (paysans et artisans). L’économie, basée sur l’agriculture irriguée, et la structure sociale très hiérarchisée sont expliquées.
4.3. Vie Culturelle, Artistique et Religieuse
La richesse de la culture égyptienne est mise en avant : la religion polythéiste, les rituels funéraires complexes comme la momification, la construction des pyramides et des temples, et les avancées scientifiques en médecine, mathématiques et astronomie.
4.4. Rapports avec les Royaumes du Haut-Nil
L’Égypte n’était pas isolée. Ses relations commerciales, culturelles et parfois conflictuelles avec ses voisins du sud sont explorées : le royaume de Kouch, avec ses capitales Napata et Méroé (dans l’actuel Soudan), et le royaume d’Axoum (en Éthiopie), démontrant l’existence d’un axe de civilisation le long du Nil.
Partie 2 : Peuplement et Formation des Sociétés au Cœur de l’Afrique 🛖
Cette deuxième partie constitue le cœur du programme. Elle se concentre sur les dynamiques qui ont façonné le paysage humain et politique du Bassin du Congo. En partant des grandes migrations qui ont traversé le continent, elle plonge dans l’extraordinaire diversité des sociétés qui se sont constituées sur le territoire de la RDC actuelle, qu’il s’agisse de grands empires structurés ou de sociétés sans pouvoir centralisé mais dotées d’une organisation complexe.
Chapitre 5 : Les Grandes Migrations Africaines
Ce chapitre explique les mouvements de peuples à grande échelle qui ont modelé l’Afrique centrale. Il s’attarde sur les migrations bantoues, un phénomène linguistique et culturel majeur qui a profondément marqué l’histoire du Congo.
5.1. Définition, Causes et Conséquences des Migrations
Les concepts clés sont définis. Les causes des migrations (démographiques, climatiques, politiques) et leurs conséquences (brassage des populations, diffusion de techniques comme la métallurgie du fer, formation de nouvelles identités) sont analysées.
5.2. Le Peuplement du Congo et de l’Afrique
Les grands itinéraires de migration sont tracés sur la carte. Le chapitre explique comment, sur un fond de peuplement pygmée originel, des vagues successives de migrants (bantouphones, nilotiques, soudanais) ont peuplé le continent et le territoire congolais, créant la mosaïque de peuples que nous connaissons aujourd’hui.
Chapitre 6 : Les Sociétés Étatiques du Bassin du Congo 👑
Ce chapitre majeur, le plus dense du programme, présente les grandes formations politiques centralisées qui ont vu le jour dans les savanes du nord et du sud du Congo. Il met en lumière leur organisation sophistiquée et leur rayonnement.
6.1. L’Empire Luba
Situé dans la région du Kasaï et du Katanga, l’Empire Luba est étudié pour son système politique complexe basé sur le « bulopwe » (pouvoir sacré), ses mécanismes de succession et son influence culturelle durable dans toute la région.
6.2. Le Royaume Kongo
Installé à l’embouchure du fleuve Congo, le royaume Kongo disposait d’une administration centralisée, d’une monnaie (le nzimbu) et entretenait des relations diplomatiques avec le Portugal dès le 15ème siècle, comme en témoignent les lettres échangées entre le roi Nzinga a Nkuwu et le roi du Portugal.
6.3. L’Empire Lunda
Voisin et rival de l’Empire Luba, l’Empire Lunda est remarquable par son expansionnisme et son système politique original qui reposait sur des liens de parenté et de tribut. Son influence s’étendait de l’Atlantique à la région des Grands Lacs.
6.4. Le Royaume Kuba
Reconnu pour le raffinement de son art et la complexité de son organisation politique dirigée par le Nyim, le royaume Kuba, dans le Kasaï, illustre la richesse des civilisations de la forêt.
6.5. Les Royaumes du Nord : Mangbetu et Azande
Dans la savane du nord (Haut-Uele), les royaumes Mangbetu et Azande sont présentés. Le royaume Mangbetu est célèbre pour son art de cour et son architecture, tandis que l’empire Azande est étudié pour son organisation militaire et ses conquêtes.
Chapitre 7 : Les Sociétés sans État et Celles de la Zone Interlacustre
Ce chapitre explore d’autres formes d’organisation sociale, montrant que l’absence d’un roi ou d’un empereur ne signifie pas une absence d’ordre. Il couvre les sociétés de la cuvette centrale et celles, très dynamiques, de la région des Grands Lacs.
7.1. Les Sociétés de la Cuvette Centrale
Sont étudiées ici des organisations sociales dites « segmentaires » ou « acéphales », comme celles des Mongo ou des Batetela. Le pouvoir y était diffus, exercé au niveau des lignages ou des classes d’âge, avec des mécanismes de régulation sociale efficaces. La diversité de ces systèmes politiques est mise en avant.
7.2. Les Sociétés de la Zone Interlacustre
La région des Grands Lacs (Kivu) est présentée comme un carrefour de peuples et de cultures. Les organisations politiques des Bashi, des Banande ou des Bafuliru, caractérisées par des royaumes de plus petite taille (chefferies) mais très structurés, sont décrites, en insistant sur leur adaptation à un environnement de hautes terres et leur dynamisme économique.
Partie 3 : Le Congo face au Monde Extérieur 🗺️
Cette dernière partie aborde une phase décisive de l’histoire du Congo : sa rencontre avec le monde extérieur, arabo-musulman à l’est et européen à l’ouest. Elle analyse la nature de ces contacts, leurs conséquences profondes, notamment la traite négrière, et se conclut sur le processus qui a mené à la création de l’État Indépendant du Congo dans le contexte de la compétition coloniale de la fin du 19ème siècle.
Chapitre 8 : Premiers Contacts avec le Monde Extérieur
Ce chapitre analyse les deux fronts par lesquels les sociétés du Congo sont entrées en contact avec des civilisations non africaines, avec des conséquences très différentes.
8.1. Le Contact avec le Monde Européen par l’Ouest
Dès la fin du 15ème siècle, les navigateurs portugais atteignent l’embouchure du fleuve Congo. Sont étudiés la nature de ces premiers contacts avec le royaume Kongo, initialement basés sur le commerce et l’évangélisation, puis leur dérive progressive vers la traite des esclaves qui déstabilisera durablement la région.
8.2. Le Contact avec le Monde Arabo-Swahili par l’Est
À partir du 19ème siècle, des commerçants arabo-swahilis venus de Zanzibar, comme Tippo Tip, pénètrent profondément à l’intérieur du pays (Maniema, Katanga) à la recherche d’ivoire et d’esclaves. Leur impact sur les sociétés locales et la mise en place de véritables États esclavagistes sont analysés.
Chapitre 9 : La Genèse de l’État Indépendant du Congo (EIC)
Ce chapitre final explique comment le territoire du Congo est devenu une possession personnelle du roi des Belges, Léopold II, à l’issue d’un processus diplomatique et militaire complexe.
9.1. Le Congo à la Veille de la Colonisation
L’état des forces en présence à la fin du 19ème siècle est présenté : des royaumes affaiblis par les traites négrières, des zones d’influence arabo-swahilies à l’est, et une compétition grandissante entre les puissances européennes pour le contrôle de l’Afrique centrale.
9.2. Les Explorations et la Création de l’EIC
Le rôle des explorations, notamment celles de Henry Morton Stanley financées par Léopold II, est expliqué. La création de l’Association Internationale du Congo (AIC) et les manœuvres diplomatiques qui ont abouti à la reconnaissance de ce nouvel État lors de la Conférence de Berlin (1884-1885) sont détaillées.
9.3. La Délimitation des Frontières
La manière dont les frontières actuelles de la RDC ont été tracées, souvent de manière arbitraire par des traités entre puissances européennes sans tenir compte des réalités ethniques et politiques locales, est expliquée. Ce tracé est à l’origine de nombreuses dynamiques transfrontalières contemporaines.
Annexes
1. Chronologie Récapitulative
Une frise chronologique détaillée reprend les dates et événements clés étudiés durant l’année, depuis l’apparition des premiers hommes en Afrique jusqu’à la Conférence de Berlin, offrant un outil de révision et de repérage rapide.
2. Glossaire des Termes Historiques
Les définitions claires et précises des concepts et termes techniques utilisés dans le manuel (par exemple : bulopwe, nzimbu, civilisation lithique, céphalie) sont regroupées pour faciliter leur maîtrise par les élèves.
3. Cartes Historiques de Référence
Une série de cartes en couleur illustre les grandes thématiques du cours : les sites des premiers hommes en Afrique, les principaux foyers de civilisation, les grands axes des migrations bantoues, l’emplacement des royaumes et empires du Congo, ainsi que les routes de la traite négrière.
4. Biographies des Personnages Clés
De courtes notices biographiques présentent les acteurs majeurs de l’histoire étudiée, qu’ils soient Congolais (Nzinga a Nkuwu, Shyaam aMbul aNgoong, Msiri) ou étrangers (Narmer, Henry M. Stanley, Léopold II), afin d’incarner le récit historique.



