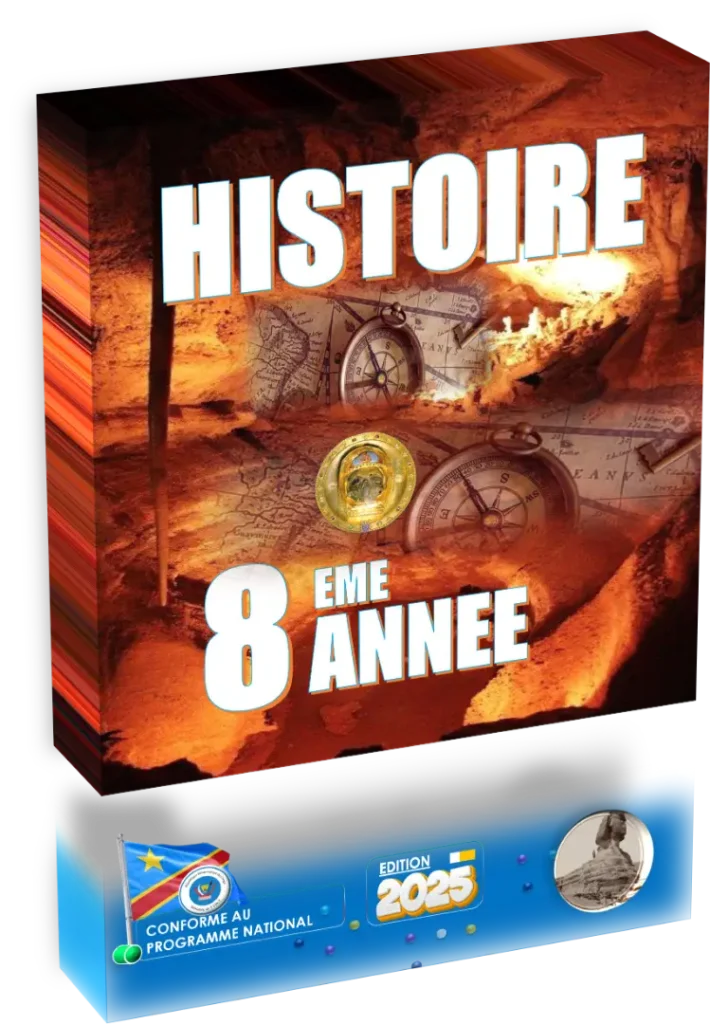
Préliminaires
1. Orientation du cours de 8ème année
Ce manuel explore une période charnière de l’histoire congolaise : celle de ses interactions profondes et souvent violentes avec le monde extérieur, aboutissant à la création et à l’évolution du Congo en tant qu’entité politique moderne. L’objectif est de permettre à l’élève de décrire et d’analyser les grandes étapes de cette évolution, depuis les premiers contacts jusqu’à l’aube de l’indépendance, en développant une perspective critique sur les dynamiques de la colonisation et des résistances.
2. Compétences visées
L’étude de cette période historique a pour but de renforcer des compétences analytiques cruciales. L’élève apprendra à :
- Analyser les conséquences ⚖️ : Évaluer les impacts multiformes (politiques, économiques, sociaux, culturels) des contacts entre des sociétés différentes.
- Expliquer les ruptures et continuités 🔗 : Comprendre comment la colonisation a à la fois brisé les structures anciennes et interagi avec elles.
- Développer l’esprit critique et la confiance en soi 💡 : Porter un regard documenté sur le passé colonial et valoriser les actions des acteurs congolais qui ont résisté à l’oppression et lutté pour l’émancipation.
Partie 1 : L’Afrique et le Congo à la Rencontre du Monde : Contacts, Échanges et Ruptures 🌍
Cette première partie établit le cadre général des relations entre l’Afrique et le reste du monde avant et pendant le début de l’ère coloniale. Après avoir consolidé les outils méthodologiques de l’historien, elle se penche sur la nature des contacts avec l’Asie et l’Europe, en analysant en profondeur la tragédie de la traite humaine. Enfin, elle décrit le processus par lequel les rivalités européennes ont abouti au partage systématique du continent africain, préparant le terrain pour la colonisation du Congo.
Chapitre 1 : Introduction à la Démarche Historique
Ce chapitre initial consolide les acquis de la 7ème année en rappelant les fondements de la discipline. Il vise à équiper l’élève des outils intellectuels nécessaires pour aborder l’étude de périodes complexes avec rigueur et objectivité.
1.1. L’Histoire : Objet, Domaines et Sources
Un rappel est fait sur la définition de l’histoire, son utilité pour le citoyen et la diversité de ses champs d’étude (politique, économique, social). Une attention particulière est portée à la typologie des sources (orales, matérielles, écrites) que l’historien utilise pour reconstituer le passé.
1.2. La Démarche Critique de l’Historien
Cette section détaille les étapes du raisonnement historique : la collecte des sources, la critique externe (authentification du document) et la critique interne (analyse et vérification du contenu). L’objectif est de montrer que l’histoire est une science d’interprétation et non une simple compilation de faits.
Chapitre 2 : L’Intensification des Contacts avec le Monde Extérieur
Ce chapitre analyse la nature et les conséquences des échanges entre l’Afrique et les autres continents, en mettant un accent particulier sur la traite humaine, présentée comme un crime contre l’humanité et une violation fondamentale des droits humains.
2.1. Les Contacts avec le Monde Asiatique et Européen
Sont étudiées les relations anciennes avec les mondes arabe, perse et chinois, principalement axées sur le commerce transsaharien et celui de l’Océan Indien. S’ensuit l’analyse de l’arrivée des Européens sur les côtes africaines et l’établissement des premiers comptoirs commerciaux.
2.2. La Traite Humaine : Origines, Déroulement et Abolition
Le chapitre aborde le système de la traite transatlantique et orientale. Il en explique les origines économiques, le déroulement tragique depuis la capture jusqu’à la vente, et les étapes de son abolition au 19ème siècle, sous la pression des mouvements humanistes et des révoltes d’esclaves.
2.3. Conséquences Démographiques, Sociales et Politiques
L’impact dévastateur de la traite sur les sociétés africaines est analysé : dépopulation de vastes régions, déstabilisation des entités politiques comme le Royaume Kongo, militarisation des sociétés et perte de confiance entre les peuples. Les conséquences économiques, avec l’introduction de produits manufacturés contre des êtres humains, sont également soulignées.
Chapitre 3 : Le Partage et l’Occupation Coloniale de l’Afrique
Ce chapitre explique comment, à la fin du 19ème siècle, les puissances européennes se sont lancées dans une course à la conquête territoriale qui a abouti à la division et à la soumission quasi totale du continent.
3.1. L’Afrique à la Veille de la Conquête
Un état des lieux de l’Afrique au 19ème siècle est dressé, montrant un continent en pleine mutation, avec des États puissants comme le califat de Sokoto ou le royaume d’Éthiopie, mais aussi des régions affaiblies par des conflits internes et la traite.
3.2. Voyages d’Exploration, Missions et Rivalités Européennes
Le rôle des explorateurs, qui ont cartographié l’intérieur du continent, et des missionnaires, qui ont servi de pionniers à l’influence européenne, est examiné. Les rivalités croissantes entre la France, le Royaume-Uni, le Portugal et la Belgique de Léopold II pour le contrôle de points stratégiques comme le bassin du Congo sont mises en évidence.
3.3. La Conférence de Berlin (1884-1885) et ses Conséquences
La Conférence de Berlin est présentée comme l’acte qui a officialisé et réglementé le partage de l’Afrique. Ses décisions, notamment la liberté de navigation sur les fleuves Congo et Niger et la nécessité d’une « occupation effective » pour revendiquer un territoire, ont accéléré la conquête. Le caractère arbitraire des frontières tracées, qui séparent des peuples ou en regroupent de force, est souligné comme une source de problèmes persistants.
3.4. Les Systèmes Coloniaux
Une brève comparaison est établie entre les principaux systèmes coloniaux mis en place : le système britannique de l’« indirect rule » (administration indirecte) et le système français de l’assimilation et de l’administration directe, qui a également inspiré le modèle belge.
Partie 2 : Le Congo Colonisé : Administration, Résistances et Décolonisation 🇨🇩
Cette seconde partie se concentre spécifiquement sur l’histoire du territoire congolais sous la domination étrangère. Elle retrace la création de l’État Indépendant du Congo, sa transformation en colonie belge, et analyse en détail les formes multiples de résistance que les Congolais ont opposées à cette occupation. Le parcours s’achève sur l’étude des facteurs internes et externes qui ont conduit le pays à l’indépendance en 1960.
Chapitre 4 : L’Implantation du Pouvoir Colonial au Congo
Ce chapitre est consacré à la mise en place de la structure coloniale au Congo, depuis le projet personnel du roi Léopold II jusqu’à l’apogée de l’administration belge.
4.1. La Genèse de l’État Indépendant du Congo (EIC)
Sont détaillées les étapes de la création de l’EIC, fruit de l’ambition de Léopold II et de ses manœuvres diplomatiques. Le rôle de l’exploration de Stanley et la mise en place des premières stations, comme celle de Vivi près de Matadi, sont expliqués.
4.2. Le Congo sous la Domination Belge : Les Trois Phases
L’évolution de la colonie est présentée en trois périodes distinctes :
- Première phase (1908-1918) : La restructuration de la colonie après sa reprise par la Belgique, suite aux scandales internationaux liés aux exactions de l’EIC, notamment la collecte forcée du caoutchouc dans la région de l’Équateur.
- Deuxième phase (1918-1945) : L’apogée de la colonisation, marquée par la mise en valeur économique intensive (mines au Katanga, agriculture au Kivu et dans la Province Orientale), la construction d’infrastructures et la consolidation de l’administration.
- Troisième phase (1945-1960) : La marche progressive vers l’indépendance, une période de réformes politiques et sociales tardives en réponse à la montée des revendications congolaises et au contexte international de la décolonisation.
Chapitre 5 : Les Multiples Visages de la Résistance Congolaise
Contrairement à l’image d’une soumission passive, ce chapitre met en lumière la constance et la diversité des résistances congolaises face à l’occupation, des révoltes armées aux luttes politiques et spirituelles.
5.1. Les Résistances sous l’État Indépendant du Congo
L’opposition à la pénétration léopoldienne fut immédiate. Sont étudiées les résistances menées par des chefs puissants comme M’Siri du royaume Yeke au Katanga, les révoltes des populations soumises au travail forcé, et les importantes mutineries de la Force Publique, comme la révolte dite des « Batetela » de Luluabourg.
5.2. Les Résistances Armées sous la Colonisation Belge
La « pacification » du territoire par les Belges s’est heurtée à de nombreuses révoltes menées par des chefs coutumiers refusant l’impôt et le travail forcé. Les exemples de la révolte des Pende dans l’ex-province du Bandundu (1931) ou des Mbuza dans l’ex-province de l’Équateur sont analysés.
5.3. Les Résistances Messianiques et Spirituelles
Face à la domination culturelle et religieuse, des mouvements prophétiques ont émergé comme une forme de résistance spirituelle. Le chapitre se concentre sur la prédication de Simon Kimbangu dans le Kongo Central, qui a donné naissance à un vaste mouvement social et religieux durement réprimé par le pouvoir colonial, ainsi que sur le Kitawala dans le sud-est du pays.
5.4. Les Résistances Sociales et Politiques Modernes
Les nouvelles formes de contestation qui apparaissent dans les centres urbains sont explorées : les grèves ouvrières, comme celles de l’Union Minière du Haut-Katanga, et l’action des premières associations d’ « évolués », comme l’Union Congolaise de Paul Panda Farnana, qui formula les premières revendications politiques modernes.
Chapitre 6 : Le Processus de Décolonisation du Congo
Le dernier chapitre analyse la convergence de facteurs qui, après la Seconde Guerre mondiale, a rendu l’indépendance inéluctable et rapide.
6.1. Les Causes Externes de la Décolonisation
L’affaiblissement des puissances coloniales après la guerre, la politique anti-coloniale des deux nouvelles superpuissances (États-Unis et URSS), l’action de l’ONU en faveur du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et l’exemple des indépendances en Asie (Conférence de Bandung, 1955) ont créé un contexte international favorable.
6.2. Les Causes Internes et l’Éveil de la Conscience Nationale
Cette section met l’accent sur le rôle des acteurs congolais : l’action des intellectuels « évolués » et la publication de manifestes comme celui de la revue « Conscience Africaine » en 1956, la création des premiers partis politiques (ABAKO, MNC, etc.), et l’impact de la participation de leaders congolais à l’Exposition universelle de Bruxelles en 1958, qui leur a permis de nouer des contacts et de prendre conscience des réalités politiques européennes.
Annexes
1. Chronologie de la Période Coloniale
Une ligne du temps détaillée présente les dates marquantes de 1876 (début des ambitions de Léopold II) à 1960 (indépendance), incluant les dates des grandes révoltes, des réformes importantes et de la création des partis politiques.
2. Biographies des Acteurs Clés
De courtes notices biographiques permettent de mieux connaître les figures centrales de cette période : Léopold II, H.M. Stanley, Simon Kimbangu, Paul Panda Farnana, Kasongo Nyembo et les pères de l’indépendance.
3. Glossaire
Définition des termes et concepts importants : Force Publique, évolué, messianisme, indirect rule, paternalisme, chefferie, etc.
4. Cartographie du Congo Colonial
Une série de cartes pour visualiser :
- Le partage de l’Afrique après la Conférence de Berlin.
- Les principales zones d’exploitation économique au Congo Belge (zones minières, agricoles, caoutchouc).
- Les foyers des grandes résistances et révoltes.



