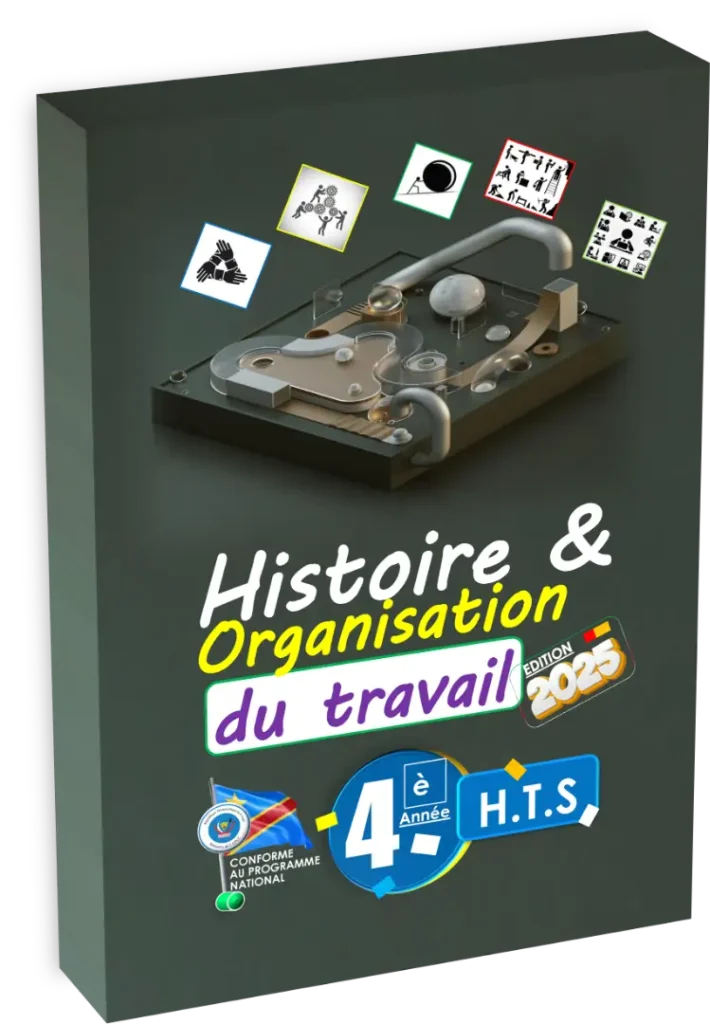
COURS D’HISTOIRE DU TRAVAIL ET ORGANISATION PROFESSIONNELLE, 4ème année, option TECHNIQUES SOCIALES
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
Préliminaires
1. Objectifs du cours
L’objectif fondamental de ce cours est de doter les élèves d’une perspective historique et sociologique sur le monde du travail, en retraçant l’évolution des formes d’activité humaine et des modes d’organisation collective qui en découlent. 🛠️ L’élève apprendra à analyser les rapports sociaux de production, à comprendre l’émergence des organisations professionnelles et à situer les enjeux actuels du dialogue social en RDC dans une trajectoire de longue durée, afin de mieux appréhender les dynamiques du milieu professionnel où il sera amené à intervenir.
2. Directives méthodologiques
Une approche pédagogique combinant le récit historique et l’analyse sociologique structure ce cours. Le professeur s’appuiera sur des documents d’époque, des études de cas et des visites de terrain auprès d’organisations syndicales ou patronales pour rendre l’histoire vivante et les concepts concrets. ✍️ La méthode inductive sera privilégiée pour la partie sur l’organisation professionnelle, en partant de l’observation du paysage syndical congolais actuel pour en déduire les principes généraux et les modes de fonctionnement.
3. Compétences visées
À l’issue de cette formation, l’élève sera en mesure de :
- Décrire les grandes étapes de l’histoire du travail, de l’esclavage à l’ère industrielle.
- Expliquer les conséquences sociales de la révolution industrielle et la naissance du mouvement ouvrier.
- Analyser la structure et le rôle des organisations professionnelles (syndicats, patronat).
- Comprendre l’histoire et les caractéristiques du paysage syndical en RDC.
- Situer les enjeux des relations entre le capital, le travail et l’État dans différents régimes.
- Porter un regard critique sur les défis contemporains du monde du travail.
4. Outils et supports didactiques
La transmission des savoirs mobilisera une diversité de supports pour illustrer l’évolution du travail. 📜 Seront utilisés des textes historiques, des extraits de conventions collectives, des statuts d’organisations syndicales, des articles de presse sur des conflits sociaux, ainsi que des documentaires sur l’histoire industrielle ou les mouvements sociaux.
Partie I : Le Travail et son Organisation dans les Sociétés Préindustrielles
Cette première partie explore les formes de travail et les rapports sociaux qui ont caractérisé les sociétés avant les grands bouleversements de la révolution industrielle. De l’Antiquité au déclin du système corporatiste, elle analyse comment le travail était organisé et vécu, en lien direct avec les structures sociales et politiques de l’époque.
Chapitre 1 : Introduction et Concepts Fondamentaux
1.1. Définition du travail comme activité humaine et fait social
Le travail est présenté comme une activité de transformation de la nature visant à satisfaire des besoins, mais aussi comme un fait social total qui structure l’identité, les relations sociales et le temps.
1.2. Définition de l’organisation professionnelle
L’organisation professionnelle est définie comme tout groupement permanent de personnes exerçant une même profession ou des métiers connexes, constitué en vue de la défense de leurs intérêts communs, matériels et moraux.
1.3. L’évolution des outils et son impact sur l’organisation sociale
Cette section établit un lien direct entre le niveau de développement technique et les formes d’organisation du travail. L’évolution de l’outil, de la pierre taillée à l’araire, a constamment remodelé les rapports sociaux de production.
1.4. La dialectique du conflit et de la coopération
Les relations de travail sont analysées à travers une tension permanente entre la nécessité de coopérer pour produire et l’existence de conflits liés à la répartition des fruits de ce travail et à l’exercice de l’autorité.
Chapitre 2 : Le Travail dans l’Antiquité et le Servage
2.1. L’esclavage comme mode de production dominant
L’esclavage est étudié comme un système où le travailleur est lui-même une marchandise, propriété de son maître. Ce mode de production a été le fondement des grandes civilisations de l’Antiquité.
2.2. Le travail libre dans l’Antiquité
À côté de l’esclavage, des formes de travail libre existaient. Le cours se penche sur le statut des petits propriétaires terriens et des artisans indépendants qui animaient l’économie des cités antiques.
2.3. Le passage au servage dans le système féodal
Le servage est présenté comme le rapport de production caractéristique du Moyen Âge européen. Le serf, attaché à une terre, n’est pas une marchandise mais reste sous la dépendance économique et juridique de son seigneur.
2.4. Les premières formes de conflits du travail
Même dans ces sociétés très hiérarchisées, des formes de résistance et de conflit existaient. Sont étudiées les révoltes d’esclaves dans l’Antiquité et les jacqueries paysannes au Moyen Âge comme expressions de ces tensions.
Chapitre 3 : Le Travail Agricole et Artisanal au Moyen Âge
3.1. L’organisation du travail agricole
Les différents statuts du paysan médiéval sont examinés : le fermage (location de la terre contre un loyer fixe) et le métayage (partage des récoltes avec le propriétaire) sont distingués du travail des journaliers agricoles.
3.2. L’émergence des corporations de métiers
Avec la renaissance des villes, le travail artisanal s’organise en corporations. Ces groupements professionnels réglementent l’accès au métier, les techniques de production et la commercialisation des produits.
3.3. La structure des corporations
La hiérarchie interne des corporations est détaillée. L’élève apprend à distinguer le statut de l’apprenti, qui apprend le métier, du compagnon (ou ouvrier), qui est un salarié, et du maître, qui est un patron indépendant membre de la corporation.
3.4. La réglementation du travail et le rôle social
Les corporations édictaient des règles strictes sur la qualité des produits, les prix et les salaires. Elles jouaient aussi un rôle social important, assurant une forme de protection sociale et d’assistance mutuelle à leurs membres.
Chapitre 4 : La Crise et la Fin du Modèle Corporatiste
4.1. L’intervention du pouvoir royal
À partir de la fin du Moyen Âge, le pouvoir royal cherche à contrôler les corporations pour des raisons fiscales et politiques, ce qui entraîne une sclérose et une fermeture progressive de ces organisations.
4.2. L’affaiblissement des corporations
Le système corporatiste devient de plus en plus rigide et fermé, rendant l’accès à la maîtrise très difficile pour les compagnons et freinant l’innovation technique, ce qui le met en décalage avec les nouvelles dynamiques économiques.
4.3. L’émergence du travail libre et de la manufacture
En marge des corporations, de nouvelles formes de production se développent, comme le travail à domicile et les premières manufactures, qui regroupent des ouvriers sans statut corporatiste et annoncent la révolution industrielle.
4.4. La disparition des corporations
La Révolution française, avec la loi Le Chapelier de 1791, porte le coup de grâce au système corporatiste en interdisant toute forme de groupement professionnel, au nom de la liberté du travail et de l’individualisme libéral.
Partie II : L’Ère de la Machine et les Mouvements Sociaux
Cette deuxième partie analyse la rupture majeure introduite par la révolution industrielle. Elle décrit la naissance du travail moderne en usine, les profondes conséquences sociales de ce nouveau mode de production, et l’émergence du mouvement ouvrier comme réponse collective à la « question sociale ».
Chapitre 5 : La Révolution Industrielle et le Travail Moderne
5.1. L’essor industriel au XVIIIe siècle et le machinisme
La révolution industrielle est présentée comme une rupture technologique majeure, marquée par l’invention de la machine à vapeur et la mécanisation de la production, d’abord dans le textile puis dans toute l’industrie.
5.2. La concentration industrielle et commerciale
Le machinisme entraîne la concentration du capital et des travailleurs dans de grandes unités de production : les usines. Ce phénomène, couplé à l’essor du commerce, transforme radicalement le paysage économique et social.
5.3. Les nouvelles conditions matérielles du travail
Le travail en usine impose une nouvelle discipline : horaires stricts, cadences imposées par la machine, environnement de travail souvent insalubre et dangereux.
5.4. La rationalisation du travail
La recherche de l’efficacité conduit à une nouvelle organisation du travail, basée sur la division des tâches. Chaque ouvrier est assigné à une opération parcellaire et répétitive, perdant la maîtrise de l’ensemble du processus de production.
Chapitre 6 : Les Conséquences Sociales de l’Industrialisation
6.1. La formation de la classe ouvrière
L’exode rural et la concentration industrielle donnent naissance à une nouvelle classe sociale : le prolétariat, qui ne possède que sa force de travail pour vivre et la vend à la classe des capitalistes, propriétaires des moyens de production.
6.2. La « question sociale »
La « question sociale » désigne l’ensemble des problèmes de misère, de précarité et de mauvaises conditions de vie et de travail qui affectent massivement la nouvelle classe ouvrière au XIXe siècle, créant une situation sociale explosive.
6.3. L’apparition des classes sociales
L’industrialisation accentue la division de la société en classes sociales définies par leur position économique. L’antagonisme entre la bourgeoisie capitaliste et le prolétariat ouvrier devient le conflit central des sociétés industrielles.
6.4. Le travail des femmes et des enfants
La recherche du profit maximum conduit à l’exploitation massive de la main-d’œuvre la moins chère : les femmes et les enfants, qui subissent des conditions de travail particulièrement pénibles pour des salaires dérisoires.
Chapitre 7 : Les Mouvements Ouvriers dans le Monde
7.1. Les origines du syndicalisme en Angleterre
C’est en Angleterre, berceau de la révolution industrielle, que naissent les premières formes d’organisation ouvrière : les Trade Unions. ✊ Le cours retrace leurs luttes pour la reconnaissance du droit d’association et de grève.
7.2. Les mouvements ouvriers en France et en Allemagne
Le développement du mouvement ouvrier sur le continent européen est étudié, avec ses spécificités nationales. En France, il est fortement marqué par les révolutions politiques, tandis qu’en Allemagne, il est étroitement lié à l’émergence des partis socialistes.
7.3. Le syndicalisme aux États-Unis
Le syndicalisme américain se développe dans un contexte différent, marqué par l’immigration massive et des conflits souvent très violents. L’émergence de grandes fédérations comme l’American Federation of Labor (AFL) est analysée.
7.4. La Première Association Internationale des Travailleurs
Fondée en 1864, l’AIT (ou Première Internationale) est la première tentative de créer une organisation ouvrière à l’échelle mondiale, affirmant le principe de la solidarité internationale des travailleurs : « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! ».
Partie III : Les Organisations Professionnelles en RDC
Cette troisième partie applique la grille d’analyse historique et sociologique au contexte spécifique de la République Démocratique du Congo. Elle retrace l’histoire du mouvement syndical national, décrit le paysage actuel des organisations de travailleurs et d’employeurs, et analyse les défis des travailleurs indépendants.
Chapitre 8 : L’Histoire du Mouvement Syndical au Congo
8.1. Les premières associations professionnelles à l’époque coloniale
Les origines du syndicalisme congolais sont retracées, depuis les premières associations réservées aux agents européens de la colonie jusqu’à l’émergence timide d’associations pour le personnel « indigène », étroitement contrôlées par l’administration.
8.2. Le pluralisme syndical à l’indépendance
La période de l’indépendance (1960-1965) est marquée par une effervescence et une fragmentation du paysage syndical, avec la création de nombreuses organisations souvent liées à des partis politiques ou à des courants idéologiques internationaux.
8.3. Le syndicalisme sous la Deuxième République
Avec l’instauration du parti-État, le pluralisme syndical est supprimé au profit d’un syndicat unique, l’Union Nationale des Travailleurs du Zaïre (UNTZa), qui devient une courroie de transmission du pouvoir.
8.4. Le renouveau du pluralisme syndical
Le processus de démocratisation des années 1990 entraîne la fin du monopole de l’UNTZa et la renaissance du pluralisme syndical. De nouvelles confédérations se créent, restaurant la liberté d’association pour les travailleurs congolais.
Chapitre 9 : Le Paysage Syndical Congolais Actuel
9.1. Les grandes confédérations syndicales
Le paysage actuel est caractérisé par l’existence de plusieurs grandes centrales syndicales. 🇨🇩 Le cours présente les principales d’entre elles, comme l’Union Nationale des Travailleurs du Congo (UNTC), la Confédération Syndicale du Congo (CSC) et la Confédération Démocratique du Travail (CDT).
9.2. L’organisation et la structure des syndicats
L’élève étudie la structure pyramidale des organisations syndicales, depuis la section syndicale dans l’entreprise jusqu’aux fédérations professionnelles par secteur d’activité et aux confédérations interprofessionnelles au niveau national.
9.3. Les moyens d’action syndicale
Les principaux outils de l’action syndicale sont analysés : la négociation collective, qui vise à conclure des conventions avec le patronat, et la grève, qui constitue le moyen de pression ultime en cas d’échec des négociations.
9.4. Le rôle de la délégation syndicale
La délégation syndicale est l’organe qui représente les travailleurs syndiqués au sein de l’entreprise. Son rôle est de présenter les revendications, de veiller à l’application du droit du travail et de participer au dialogue social avec l’employeur.
Chapitre 10 : Les Organisations Patronales et des Indépendants
10.1. L’histoire et le rôle des organisations d’employeurs
Les organisations patronales sont les structures qui représentent et défendent les intérêts des entreprises. Leur rôle est d’être l’interlocuteur du gouvernement et des syndicats dans le cadre du dialogue social.
10.2. La Fédération des Entreprises du Congo (FEC)
La FEC est présentée comme la principale organisation patronale de la RDC. 🏢 Elle regroupe la majorité des grandes entreprises du pays et joue un rôle majeur dans les négociations sur les questions économiques et sociales.
10.3. Les organisations des professions indépendantes
Le cours se penche sur la représentation des artisans, des petits commerçants et des professions libérales. Ces organisations visent à défendre les spécificités de ces acteurs et à promouvoir leur développement.
10.4. Les défis des classes moyennes et du secteur informel
La difficulté de structurer et de représenter le vaste secteur informel, qui constitue l’essentiel de l’économie à Kinshasa comme dans d’autres villes, est analysée comme un défi majeur pour l’organisation professionnelle et le dialogue social en RDC.
Partie IV : Principes et Dynamiques des Relations Professionnelles
La dernière partie du cours adopte une approche plus thématique et comparative. Elle synthétise les grands principes de l’organisation professionnelle, analyse les activités des partenaires sociaux et explore les différents modèles de relations entre le capital, le travail et l’État à travers le monde et en RDC.
Chapitre 11 : Les Fondements de l’Organisation Professionnelle
11.1. La nécessité et la définition de l’organisation professionnelle
L’organisation professionnelle est justifiée par la nécessité de rééquilibrer le rapport de force inégal entre l’employeur individuel et le salarié isolé. Elle est un élément d’équilibre et de régulation essentiel dans une société démocratique.
11.2. Le principe de la liberté syndicale
La liberté syndicale, garantie par la Constitution et les conventions internationales, est un droit humain fondamental. Elle inclut le droit pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier librement.
11.3. Les principes fondamentaux
Les objectifs des organisations professionnelles sont doubles : la recherche du progrès social (amélioration des conditions de vie et de travail) et la promotion du bien-être économique (participation équitable aux fruits de la croissance).
11.4. La responsabilité sociale
Les organisations professionnelles ont une responsabilité qui dépasse la seule défense des intérêts de leurs membres. Elles sont des acteurs de la société civile et ont un rôle à jouer dans la promotion de l’intérêt général et du développement national.
Chapitre 12 : Les Activités des Organisations de Salariés
12.1. La participation à l’élaboration de la législation sociale
Les syndicats sont des partenaires consultés par le gouvernement lors de la préparation des lois et des règlements en matière de travail et de sécurité sociale, assurant ainsi que la voix des travailleurs soit entendue.
12.2. La négociation collective
La négociation collective est l’activité centrale des syndicats. 🤝 Elle vise à conclure des conventions collectives qui fixent les conditions de travail et les grilles de salaires pour une branche d’activité ou une entreprise.
12.3. La représentation des travailleurs
Les syndicats représentent les travailleurs dans de nombreuses instances, comme les conseils d’administration des organismes de sécurité sociale (CNSS) ou les conseils d’entreprise, pour y défendre leurs intérêts.
12.4. La fourniture de services aux membres
Au-delà de la revendication, les syndicats offrent de plus en plus de services à leurs adhérents : assistance juridique en cas de litige, formation professionnelle, ou même des services sociaux et culturels.
Chapitre 13 : Les Formes du Syndicalisme dans le Monde
13.1. Le syndicalisme de concertation
Ce modèle, typique de pays comme l’Allemagne, est caractérisé par un partenariat étroit entre les syndicats et le patronat dans une logique de co-gestion et de recherche du compromis pour assurer la performance économique et la paix sociale.
13.2. Le syndicalisme de contestation
Ce modèle, plus fréquent dans les pays latins, conçoit les relations professionnelles comme étant fondamentalement conflictuelles. Le syndicat adopte une posture de contre-pouvoir et privilégie le rapport de force.
13.3. Le syndicalisme dans les pays en développement
Le syndicalisme dans les pays du Sud, comme en RDC, fait face à des défis spécifiques : un secteur informel majoritaire difficile à organiser, une forte pression politique et des ressources limitées.
13.4. Les défis actuels du syndicalisme
Le cours se conclut sur les défis contemporains auxquels le syndicalisme est confronté partout dans le monde : la mondialisation, la montée de la précarité, l’individualisation des relations de travail et la nécessité de renouveler ses stratégies.
Chapitre 14 : Les Relations entre Capital, Travail et État
14.1. Le modèle des relations en régime libéral
Dans ce modèle, l’État intervient peu dans les relations professionnelles, laissant les syndicats et le patronat négocier librement. La relation est principalement bilatérale, encadrée par un droit du travail minimal.
14.2. Le modèle des relations en régime autoritaire
Dans les régimes autoritaires ou corporatistes, les organisations professionnelles sont étroitement contrôlées par l’État et intégrées à sa structure. Le dialogue social est supprimé au profit d’une organisation verticale et hiérarchique.
14.3. Le modèle du dialogue social en régime démocratique
Ce modèle, promu par l’Organisation Internationale du Travail, repose sur le dialogue tripartite. L’État, les syndicats et le patronat se concertent régulièrement pour négocier les grandes orientations de la politique économique et sociale.
14.4. Le cadre du dialogue tripartite en RDC
Le cours analyse le fonctionnement du dialogue social en RDC, notamment à travers le Conseil National du Travail. Il examine ses réussites, comme la fixation du SMIG, et ses difficultés à fonctionner de manière régulière et efficace.
Annexes
1. Glossaire de l’histoire du travail et du syndicalisme
Un lexique définit de manière simple les termes techniques de la discipline (corporation, prolétariat, syndicalisme, convention collective, etc.), fournissant un outil de référence pour maîtriser le vocabulaire. 📖
2. Chronologie de l’histoire du mouvement ouvrier en RDC
Une frise chronologique synthétique présente les grandes dates et les événements clés de l’histoire des organisations professionnelles au Congo, de la période coloniale à nos jours.
3. Extraits de la Constitution et du Code du Travail sur la liberté syndicale
Une sélection des articles les plus importants de la Constitution et du Code du Travail congolais garantissant la liberté syndicale et le droit de grève est fournie, pour un contact direct avec la source légale. 📜
4. Organigramme simplifié du paysage syndical congolais
Un schéma visuel représente les principales confédérations syndicales (UNTC, CSC, etc.) et leur structuration en fédérations professionnelles. 🇨🇩 Il aide à visualiser la complexité et la diversité du paysage syndical actuel en RDC.



