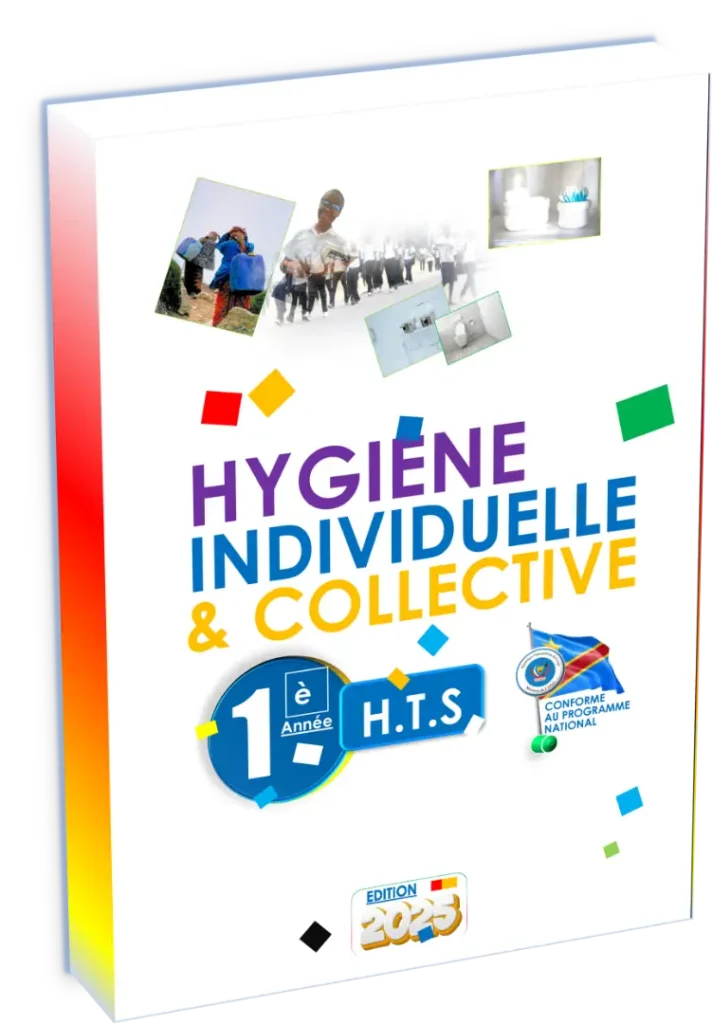
COURS D’HYGIENE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE, 1ère ANNEE, OPTION TECHNIQUE SOCIALE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
Préliminaires
Introduction générale au cours 🌿
Cette introduction positionne l’hygiène comme la science et l’art de préserver la santé, en la présentant comme une responsabilité à la fois personnelle et communautaire. Le cours fournit au futur technicien social les outils conceptuels et pratiques pour comprendre les déterminants de la santé et pour agir efficacement en tant que promoteur de bien-être au sein de la société congolaise.
Objectifs de la formation 🎯
La finalité de ce cours est de doter l’élève de compétences actionnables pour l’amélioration de la santé publique. Au terme de son apprentissage, il sera en mesure d’appliquer les règles d’hygiène personnelle, d’évaluer la salubrité d’un environnement de vie, d’identifier les modes de transmission des maladies courantes et de participer activement à l’élaboration et à l’animation de campagnes de prévention.
Méthodologie d’enseignement et d’évaluation ✍️
La démarche pédagogique privilégie une approche expérientielle et inductive, où l’observation du milieu de vie sert de point de départ à la réflexion théorique. Des études de cas, des visites de terrain et des projets de groupe, comme la mise en place d’une action « Salongo » dans le quartier de l’école, constitueront le cœur de l’apprentissage. L’évaluation portera sur la capacité de l’élève à analyser une situation sanitaire et à proposer des solutions concrètes.
Articulation avec les autres disciplines 🔗
Ce point établit les connexions entre l’hygiène et les autres savoirs du programme. Les connaissances acquises serviront de base pratique au cours de secourisme, seront approfondies par l’hygiène alimentaire, et trouveront leur champ d’application dans les stratégies de développement communautaire et d’éducation populaire, formant ainsi un socle de compétences intégré pour l’action sociale.
Partie 1 : Fondements de l’Hygiène et Santé Individuelle
Chapitre 1 : L’Hygiène Corporelle : Le Soin de Soi 🧼
1.1. L’Hygiène de la Peau et des Phanères
Ce chapitre aborde la peau comme première barrière de défense de l’organisme et enseigne les pratiques quotidiennes pour maintenir son intégrité et sa propreté.
1.1.1. La Peau : Structure, Rôles et Entretien L’étude de la structure de la peau permet de comprendre ses fonctions protectrices, sensorielles et de régulation thermique. Des conseils pratiques sur le lavage régulier avec du savon sont donnés pour prévenir les infections cutanées comme la gale, un problème récurrent dans les milieux à forte densité de population.
1.1.2. Le Soin des Cheveux et des Ongles Cette section explique comment des cheveux et des ongles propres et bien entretenus contribuent à prévenir les infestations parasitaires (poux, teigne) et la transmission de germes. La pratique de la coupe régulière des ongles est particulièrement soulignée.
1.1.3. L’Hygiène Bucco-dentaire L’importance du brossage régulier des dents après les repas est démontrée pour prévenir la carie dentaire et la mauvaise haleine. Des techniques de brossage efficace, y compris avec des moyens locaux comme le « bâtonnet », sont présentées.
1.1.4. L’Hygiène des Organes Sensoriels Le soin des yeux, des oreilles et du nez est abordé, en insistant sur les gestes doux et l’utilisation de matériaux propres pour éviter les infections et les irritations, qui peuvent avoir des conséquences graves si elles sont négligées.
1.2. L’Hygiène des Grandes Fonctions Corporelles
Ce chapitre se concentre sur les pratiques qui soutiennent le bon fonctionnement interne de l’organisme, au-delà de la propreté extérieure.
1.2.1. L’Hygiène Respiratoire L’importance de respirer un air pur et de pratiquer une ventilation adéquate des lieux de vie est expliquée. Des conseils sont donnés pour se protéger de la poussière et de la fumée, facteurs de risque pour les maladies respiratoires à Kinshasa.
1.2.2. L’Hygiène Digestive et Excrétoire Ce point établit le lien entre une alimentation saine, une hydratation suffisante et une bonne digestion. L’importance de l’hygiène des mains avant les repas et après l’utilisation des latrines est martelée comme le geste barrière essentiel contre les maladies diarrhéiques.
1.2.3. L’Hygiène du Système Nerveux : Sommeil et Repos La nécessité d’un sommeil suffisant et de qualité est présentée comme un pilier de la santé mentale et physique. Les conditions favorisant un bon repos (calme, obscurité) sont discutées.
1.2.4. L’Hygiène Musculaire : L’Activité Physique L’activité physique régulière est valorisée pour ses bienfaits sur le système cardiovasculaire, le renforcement musculaire et le bien-être psychologique. Des formes d’activités accessibles à tous sont encouragées.
Chapitre 2 : L’Hygiène Vestimentaire et l’Environnement Personnel 👕
2.1. Les Vêtements et la Santé
Ce chapitre traite des vêtements non comme un simple apparat, mais comme une « seconde peau » qui joue un rôle dans la protection et le confort du corps.
2.1.1. Les Fonctions du Vêtement Les rôles de protection contre les agressions climatiques (soleil, froid, pluie) et les petites blessures sont expliqués. La fonction de pudeur et d’expression sociale est également abordée.
2.1.2. Le Choix des Tissus Les propriétés des différentes fibres (coton, synthétiques) sont analysées. Le coton est recommandé pour les climats chauds comme celui de la RDC en raison de sa capacité à absorber la transpiration et à laisser la peau respirer.
2.1.3. L’Entretien du Linge de Corps et des Vêtements L’importance du changement et du lavage régulier des vêtements, en particulier des sous-vêtements, est soulignée pour éliminer la sueur, les cellules mortes et les microbes, et ainsi prévenir les irritations et les odeurs.
2.1.4. L’Hygiène des Chaussures Le port de chaussures adaptées est encouragé pour protéger les pieds des blessures et des parasites comme la puce-chique. L’importance de maintenir les chaussures propres et sèches pour éviter les mycoses est expliquée.
Partie 2 : L’Hygiène de l’Habitat et de l’Environnement Proche
Chapitre 3 : L’Habitat Salubre : Principes de Construction et d’Entretien 🏡
3.1. Les Composantes d’un Habitat Sain
Ce chapitre définit les caractéristiques d’un logement qui favorise la santé de ses occupants, en s’adaptant au contexte congolais.
3.1.1. L’Importance de la Ventilation Une bonne circulation de l’air est présentée comme essentielle pour évacuer l’humidité, la fumée de cuisson et les microbes, réduisant ainsi le risque de transmission de maladies respiratoires comme la tuberculose, particulièrement dans les maisons surpeuplées de Mbandaka.
3.1.2. L’Éclairage Naturel La présence d’ouvertures suffisantes pour laisser entrer la lumière du jour est valorisée pour ses effets bénéfiques sur le moral et son action assainissante (effet des UV sur les microbes).
3.1.3. La Protection contre l’Humidité Les techniques pour lutter contre l’humidité (bon drainage autour de la maison, enduits muraux) sont abordées, car l’humidité favorise le développement de moisissures et de maladies respiratoires.
3.1.4. L’Insonorisation et l’Intimité La notion de confort acoustique et la nécessité de préserver l’intimité familiale sont introduites comme des composantes du bien-être psychologique au sein de l’habitat.
3.2. L’Entretien et l’Aménagement de l’Habitat
Au-delà de la construction, la manière de vivre et d’entretenir la maison est fondamentale pour garantir sa salubrité.
3.2.1. Le Nettoyage Régulier des Sols et des Surfaces Des méthodes de nettoyage efficaces pour les différents types de sols (terre battue, ciment) sont enseignées, en insistant sur le dépoussiérage et le lavage pour éliminer les germes et les allergènes.
3.2.2. L’Aménagement de la Cuisine L’organisation d’un coin cuisine hygiénique, même avec des moyens modestes (surfaces surélevées, rangement des aliments à l’abri des nuisibles), est expliquée comme une mesure clé de prévention des intoxications alimentaires.
3.2.3. L’Hygiène de la Literie L’aération quotidienne des draps et des matelas, ainsi que leur exposition au soleil, sont recommandées pour lutter contre les acariens et autres parasites.
3.2.4. Le « Salongo » : Une Pratique Citoyenne Les travaux communautaires de nettoyage du quartier sont présentés comme une application directe de l’hygiène collective, renforçant la cohésion sociale et améliorant le cadre de vie de tous.
Chapitre 4 : Gestion de l’Eau et de l’Assainissement Domestique 💧
4.1. L’Accès à l’Eau Potable
Ce chapitre se concentre sur les défis et les solutions pratiques pour garantir une eau de boisson saine au niveau familial.
4.1.1. La Protection des Sources d’Eau Des techniques simples pour protéger les points d’eau communautaires (puits, sources) de la contamination par les eaux de ruissellement et les déjections animales sont présentées.
4.1.2. Le Transport Hygiénique de l’Eau L’utilisation de bidons propres et exclusivement dédiés au transport de l’eau est enseignée pour éviter la contamination entre la source et le domicile.
4.1.3. Le Stockage Sécurisé de l’Eau à Domicile Les bonnes pratiques de stockage sont détaillées : utilisation de récipients propres, couverts, et de préférence dotés d’un robinet pour éviter de tremper des mains ou des gobelets sales dans l’eau potable.
4.1.4. Les Méthodes de Traitement de l’Eau à Domicile Des démonstrations pratiques des méthodes de potabilisation de l’eau (ébullition, chloration, filtration) sont réalisées, en expliquant les avantages et les contraintes de chaque technique pour une famille à Bukavu.
4.2. L’Assainissement de Base
Ce chapitre aborde la gestion des excréments et des eaux usées, un enjeu majeur de santé publique pour la prévention des maladies.
4.2.1. L’Importance des Latrines Hygiéniques L’utilisation systématique de latrines est présentée comme la mesure la plus efficace pour rompre le cycle de transmission des maladies féco-orales. Les caractéristiques d’une latrine hygiénique (avec une dalle, un couvercle) sont décrites.
4.2.2. L’Entretien des Latrines Des conseils pour maintenir les latrines propres et sans odeurs, afin d’encourager leur utilisation par tous les membres de la famille, sont fournis.
4.2.3. La Gestion des Eaux Usées (Eaux de Vaisselle, de Toilette) Des solutions simples pour l’évacuation des eaux ménagères, comme le puisard, sont expliquées pour éviter la stagnation de l’eau, qui favorise la prolifération des moustiques et la contamination du sol.
4.2.4. L’Hygiène des Mains après Contact avec des Excréments Le lavage des mains avec du savon après avoir utilisé les latrines ou après avoir nettoyé un jeune enfant est réaffirmé comme un geste de protection individuelle et collective fondamental.
Chapitre 5 : La Gestion des Déchets et la Lutte contre les Vecteurs 🦟
5.1. La Gestion des Ordures Ménagères
Ce chapitre se concentre sur les pratiques permettant de gérer les déchets produits par le ménage afin d’éviter qu’ils ne deviennent un danger pour la santé.
5.1.1. Le Tri Sélectif à la Source Une introduction simple au tri des déchets est proposée, en séparant les déchets biodégradables (qui peuvent être compostés) des autres déchets, une pratique applicable même dans un quartier de Lubumbashi.
5.1.2. Le Compostage des Déchets Organiques La technique du compostage est présentée comme une méthode pour transformer les déchets de cuisine et de jardin en un engrais naturel utile pour un petit potager, réduisant ainsi le volume total des ordures.
5.1.3. Le Stockage Temporaire des Déchets L’utilisation d’une poubelle couverte, pour éviter d’attirer les mouches et autres nuisibles, est enseignée comme une pratique d’hygiène de base en attendant l’évacuation des déchets.
5.1.4. Les Modes d’Élimination Finale Les différentes options pour l’élimination des déchets non compostables (collecte organisée, enfouissement sanitaire) sont discutées, en soulignant les dangers de l’incinération sauvage et des décharges à ciel ouvert.
5.2. La Lutte contre les Animaux Vecteurs de Maladies
Ce chapitre identifie les principaux animaux qui transmettent des maladies à l’homme et présente des stratégies de lutte intégrée.
5.2.1. La Lutte contre les Moustiques Des méthodes de prévention contre le paludisme et autres maladies transmises par les moustiques sont détaillées : élimination des eaux stagnantes, utilisation de moustiquaires imprégnées, et assainissement du périmètre de l’habitation.
5.2.2. La Lutte contre les Mouches et les Cafards La propreté de la cuisine, la gestion des déchets et la protection des aliments sont présentées comme les meilleures armes pour empêcher la prolifération de ces insectes, vecteurs de germes de maladies diarrhéiques.
5.2.3. La Lutte contre les Rongeurs (Rats, Souris) Les stratégies pour empêcher les rongeurs d’entrer dans les maisons et d’accéder aux réserves de nourriture sont expliquées, car ils peuvent transmettre des maladies graves comme la leptospirose.
5.2.4. L’Hygiène des Animaux Domestiques Des conseils sont donnés pour prendre soin des animaux domestiques (chiens, chèvres, volailles) afin qu’ils ne deviennent pas une source de transmission de maladies (parasites, rage) pour la famille.
Partie 3 : Hygiène Collective et Prévention des Maladies Transmissibles
Chapitre 6 : Introduction aux Maladies Sociales et à l’Épidémiologie 🩺
6.1. Comprendre la Maladie
Ce chapitre fournit les concepts de base pour comprendre ce qu’est une maladie, ses causes et comment elle se propage au sein d’une population.
6.1.1. Définition de la Maladie et de l’Agent Pathogène La maladie est définie comme une altération de l’état de santé. La notion d’agent pathogène (microbe, virus, parasite) comme cause de la maladie infectieuse est introduite.
6.1.2. La Chaîne de Transmission Le modèle de la chaîne de transmission (réservoir – mode de transmission – hôte sensible) est expliqué de manière simple pour faire comprendre que l’on peut agir à différents niveaux pour stopper la propagation d’une maladie.
6.1.3. La Différence entre Épidémie, Endémie et Pandémie Ces termes clés de l’épidémiologie sont définis et illustrés avec des exemples concrets : une épidémie de choléra à Uvira, le caractère endémique du paludisme au Kasaï, et la pandémie de VIH/SIDA.
6.1.4. Les Moyens de Défense de l’Organisme : L’Immunité Le concept d’immunité naturelle et acquise (par la maladie ou la vaccination) est introduit pour expliquer pourquoi certaines personnes tombent malades et d’autres non, et pour justifier l’importance de la vaccination.
Chapitre 7 : Prévention des Maladies Infantiles et Contagieuses Courantes 👶
7.1. Les Maladies Évitables par la Vaccination
Ce chapitre se concentre sur les maladies infantiles les plus graves qui peuvent être prévenues efficacement grâce à la vaccination, un pilier de la santé publique.
7.1.1. La Rougeole La rougeole est présentée comme une maladie virale très contagieuse et potentiellement mortelle pour les jeunes enfants. L’importance de respecter le calendrier vaccinal pour l’éradiquer est soulignée.
7.1.2. La Coqueluche et la Diphtérie Ces deux maladies bactériennes, qui affectent les voies respiratoires, sont décrites. La vaccination précoce est montrée comme le seul moyen de protection efficace.
7.1.3. Le Tétanos Le tétanos, notamment le tétanos néonatal dû à un manque d’hygiène lors de l’accouchement, est expliqué. La vaccination de la femme enceinte est présentée comme une stratégie essentielle de prévention.
7.1.4. La Poliomyélite Cette maladie virale, qui peut entraîner une paralysie irréversible, est étudiée. Le succès des campagnes de vaccination de masse en RDC pour interrompre sa circulation est utilisé comme un exemple encourageant.
7.2. Les Autres Maladies Contagieuses
Ce chapitre aborde d’autres maladies infectieuses fréquentes et les mesures d’hygiène qui permettent de limiter leur propagation.
7.2.1. La Varicelle et les Oreillons Ces maladies virales, généralement bénignes dans l’enfance, sont décrites. Des conseils d’hygiène sont donnés pour prendre soin de l’enfant malade et éviter de contaminer l’entourage.
7.2.2. La Grippe et les Infections Respiratoires Aiguës Les modes de transmission de ces infections (gouttelettes de salive) sont expliqués. L’hygiène respiratoire (tousser dans son coude) et le lavage des mains sont promus comme gestes barrières.
7.2.3. Les Infections Cutanées (Gale, Teigne) La transmission de ces infections par contact direct ou par le partage de linge est expliquée. L’importance de l’hygiène corporelle et de l’entretien des vêtements et de la literie est réaffirmée.
7.2.4. Les Conjonctivites Les conjonctivites infectieuses, très contagieuses, sont abordées. L’importance de ne pas partager les serviettes de toilette et de se laver fréquemment les mains pour éviter la propagation au sein de la famille ou de l’école est soulignée.
Chapitre 8 : Lutte contre les Grandes Endémies en RDC 🌍
8.1. Le Paludisme (Malaria)
Le paludisme reste la première cause de morbidité et de mortalité en RDC. Ce chapitre est entièrement dédié aux stratégies de lutte intégrée contre ce fléau.
8.1.1. Le Cycle du Parasite et le Rôle de l’Anophèle Le cycle de vie complexe du parasite Plasmodium et son mode de transmission par la piqûre du moustique anophèle femelle sont expliqués de manière visuelle et simple.
8.1.2. La Prévention Vectorielle : Moustiquaires et Assainissement La stratégie la plus efficace, la prévention des piqûres, est détaillée : utilisation correcte et quotidienne des moustiquaires imprégnées d’insecticide et destruction des gîtes larvaires (eaux stagnantes) autour des maisons.
8.1.3. La Reconnaissance des Symptômes et le Recours aux Soins Les symptômes typiques du paludisme (fièvre, maux de tête, courbatures) sont décrits pour encourager une consultation rapide au centre de santé le plus proche afin d’obtenir un diagnostic et un traitement efficaces.
8.1.4. Les Groupes à Risque : Femmes Enceintes et Enfants L’accent est mis sur la vulnérabilité particulière des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans, et sur les stratégies de protection spécifiques qui leur sont destinées (traitement préventif intermittent).
8.2. La Tuberculose
La tuberculose demeure un problème de santé publique majeur, souvent associé à la pauvreté et à la promiscuité.
8.2.1. Le Mode de Transmission et les Symptômes La transmission de la maladie par voie aérienne (toux) est expliquée. Les signes d’alerte (toux persistante de plus de deux semaines, fièvre, amaigrissement) sont enseignés pour favoriser un dépistage précoce.
8.2.2. L’Importance du Dépistage et du Traitement Le message clé est que la tuberculose se guérit, à condition de suivre un traitement long et complet. L’importance de ne pas interrompre le traitement pour éviter les rechutes et les résistances est soulignée.
8.2.3. La Prévention au Sein de la Famille Des conseils sont donnés pour protéger l’entourage d’un malade : bonne ventilation du logement, hygiène respiratoire du patient, et dépistage des contacts proches.
8.2.4. Le Lien entre Tuberculose et VIH La co-infection tuberculose-VIH est abordée, en expliquant comment le VIH affaiblit le système immunitaire et favorise le développement de la tuberculose. L’importance du dépistage du VIH chez tout patient tuberculeux est expliquée.
Chapitre 9 : Prévention des Maladies liées au Péril Fécal 💩
9.1. Le Choléra et les Maladies Diarrhéiques
Ce chapitre se concentre sur les maladies dont la transmission est directement liée à un manque d’hygiène de l’eau, des aliments et des mains.
9.1.1. Le Mécanisme de la Transmission Féco-orale Le cycle de transmission des germes présents dans les selles vers la bouche (via l’eau, les mains sales, les mouches ou les aliments contaminés) est expliqué par le schéma des « 5 F » (Faeces, Fingers, Flies, Fields, Food).
9.1.2. Le Choléra : Une Urgence de Santé Publique Le choléra est présenté comme une forme particulièrement grave de diarrhée, pouvant entraîner la mort par déshydratation en quelques heures. Les mesures d’hygiène collectives à mettre en place en cas d’épidémie, comme dans la région des Grands Lacs, sont détaillées.
9.1.3. La Prévention de la Déshydratation La préparation et l’administration des Sels de Réhydratation Orale (SRO) sont enseignées comme le traitement de première ligne, vital et accessible, pour sauver la vie d’un enfant atteint de diarrhée.
9.1.4. L’Importance du Lavage des Mains au Savon Le lavage des mains aux moments clés (après la selle, avant de préparer le repas, avant de manger) est présenté comme le geste le plus simple, le moins cher et le plus efficace pour prévenir la majorité des maladies diarrhéiques.
9.2. Les Parasitoses Intestinales (Vers)
Les vers intestinaux sont un problème très fréquent, en particulier chez les enfants, avec des conséquences sur leur nutrition et leur développement.
9.2.1. Les Différents Types de Vers (Ascaris, Ankylostomes) Les principaux types de vers intestinaux et leurs modes de contamination (ingestion d’œufs, pénétration des larves à travers la peau) sont décrits.
9.2.2. Les Symptômes et les Conséquences sur la Santé Les signes d’une infestation (douleurs abdominales, anémie, retard de croissance) sont expliqués pour sensibiliser les parents à l’importance de ce problème.
9.2.3. Les Stratégies de Prévention La prévention repose sur les mêmes piliers que pour les maladies diarrhéiques : utilisation des latrines, lavage des mains, lavage soigneux des fruits et légumes, et port de chaussures.
9.2.4. Le Rôle du Déparasitage Périodique Les campagnes de déparasitage systématique des enfants d’âge scolaire sont présentées comme une stratégie de santé publique efficace pour réduire la charge parasitaire au sein de la communauté.
Partie 4 : Action Sociale en Santé Communautaire
Chapitre 10 : Les Implications Sociales de la Maladie 🤝
10.1. L’Impact de la Maladie sur l’Individu et la Famille
Ce chapitre explore la maladie non seulement comme un phénomène biologique, mais aussi comme un événement social qui bouleverse la vie des personnes et de leur entourage.
10.1.1. L’Impact Économique de la Maladie Le coût de la maladie est analysé : coûts directs (consultations, médicaments) et coûts indirects (perte de revenus due à l’incapacité de travailler), qui peuvent plonger une famille dans la précarité.
10.1.2. L’Impact Psychologique et Émotionnel La maladie est abordée comme une source d’anxiété, de peur et d’isolement pour le patient. Le rôle du soutien familial et communautaire dans le processus de guérison est souligné.
10.1.3. La Stigmatisation et la Discrimination Le phénomène de la stigmatisation liée à certaines maladies (VIH/SIDA, lèpre, troubles mentaux) est étudié. Le rôle du technicien social dans la lutte contre les préjugés et la promotion de l’inclusion est mis en avant.
10.1.4. Le Rôle de l’Aidant Familial La charge physique, émotionnelle et financière qui pèse sur les proches qui s’occupent d’un malade chronique est reconnue. Des pistes pour soutenir ces aidants sont explorées.
Chapitre 11 : Stratégies d’Éducation pour la Santé (EPS) 📢
11.1. Les Outils de l’Éducation pour la Santé
Ce chapitre équipe le futur technicien social avec une boîte à outils pour concevoir et mettre en œuvre des interventions de promotion de la santé.
11.1.1. La Causerie Éducative La technique de la causerie est détaillée : comment choisir un thème, préparer un message clair, utiliser un langage simple, susciter la participation et utiliser des supports visuels (boîte à images).
11.1.2. Le Théâtre-Forum et les Saynètes L’utilisation de techniques théâtrales pour aborder des sujets sensibles et faire émerger des solutions collectives est présentée comme une méthode d’animation dynamique et participative.
11.1.3. Les Supports de Communication (Affiches, Chansons) La conception de supports de communication adaptés au contexte culturel local est abordée. La création d’une chanson sur le lavage des mains avec un rythme local peut être un outil de mémorisation très puissant.
11.1.4. La Visite à Domicile (VAD) La VAD est présentée comme une méthode d’intervention privilégiée pour un conseil personnalisé et une observation directe des conditions de vie, permettant une action éducative sur mesure.
Chapitre 12 : Le Rôle de l’Animateur Social dans les Programmes de Santé 🧑⚕️
12.1. L’Intervention du Technicien Social
Ce chapitre final synthétise la place et les fonctions spécifiques du technicien social en tant qu’acteur clé de la santé communautaire.
12.1.1. Le Pont entre la Communauté et les Services de Santé Le technicien social est positionné comme un médiateur qui facilite le dialogue entre les populations et le personnel soignant, en aidant à traduire les besoins des uns et les messages techniques des autres.
12.1.2. La Mobilisation Communautaire pour la Santé Son rôle dans la mobilisation des communautés pour participer aux campagnes de santé (vaccination, distribution de moustiquaires) et s’approprier les programmes est essentiel pour leur succès.
12.1.3. Le Soutien aux Groupes de Malades L’accompagnement de groupes de soutien pour les personnes vivant avec une maladie chronique (VIH, diabète) est présenté comme une action importante pour rompre l’isolement et favoriser l’entraide.
12.1.4. Le Plaidoyer pour un Environnement Sain Le technicien social est encouragé à jouer un rôle de plaidoyer auprès des autorités locales pour l’amélioration des infrastructures de base (accès à l’eau, gestion des déchets) qui conditionnent la santé de tous.
Annexes
Glossaire des Termes d’Hygiène et de Santé Publique 📖
Un lexique structuré définit de manière accessible les termes techniques et les acronymes utilisés dans le cours (par exemple, Endémie, Prophylaxie, Vecteur, SRO), afin de consolider le vocabulaire professionnel des élèves.
Calendrier Vaccinal de la RDC 💉
Le calendrier officiel du Programme Élargi de Vaccination (PEV) en vigueur en RDC est fourni, constituant un outil de référence pratique pour toute action de sensibilisation sur la santé infantile.
Fiches Techniques sur les Maladies Courantes 📄
Pour une dizaine de maladies prioritaires (paludisme, choléra, rougeole, etc.), une fiche synthétique est proposée, résumant les points clés : agent causal, mode de transmission, symptômes, et surtout, les mesures de prévention concrètes.
Guide Pratique pour l’Animation d’une Séance d’EPS 📝
Cette annexe propose un canevas détaillé pour préparer et animer une séance d’Éducation Pour la Santé sur le terrain, incluant un guide d’animation, des idées de supports visuels, et une grille d’auto-évaluation pour l’animateur.



