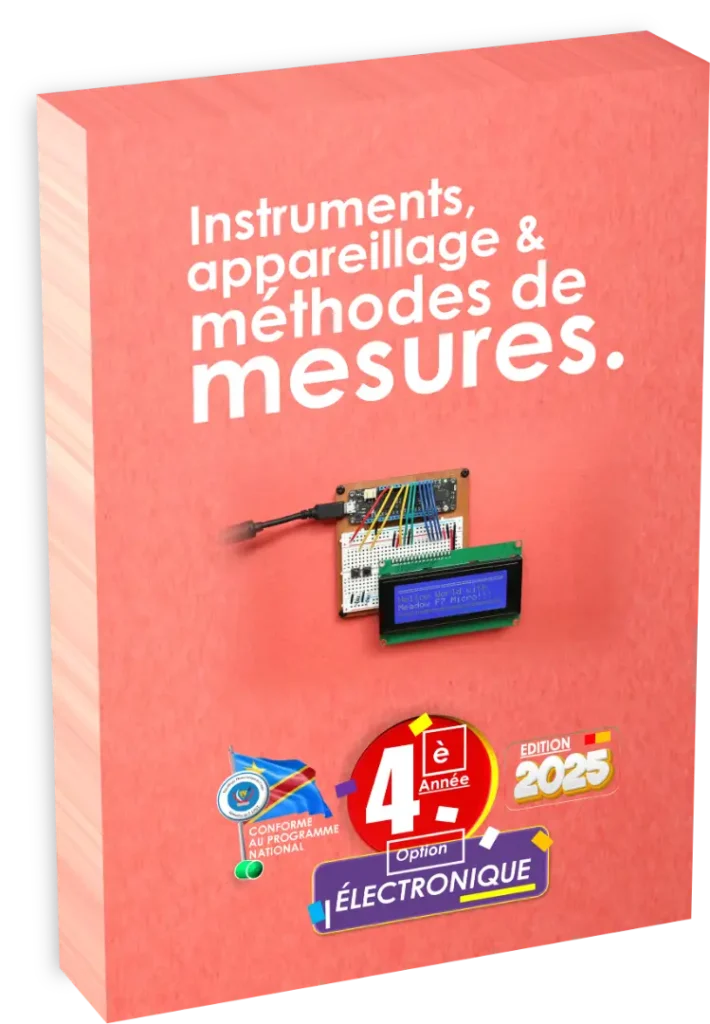
INSTRUMENTS ET APPAREILLAGE DE MESURE
4ÈME ANNÉE – OPTION ÉLECTRONIQUE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
Préliminaires
1. Objectifs Généraux du Cours
Ce manuel a pour objectif de fournir à l’élève une connaissance approfondie des capteurs industriels et de la chaîne de mesure qui permet de transformer une grandeur physique en une information exploitable. Le cours explore les principes physiques et les technologies des transducteurs utilisés pour mesurer les grandeurs mécaniques, thermiques et chimiques. La finalité est de former un technicien de haut niveau, capable de choisir, de mettre en œuvre et de maintenir les instruments qui constituent les « sens » de tout système de production automatisé, de la régulation de processus au contrôle qualité.
2. Compétences Visées
Au terme de cette année de formation, l’élève détiendra la capacité de :
- Expliquer le principe de fonctionnement des principaux types de capteurs pour la mesure de déplacement, force, pression, débit, niveau et température.
- Décrire l’architecture complète d’une chaîne de mesure, du capteur à l’unité de traitement.
- Justifier le choix d’un capteur pour une application industrielle donnée en fonction de ses caractéristiques (étendue de mesure, précision, sensibilité).
- Comprendre le principe et la nécessité du conditionnement des signaux issus des capteurs.
- Expliquer les principes de la transmission des signaux de mesure en milieu industriel, notamment la boucle de courant 4-20 mA.
3. Approche Pédagogique
La démarche pédagogique est centrée sur la physique appliquée et la technologie des capteurs. Chaque chapitre est consacré à la mesure d’une grandeur physique spécifique, en présentant de manière comparative les différentes technologies de capteurs disponibles. L’accent est mis sur le lien entre le principe physique exploité et les performances du transducteur. Des études de cas industriels, comme l’instrumentation d’une chaîne de traitement minier dans le Lualaba, le contrôle de la pasteurisation dans une brasserie à Lubumbashi, ou la surveillance du niveau d’eau du fleuve Congo pour la navigation, permettent de contextualiser les savoirs et de développer une approche systémique de l’instrumentation.
PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’INSTRUMENTATION INDUSTRIELLE 🛠️
Cette partie inaugurale établit le cadre conceptuel de l’instrumentation. Avant d’étudier les capteurs un par un, il est indispensable de comprendre comment ils s’intègrent dans un système global. L’élève y découvrira l’architecture type d’une chaîne de mesure, les critères de classification des capteurs, et les techniques de conditionnement et de transmission qui permettent de transformer le signal brut du capteur en une information fiable et robuste, apte à être traitée par un automate ou un superviseur.
CHAPITRE 1 : LA CHAÎNE DE MESURE INDUSTRIELLE
1.1. Le schéma bloc fonctionnel
La chaîne de mesure est décomposée en ses blocs fonctionnels essentiels. L’élève apprendra à tracer et à analyser ce schéma : le capteur (qui détecte la grandeur physique), le conditionneur (qui adapte le signal), le transmetteur (qui envoie le signal à distance), et le récepteur (qui traite l’information).
1.2. Le mesurande
Le mesurande est défini comme la grandeur physique spécifique que l’on cherche à mesurer. La distinction entre la grandeur d’entrée (physique) et la grandeur de sortie (généralement électrique) d’un capteur est établie.
1.3. Le transducteur et le capteur
La terminologie est précisée. Le transducteur est l’élément qui convertit une forme d’énergie en une autre. Le capteur est un ensemble qui inclut le transducteur et souvent une partie de son conditionnement, fournissant un signal électrique directement exploitable.
1.4. L’environnement industriel et ses contraintes
L’élève sera sensibilisé aux contraintes sévères du milieu industriel : perturbations électromagnétiques, vibrations, températures extrêmes, atmosphères corrosives. La robustesse et la fiabilité sont présentées comme des critères de choix aussi importants que la précision.
CHAPITRE 2 : CLASSIFICATION ET CARACTÉRISTIQUES DES CAPTEURS
2.1. Classification des capteurs
Les capteurs sont classifiés selon plusieurs critères. L’élève apprendra à les distinguer selon le mesurande, le principe physique utilisé, leur caractère actif (générant leur propre signal, comme un thermocouple) ou passif (nécessitant une source d’énergie, comme une jauge de contrainte), et leur sortie analogique ou numérique.
2.2. L’étendue de mesure et la pleine échelle
L’étendue de mesure est la gamme de valeurs du mesurande que le capteur peut mesurer. La pleine échelle (Full Scale – FS) est la valeur maximale de cette étendue. Ces paramètres définissent le domaine de fonctionnement du capteur.
2.3. La sensibilité
La sensibilité est définie comme le rapport de la variation du signal de sortie à la variation de la grandeur d’entrée. Elle quantifie l’aptitude du capteur à détecter de faibles variations du mesurande.
2.4. La précision, la linéarité et l’hystérésis
D’autres caractéristiques métrologiques clés sont définies : la précision (aptitude à donner une valeur proche de la valeur vraie), la linéarité (proportionnalité de la sortie à l’entrée) et l’hystérésis (différence de sortie pour une même entrée, selon qu’elle est atteinte en croissant ou en décroissant).
CHAPITRE 3 : LE CONDITIONNEMENT DES SIGNAUX DE CAPTEURS
3.1. Nécessité du conditionnement
Les signaux bruts issus des transducteurs sont souvent de très faible amplitude, non linéaires, ou superposés à des signaux parasites. Le conditionnement a pour rôle de transformer ce signal brut en un signal « propre » et standardisé.
3.2. L’amplification
L’amplification, réalisée par des amplificateurs d’instrumentation, est l’étape la plus courante. Son but est d’élever le niveau du signal pour le rendre moins sensible au bruit et compatible avec les étages suivants.
3.3. Le filtrage
Le filtrage est utilisé pour éliminer les fréquences indésirables (bruit, parasites du secteur à 50 Hz). L’utilisation de filtres passe-bas pour lisser les signaux est particulièrement fréquente en instrumentation.
3.4. La linéarisation
Certains capteurs ont une réponse non linéaire. Des circuits de linéarisation, analogiques ou numériques (à l’aide de tables de correspondance), sont utilisés pour corriger cette non-linéarité et fournir un signal de sortie directement proportionnel au mesurande.
CHAPITRE 4 : TRANSMISSION DES SIGNAUX DE MESURE (BOUCLE DE COURANT 4-20 MA)
4.1. Le problème de la transmission en tension
La transmission d’un signal de mesure sous forme de tension sur de longues distances en milieu industriel est problématique. L’élève comprendra que la résistance des câbles provoque des chutes de tension qui faussent la mesure et que les tensions sont très sensibles aux parasites.
4.2. Le principe de la boucle de courant
La boucle de courant 4-20 mA est présentée comme la solution standard. Le transmetteur fait circuler dans une boucle un courant dont l’intensité est proportionnelle au mesurande (4 mA pour 0%, 20 mA pour 100%).
4.3. Avantages de la boucle 4-20 mA
Les avantages de cette méthode sont analysés : le courant est le même en tout point de la boucle, le rendant insensible à la résistance des lignes ; elle est très robuste face au bruit ; et le « zéro vivant » à 4 mA permet de détecter une rupture de la ligne (le courant tombe à 0 mA).
4.4. Le transmetteur à deux fils
Le schéma d’un transmetteur à deux fils est étudié. L’élève découvrira comment le capteur et son électronique peuvent être alimentés par le courant même de la boucle de mesure, simplifiant considérablement le câblage, une technique omniprésente dans l’industrie pétrolière à Moanda.
DEUXIÈME PARTIE : MESURE DES GRANDEURS MÉCANIQUES ⚙️
Cette partie explore en détail la technologie des capteurs utilisés pour mesurer les grandeurs fondamentales de la mécanique : la position, la force, la pression et le débit. Ces mesures sont au cœur de l’automatisme industriel, que ce soit pour le contrôle de positionnement des robots, la pesée dans les processus de dosage, la régulation de pression dans les circuits hydrauliques ou le contrôle de débit des fluides.
CHAPITRE 5 : LES CAPTEURS DE DÉPLACEMENT ET DE POSITION
5.1. Les capteurs potentiométriques
Le capteur de déplacement potentiométrique est présenté comme un curseur se déplaçant sur une piste résistive. L’élève analysera son principe simple, qui fournit une tension de sortie directement proportionnelle à la position, pour des mesures de déplacement linéaire ou angulaire.
5.2. Le transformateur différentiel (LVDT)
Le LVDT (Linear Variable Differential Transformer) est un capteur de position linéaire sans contact, très robuste et précis. Son principe, basé sur la variation du couplage magnétique entre un primaire et deux secondaires, est expliqué.
5.3. Les capteurs capacitifs et inductifs
Les capteurs de proximité capacitifs (détectant tout type de matériau) et inductifs (détectant uniquement les métaux) sont décrits. Leur utilisation comme détecteurs de position « tout ou rien » est leur application principale.
5.4. Les codeurs optiques et les synchro-machines
Pour la mesure de position angulaire de précision, le codeur optique (incrémental ou absolu) est la technologie de référence. Le principe de la synchro-machine est également présenté comme un capteur de position angulaire robuste utilisé en aéronautique.
CHAPITRE 6 : LES CAPTEURS DE FORCE, DE POIDS ET DE CONTRAINTE
6.1. La jauge de contrainte (strain gauge)
La jauge de contrainte est l’élément sensible de la plupart des capteurs de force. Son principe est expliqué : collée sur un corps d’épreuve, sa résistance électrique varie proportionnellement à la déformation (et donc à la force) subie par celui-ci.
6.2. Le pont de Wheatstone
La variation de résistance d’une jauge étant très faible, elle est toujours mesurée à l’aide d’un pont de Wheatstone. L’élève apprendra à analyser ce montage qui convertit la faible variation de résistance en une tension mesurable.
6.3. Le capteur de force et la cellule de pesage
Le capteur de force est constitué d’un corps d’épreuve métallique, sur lequel sont collées des jauges de contrainte, et qui est conçu pour se déformer de manière contrôlée sous l’effet d’une force. Les cellules de pesage des bascules industrielles sont une application directe.
6.4. Les capteurs de force piézoélectriques
Pour la mesure de forces dynamiques (chocs, vibrations), les capteurs piézoélectriques sont utilisés. Leur capacité à générer une charge électrique proportionnelle à une force rapide est leur principal atout.
CHAPITRE 7 : LES CAPTEURS DE PRESSION
7.1. Définitions et unités de pression
Les différentes notions de pression (absolue, relative, différentielle) sont définies, et les unités de mesure (Pascal, bar) sont présentées.
7.2. Les manomètres à déformation (tube de Bourdon, membrane)
Les technologies mécaniques classiques sont décrites. Le tube de Bourdon, qui se redresse sous l’effet de la pression, et la membrane, qui fléchit, sont présentés comme des éléments qui convertissent une pression en un déplacement mesurable.
7.3. Les capteurs de pression à jauge de contrainte
La technologie la plus courante associe une membrane à des jauges de contrainte. La pression déforme la membrane, et les jauges mesurent cette déformation. C’est le principe de la plupart des capteurs de pression électroniques utilisés dans les processus industriels, par exemple pour la surveillance des conduites de la REGIDESO.
7.4. Les capteurs de pression capacitifs et piézoélectriques
D’autres technologies sont présentées : les capteurs capacitifs, où la pression fait varier la distance entre les armatures d’un condensateur, et les capteurs piézoélectriques, particulièrement adaptés à la mesure de pressions dynamiques (acoustique, ondes de choc).
CHAPITRE 8 : LES CAPTEURS DE DÉBIT ET DE NIVEAU
8.1. Les débitmètres à organe déprimogène
Le principe de la mesure de débit par différence de pression est expliqué. L’utilisation d’un diaphragme ou d’un tube de Venturi pour créer une perte de charge proportionnelle au carré du débit est analysée.
8.2. Les débitmètres à turbine
Le débitmètre à turbine est présenté : le fluide fait tourner une petite hélice à une vitesse proportionnelle au débit. Un capteur externe mesure la vitesse de rotation de la turbine pour en déduire le débit.
8.3. Les débitmètres électromagnétiques
Cette technologie, applicable aux fluides conducteurs, est expliquée. Elle repose sur la loi de Faraday : le passage du fluide dans un champ magnétique induit une tension proportionnelle à sa vitesse (et donc au débit).
8.4. Les capteurs de niveau
Différentes techniques de mesure de niveau dans une cuve sont présentées : mesure par pression différentielle, par flotteur, par ultrasons (mesure du temps d’écho) ou par radar. Le choix de la technologie dépend de la nature du fluide et des conditions du processus.
TROISIÈME PARTIE : MESURE DES GRANDEURS THERMIQUES ET OPTIQUES 🔥
Cette partie se concentre sur la mesure de la température, une des grandeurs les plus importantes et les plus contrôlées dans l’industrie, ainsi que sur les techniques de mesure qui utilisent la lumière. L’élève y découvrira les deux grandes familles de capteurs de température : ceux qui nécessitent un contact avec le milieu à mesurer et ceux qui opèrent à distance. Ces instruments sont essentiels pour la sécurité, l’efficacité énergétique et la qualité des produits dans d’innombrables processus.
CHAPITRE 9 : LES CAPTEURS DE TEMPÉRATURE À CONTACT
9.1. Les thermomètres à dilatation et à tension de vapeur
Les technologies non électriques classiques sont brièvement rappelées pour contextualiser les méthodes modernes (dilatation de liquide ou de gaz, pression de vapeur saturante).
9.2. Les sondes à résistance (RTD)
Les sondes à résistance (Resistance Temperature Detector), comme la Pt100 (sonde en platine de 100 Ω à 0°C), sont étudiées. Leur principe repose sur la variation de la résistance d’un métal avec la température. Elles sont réputées pour leur grande précision et leur stabilité.
9.3. Les thermistances
Les thermistances (CTN et CTP) sont présentées comme des capteurs à base de semi-conducteurs. Leur très grande sensibilité les rend idéales pour des mesures de précision sur une plage de température limitée.
9.4. Les thermocouples
Le thermocouple est le capteur de température le plus utilisé dans l’industrie. Son principe, l’effet Seebeck (génération d’une tension à la jonction de deux métaux différents), est expliqué. Sa robustesse et sa très large plage de mesure sont ses principaux atouts. La nécessité d’une compensation de soudure froide est également abordée.
CHAPITRE 10 : LES CAPTEURS DE TEMPÉRATURE SANS CONTACT (PYROMÈTRES)
10.1. Le rayonnement du corps noir
Le principe fondamental de la pyrométrie est introduit : tout corps à une température supérieure au zéro absolu émet un rayonnement électromagnétique. La loi de Stefan-Boltzmann, qui lie la puissance totale rayonnée à la température, est énoncée.
10.2. Le pyromètre infrarouge
Le pyromètre infrarouge est présenté comme un thermomètre qui mesure la température d’une surface à distance en captant le rayonnement infrarouge qu’elle émet. Son principe de fonctionnement (optique de focalisation, détecteur, traitement du signal) est décrit.
10.3. La notion d’émissivité
L’émissivité est un paramètre qui caractérise l’aptitude d’une surface à rayonner. L’élève apprendra que le réglage correct de l’émissivité sur le pyromètre est une condition indispensable pour obtenir une mesure de température précise.
10.4. Les caméras thermiques (thermographie)
La caméra thermique est présentée comme une extension du pyromètre, qui crée une image complète où chaque pixel représente une température. Ses applications pour la maintenance prédictive (détection de points chauds dans une armoire électrique de la SNEL) ou l’isolation des bâtiments sont illustrées.
Annexes
1. Mémento des Principes Physiques des Capteurs
Cette section fournirait une synthèse visuelle sous forme de tableau. Pour chaque grand principe physique (piézoélectricité, effet Seebeck, effet Hall, etc.), le phénomène, la grandeur d’entrée, la grandeur de sortie et des exemples de capteurs qui l’utilisent seraient résumés.
2. Guide de Sélection d’un Capteur de Température
Un guide pratique, sous forme d’arbre de décision, aiderait l’élève à choisir la technologie de capteur de température la plus adaptée (thermocouple, Pt100, thermistance) en fonction de critères clés comme la plage de mesure, la précision requise, le temps de réponse et le coût.
3. Tableaux de Données pour Thermocouples et Sondes Pt100
Des extraits des tables normalisées donnant la correspondance entre la tension et la température pour les principaux types de thermocouples (J, K, S) et entre la résistance et la température pour les sondes Pt100 seraient fournis, outils indispensables pour l’étalonnage et l’utilisation de ces capteurs.
4. Introduction aux Capteurs Intelligents et au Protocole HART
Ce complément (enrichissement) introduirait les capteurs « intelligents », qui intègrent un microprocesseur pour réaliser l’auto-étalonnage, la linéarisation et le diagnostic. Le protocole de communication HART, qui permet de dialoguer numériquement avec ces capteurs sur la même boucle de courant 4-20 mA, serait présenté comme une technologie clé de l’instrumentation moderne.



