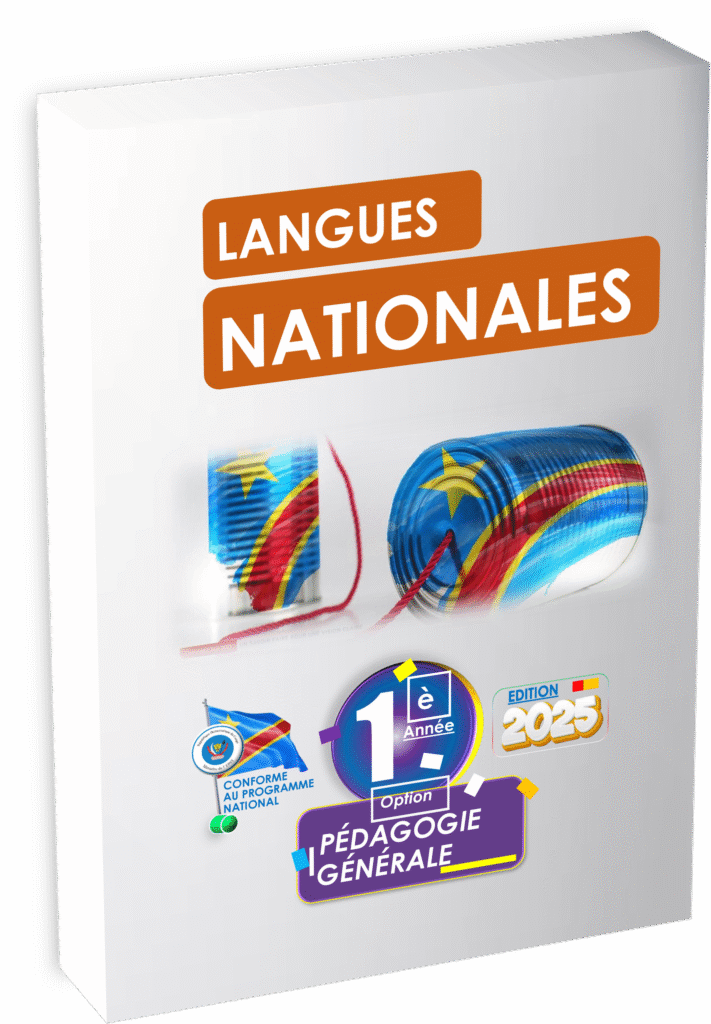
PRÉLIMINAIRES
1. Présentation générale du cours
Ce cours fournit aux futurs enseignants les fondements théoriques et les compétences pratiques nécessaires à l’enseignement des quatre langues nationales de la République Démocratique du Congo : le kikongo, le lingala, le kiswahili et le ciluba. Il vise à développer une maîtrise linguistique de base dans chacune de ces langues et, surtout, à outiller les élèves-maîtres en didactique des langues premières dans un contexte multilingue. La formation articule la connaissance du paysage sociolinguistique congolais, l’analyse des structures linguistiques, et l’application de méthodologies pédagogiques adaptées pour faire des langues nationales le socle effectif des premiers apprentissages scolaires.
2. Objectifs généraux de la formation
À l’issue de cette formation, le futur enseignant devra être capable de :
- Décrire la situation sociolinguistique de la RDC et les statuts respectifs des langues en présence.
- Analyser les structures phonologiques, morphosyntaxiques et lexicales fondamentales des quatre langues nationales.
- Appliquer les principes de la didactique des langues premières pour enseigner l’oral, la lecture et l’écriture.
- Gérer la transition linguistique entre la langue nationale (L1) et le français (L2) selon les directives du programme national.
- Élaborer des leçons et du matériel didactique contextualisés et pertinents pour l’enseignement des langues nationales.
3. Orientations méthodologiques
Le cours adopte une démarche à la fois comparative et communicative. L’approche comparative permettra de mettre en évidence les convergences et les divergences entre les quatre langues nationales, facilitant ainsi leur apprentissage simultané. L’approche communicative privilégiera l’usage actif des langues dans des situations de communication authentiques. Des ateliers pratiques, des simulations de classe (micro-enseignement) et l’analyse de supports réels (contes, chansons) constitueront les modalités de travail principales. L’accent sera mis sur la construction de compétences pratiques directement transposables en classe primaire.
4. Matériel didactique requis
La mise en œuvre de ce cours exige l’accès à des ressources spécifiques. Celles-ci incluent les grammaires de référence et les dictionnaires pour chaque langue nationale, des recueils de littérature orale (contes, proverbes, mythes), des manuels scolaires officiels du niveau primaire, ainsi que des supports audiovisuels illustrant les différentes variétés dialectales. La création de matériel par les futurs enseignants eux-mêmes (imagiers, fiches d’exercices, jeux de société) est une composante essentielle de la formation.
PREMIÈRE PARTIE : FONDEMENTS THÉORIQUES ET CONTEXTUELS DES LANGUES NATIONALES
Chapitre I : Panorama sociolinguistique de la République Démocratique du Congo
1.1 Situation linguistique générale de la RDC
Cette section dresse le portrait de la complexité linguistique du pays, qui compte plus de deux cents langues. Elle établit la distinction entre langue officielle (français), langues nationales véhiculaires, et langues vernaculaires locales, en expliquant leurs fonctions sociales respectives.
1.2 Répartition géographique des quatre langues nationales
Une cartographie précise de l’extension des quatre langues nationales est présentée. Le lingala est associé au grand bassin du fleuve Congo, de Kinshasa à Kisangani ; le kiswahili couvre toute la partie Est, du Tanganyika au Haut-Uele ; le ciluba est la langue de l’espace Kasaïen ; et le kikongo est parlé dans l’ouest du pays, notamment au Kongo-Central.
1.3 Statut constitutionnel et légal des langues nationales
L’analyse porte sur les textes juridiques qui régissent le statut des langues en RDC. La Constitution et les lois sur l’éducation sont examinées pour clarifier le rôle assigné aux langues nationales dans la vie publique, l’administration et, de manière prépondérante, dans le système éducatif.
1.4 Politique linguistique éducative nationale
Ce point détaille la stratégie de l’État en matière de langues d’enseignement. Il expose le modèle préconisé, qui utilise une langue nationale comme principal médium d’instruction durant les premières années du cycle primaire avant d’assurer une transition progressive vers le français.
Chapitre II : Caractéristiques générales des langues bantoues congolaises
2.1 Classification linguistique des langues nationales
Les quatre langues nationales sont situées au sein de la grande famille des langues bantoues. Leur classification selon les zones de Guthrie est expliquée, mettant en lumière leurs liens de parenté et leur origine commune.
2.2 Structures phonologiques communes
Cette section explore les traits phonologiques partagés, tels que la structure syllabique C-V (consonne-voyelle), l’existence de systèmes tonals (tons hauts, bas) qui jouent un rôle grammatical et lexical, et la présence de voyelles orales simples.
2.3 Systèmes morphosyntaxiques partagés
L’étude se concentre sur les caractéristiques grammaticales typiques des langues bantoues : le système des classes nominales qui régit l’accord dans toute la phrase, et la morphologie verbale agglutinante où le verbe intègre de nombreux affixes (sujet, objet, temps, aspect, mode).
2.4 Variations dialectales et régionales
La distinction entre la langue standardisée (utilisée dans l’enseignement et les médias) et ses multiples variétés parlées est établie. Des exemples concrets, comme les différences entre le kiswahili de Lubumbashi et celui de Bukavu, illustrent ce phénomène de variation.
Chapitre III : Histoire et évolution des langues nationales
3.1 Origines et développement historique
Ce chapitre retrace l’histoire de l’émergence et de l’expansion de ces langues, liée aux migrations des peuples bantous et au développement des grands empires précoloniaux (Kongo, Luba, Lunda).
3.2 Influences et contacts linguistiques
L’analyse porte sur l’impact des contacts avec d’autres langues. Sont examinés les emprunts lexicaux au français, au portugais (pour le kikongo), à l’arabe (pour le kiswahili) et aux langues locales voisines, montrant comment ces langues se sont enrichies au fil du temps.
3.3 Standardisation et normalisation
Le processus de standardisation de chaque langue est détaillé, en soulignant le rôle crucial des missionnaires et des linguistes congolais dans la création des premières grammaires, dictionnaires et transcriptions écrites, qui ont permis leur usage dans l’enseignement.
3.4 Littérature orale et écrite traditionnelle
Ce point met en valeur la richesse du patrimoine littéraire oral (contes, proverbes, épopées) comme premier corpus de textes. L’émergence progressive d’une littérature écrite dans ces langues est également abordée.
DEUXIÈME PARTIE : ÉTUDE APPROFONDIE DES QUATRE LANGUES NATIONALES
Chapitre IV : Le Kikongo
4.1 Phonologie et système phonémique du kikongo
Description de l’inventaire des consonnes et des voyelles du kikongo, avec une attention particulière pour les phénomènes de prénasalisation des consonnes.
4.2 Morphologie nominale et verbale
Examen détaillé du système de classes nominales (environ 15 classes) et des mécanismes d’accord. La conjugaison verbale est étudiée à travers ses principaux temps et modes.
4.3 Syntaxe et structure phrastique
Analyse de l’ordre canonique des mots dans la phrase simple (SVO) et de la structure du groupe nominal.
4.4 Lexicologie et champs sémantiques
Étude du vocabulaire de base et des champs sémantiques spécifiques, notamment ceux liés à la culture et à l’organisation sociale du peuple kongo.
4.5 Variétés régionales du kikongo
Présentation des principales variantes dialectales, incluant le kikongo ya Leta, la forme véhiculaire simplifiée utilisée comme langue de communication interethnique.
Chapitre V : Le Lingala
5.1 Phonologie et système phonémique du lingala
Inventaire des phonèmes du lingala, caractérisé par son système à sept voyelles et l’harmonie vocalique qui en découle.
5.2 Morphologie nominale et verbale
Analyse du système de classes nominales et des conjugaisons verbales, en soulignant sa relative régularité qui facilite son apprentissage.
5.3 Syntaxe et structure phrastique
Étude de la syntaxe de base, de la formation des phrases interrogatives et négatives.
5.4 Lexicologie et champs sémantiques
Exploration du lexique lingala, marqué par de nombreux emprunts au français et à d’autres langues congolaises, le rendant particulièrement dynamique et adapté à la vie urbaine.
5.5 Variétés régionales du lingala
Distinction entre le lingala classique (parlé dans la province de l’Équateur) et le lingala populaire de Kinshasa, qui intègre de nombreux néologismes et particularités.
Chapitre VI : Le Kiswahili
6.1 Phonologie et système phonémique du kiswahili
Présentation du système phonologique, notable pour sa simplicité (cinq voyelles) et son absence de tons, ce qui le distingue de la plupart des autres langues bantoues.
6.2 Morphologie nominale et verbale
Étude approfondie du système de classes nominales et de la structure complexe du verbe swahili, qui peut intégrer jusqu’à huit morphèmes différents.
6.3 Syntaxe et structure phrastique
Analyse de la syntaxe SVO et des règles d’accord rigoureuses entre le nom et les autres constituants de la phrase.
6.4 Lexicologie et champs sémantiques
Mise en évidence de la richesse du lexique swahili, avec ses fortes influences arabes et sa capacité à former de nouveaux mots par dérivation.
6.5 Variétés régionales du kiswahili
Présentation des particularités du swahili congolais (Kingwana), notamment ses simplifications morphologiques et ses emprunts au français et aux langues locales de l’Est de la RDC.
Chapitre VII : Le Ciluba (Tshiluba)
7.1 Phonologie et système phonémique du ciluba
Description du système phonologique, qui inclut des consonnes spécifiques et un système tonal complexe essentiel à la distinction sémantique des mots.
7.2 Morphologie nominale et verbale
Analyse du système de classes nominales et des conjugaisons, en portant une attention particulière aux phénomènes de sandhi tonal (modification des tons au contact des mots).
7.3 Syntaxe et structure phrastique
Étude de la phrase simple et des procédés de construction des phrases complexes.
7.4 Lexicologie et champs sémantiques
Exploration du vocabulaire propre à la culture Luba, particulièrement riche dans les domaines de la parenté, de la royauté et de la spiritualité.
7.5 Variétés régionales du ciluba
Présentation des deux principales variantes dialectales : le ciluba du Kasaï-Occidental et celui du Kasaï-Oriental, avec leurs différences phonétiques et lexicales.
TROISIÈME PARTIE : DIDACTIQUE DES LANGUES NATIONALES
Chapitre VIII : Principes didactiques généraux
8.1 Approche communicative adaptée aux langues nationales
Ce point explique comment centrer l’enseignement sur le développement de la capacité à communiquer efficacement (comprendre et se faire comprendre) plutôt que sur la mémorisation de règles de grammaire abstraites.
8.2 Méthodes d’enseignement-apprentissage des langues premières
Présentation des méthodes spécifiquement conçues pour des élèves qui ont déjà une connaissance intuitive de la langue (locuteurs natifs), en se concentrant sur la structuration et l’enrichissement de leurs compétences existantes.
8.3 Progression pédagogique dans l’enseignement des langues nationales
Élaboration d’une progression logique des apprentissages, de l’oral à l’écrit, et du simple au complexe, en respectant les étapes du développement cognitif de l’enfant.
8.4 Gestion de la classe multilingue
Fourniture de stratégies pour gérer une classe où plusieurs langues maternelles sont présentes, en utilisant cette diversité comme une richesse plutôt que comme un obstacle.
Chapitre IX : Didactique de l’expression orale
9.1 Développement des compétences d’écoute
Techniques pour améliorer la compréhension orale à travers des activités d’écoute de contes, de chansons, ou de consignes.
9.2 Techniques d’expression orale spontanée
Méthodes pour encourager la prise de parole des élèves à travers des jeux de rôle, des débats simples et des descriptions d’images ou d’événements.
9.3 Récitation et déclamation
Utilisation de la poésie, des comptines et des proverbes pour travailler la diction, l’intonation et la mémoire.
9.4 Communication interpersonnelle et de groupe
Activités visant à développer les habiletés sociales en langue nationale : savoir poser une question, formuler une demande polie, participer à une conversation.
Chapitre X : Didactique de la lecture-écriture en langues nationales
10.1 Méthodes d’apprentissage de la lecture
Comparaison et application des différentes méthodes (syllabique, globale, mixte) en tenant compte de la structure phonétique régulière des langues nationales, qui se prêtent bien à une approche syllabique.
10.2 Techniques d’initiation à l’écriture
Progression allant du graphisme (maîtrise du geste d’écriture) à l’encodage des sons en lettres, puis à la copie et à la production de mots et de phrases simples.
10.3 Compréhension de textes en langues nationales
Stratégies pour développer la capacité à comprendre un texte lu : repérer les informations explicites, faire des inférences, identifier l’idée principale.
10.4 Production écrite progressive
Activités de production écrite guidée, de la rédaction de phrases simples à l’écriture de courts récits ou de descriptions, en s’appuyant sur des modèles.
Chapitre XI : Grammaire pédagogique des langues nationales
11.1 Simplification des règles grammaticales pour l’enseignement
Techniques pour formuler des règles de grammaire de manière simple, inductive et fonctionnelle, en partant d’exemples concrets plutôt que de définitions abstraites.
11.2 Exercices d’application grammaticale
Création d’exercices structuraux (exercices à trous, substitutions, transformations) qui permettent d’automatiser l’application des règles grammaticales.
11.3 Correction des erreurs fréquentes
Identification des erreurs typiques des apprenants et développement de stratégies de correction formative qui aident l’élève à comprendre et à se corriger.
11.4 Métalangage pédagogique approprié
Choix de termes simples et unifiés pour parler de la langue en classe (par exemple, « le mot qui nomme », « le mot qui dit l’action ») avant d’introduire la terminologie grammaticale formelle.
QUATRIÈME PARTIE : BILINGUISME ET ENSEIGNEMENT MULTILINGUE
Chapitre XII : Théories du bilinguisme appliquées au contexte congolais
12.1 Types de bilinguisme observés en RDC
Analyse des différentes formes de bilinguisme (équilibré, dominant, additif, soustractif) présentes chez les élèves congolais, qui sont souvent plurilingues avant même d’entrer à l’école.
12.2 Acquisition simultanée et successive des langues
Étude des processus cognitifs impliqués lorsque l’enfant apprend plusieurs langues en même temps (dans la famille) ou l’une après l’autre (à l’école).
12.3 Transferts linguistiques et interférences
Examen de la manière dont la connaissance de la langue nationale peut faciliter (transfert positif) ou gêner (interférence) l’apprentissage du français, et vice-versa.
12.4 Développement de la compétence bilingue
Stratégies pour assurer un développement harmonieux des compétences dans les deux langues, en valorisant la langue première comme un tremplin pour l’apprentissage de la seconde.
Chapitre XIII : Didactique convergente des langues
13.1 Principes de la pédagogie convergente
Explication de cette approche qui consiste à s’appuyer sur les acquis en langue nationale pour enseigner le français, en créant des ponts systématiques entre les deux langues.
13.2 Articulation langues nationales-français
Méthodes pour comparer explicitement le fonctionnement des deux langues (par exemple, la structure de la phrase, la formation des pluriels) afin de rendre les transferts conscients.
13.3 Activités de transfert interlinguistique
Exemples d’activités concrètes : traduire des phrases simples, trouver des équivalents lexicaux, comparer les sons de chaque langue.
13.4 Évaluation en contexte multilingue
Développement d’outils d’évaluation qui prennent en compte la compétence globale de l’élève dans toutes les langues qu’il maîtrise, sans les opposer.
Chapitre XIV : Gestion de la transition linguistique
14.1 Passage progressif de la langue nationale au français
Planification de la transition du statut de la langue nationale (médium d’enseignement) à celui de discipline enseignée, tout en introduisant le français de manière graduelle, d’abord à l’oral.
14.2 Maintien et développement des langues nationales
Stratégies pour que les langues nationales continuent d’être valorisées et pratiquées à l’école même après que le français soit devenu la principale langue d’enseignement.
14.3 Stratégies de motivation pour l’apprentissage multilingue
Techniques pour développer une attitude positive chez les élèves envers toutes les langues de leur répertoire, en montrant les avantages cognitifs et sociaux du plurilinguisme.
14.4 Implication des familles dans le processus
Méthodes pour collaborer avec les parents, souvent locuteurs natifs, afin de soutenir les apprentissages linguistiques de l’enfant à la maison et de valoriser la langue familiale.
CINQUIÈME PARTIE : PLANIFICATION ET ÉVALUATION
Chapitre XV : Planification de l’enseignement des langues nationales
15.1 Analyse des programmes officiels
Lecture et interprétation des programmes scolaires pour identifier les compétences à développer et les contenus à enseigner à chaque niveau du cycle primaire.
15.2 Élaboration de progressions annuelles et trimestrielles
Apprentissage de la planification à long et moyen terme, en répartissant les apprentissages de manière équilibrée sur l’année scolaire.
15.3 Préparation de leçons en langues nationales
Maîtrise de la conception d’une fiche de préparation de leçon, en définissant des objectifs d’apprentissage précis, un déroulement d’activités cohérent et des modalités d’évaluation.
15.4 Adaptation aux réalités locales et régionales
Capacité à ajuster la planification et le contenu des leçons en fonction de la langue nationale effectivement parlée dans le milieu de l’école et des ressources culturelles locales.
Chapitre XVI : Ressources et supports didactiques
16.1 Sélection et adaptation de textes authentiques
Critères pour choisir des textes (contes, chansons, articles de journaux locaux) adaptés au niveau des élèves et techniques pour les simplifier ou les exploiter pédagogiquement.
16.2 Création de matériel didactique contextualisé
Ateliers pratiques pour fabriquer du matériel simple et peu coûteux (imagiers, jeux de cartes, affiches) qui soit culturellement pertinent pour les élèves.
16.3 Utilisation du patrimoine oral traditionnel
Méthodologie pour collecter des récits auprès des anciens de la communauté et les utiliser comme supports d’apprentissage riches de sens pour l’écoute, le débat et la lecture.
16.4 Intégration des supports multimédias
Exploration des possibilités offertes par les outils numériques (téléphones, radios) pour faire écouter des enregistrements en langues nationales ou pour créer de petits projets audiovisuels.
Chapitre XVII : Évaluation des apprentissages en langues nationales
17.1 Élaboration d’outils d’évaluation appropriés
Conception de tests, de grilles d’observation et de listes de contrôle pour mesurer de manière fiable les compétences des élèves.
17.2 Évaluation des compétences orales
Techniques pour évaluer l’expression et la compréhension orales de manière objective, par exemple à travers des mises en situation ou des jeux de rôle notés à l’aide d’une grille de critères.
17.3 Évaluation des compétences écrites
Méthodes pour évaluer la lecture (fluidité, compréhension) et l’écriture (orthographe, grammaire, production de texte) à travers des exercices variés comme la dictée ou la rédaction.
17.4 Remédiation et différenciation pédagogique
Stratégies pour analyser les résultats des évaluations afin d’identifier les difficultés des élèves et de mettre en place des activités de soutien personnalisées.
Chapitre XVIII : Défis et perspectives d’avenir
18.1 Obstacles à l’enseignement des langues nationales
Analyse lucide des défis : manque de matériel didactique standardisé, faible valorisation sociale de ces langues par rapport au français, et formation parfois insuffisante des enseignants.
18.2 Solutions innovantes et bonnes pratiques
Présentation d’initiatives réussies et de projets innovants menés en RDC ou ailleurs en Afrique pour promouvoir l’enseignement des langues nationales.
18.3 Formation continue des enseignants
Examen de l’importance pour les enseignants de continuer à se former tout au long de leur carrière afin de maintenir et d’améliorer leurs compétences linguistiques et didactiques.
18.4 Développement durable des langues nationales
Réflexion sur le rôle de l’école comme acteur clé dans la préservation et la promotion du patrimoine linguistique congolais pour les générations futures.
ANNEXES
Annexe A : Corpus de textes en quatre langues nationales
Cette annexe offre un recueil de textes authentiques (contes, fables, chansons) dans chaque langue. Elle sert de matériel de base pour les analyses linguistiques et les applications didactiques durant la formation.
Annexe B : Grilles d’analyse comparative des structures linguistiques
Des tableaux synoptiques sont fournis pour comparer visuellement les systèmes de classes nominales, les conjugaisons de base et les structures de phrases des quatre langues. C’est un outil d’étude et de référence rapide pour le futur enseignant.
Annexe C : Modèles de fiches pédagogiques par langue
Cette section propose des exemples concrets de fiches de préparation de leçon pour chaque langue. Ces modèles servent de guide pratique pour les étudiants lorsqu’ils élaborent leurs propres leçons.
Annexe D : Instruments d’évaluation standardisés
Des exemples d’outils d’évaluation (tests de lecture, grilles d’observation de l’oral, dictées étalonnées) sont mis à disposition. Ils peuvent être adaptés et utilisés par les enseignants dans leurs futures classes.
Annexe E : Ressources bibliographiques et références normatives
Cette dernière annexe liste les ouvrages fondamentaux (grammaires, dictionnaires, études sociolinguistiques) et les documents officiels relatifs à la politique linguistique. Elle constitue une base pour l’approfondissement personnel des connaissances.