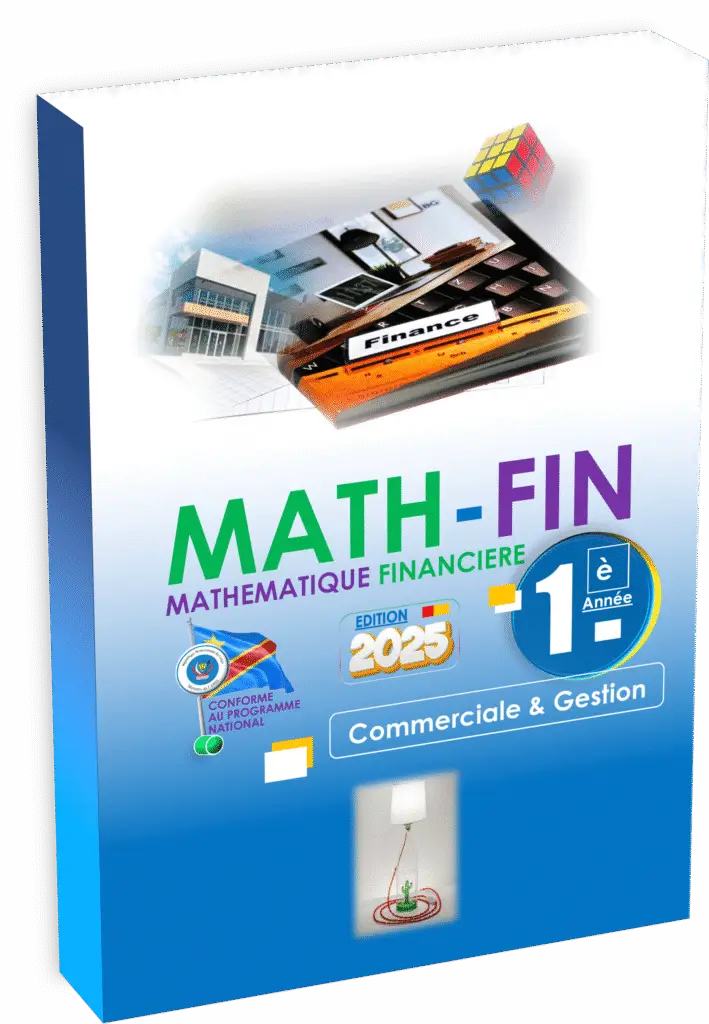
Cliquez pour lire
PRÉLIMINAIRES
Cette section introductive établit le cadre conceptuel et pédagogique du cours de Mathématiques Financières pour la première année du cycle. La finalité est de doter l’élève des compétences calculatoires fondamentales indispensables à la compréhension des mécanismes commerciaux et financiers. L’approche méthodologique privilégie une démarche active, partant de situations-problèmes concrètes issues du contexte socio-économique congolais, pour amener l’apprenant à maîtriser les outils mathématiques non comme une fin en soi, mais comme un instrument stratégique au service de la gestion.
0.1. Objectifs du cours
Le cours vise à développer chez l’élève la capacité à appliquer les méthodes de calcul commercial pour résoudre des problèmes comptables et financiers. Il s’agit de le rendre apte à manipuler les pourcentages, les proportions, et les principes de l’intérêt simple, de l’escompte et du change, assurant ainsi une base solide pour les apprentissages ultérieurs en gestion.
0.2. Compétences visées
Au terme de ce cours, l’élève devra être capable de :
- Maîtriser les quatre opérations fondamentales avec rapidité et précision.
- Calculer et appliquer des pourcentages à des grandeurs commerciales (prix, quantités).
- Répartir des grandeurs de manière proportionnelle.
- Calculer un intérêt simple et un escompte commercial.
- Effectuer des conversions monétaires simples.
- Résoudre des problèmes de répartition de bénéfices dans une société.
0.3. Approche méthodologique
L’enseignement s’appuiera sur des études de cas et des exercices pratiques contextualisés. L’utilisation de documents commerciaux authentiques (factures, bordereaux) sera encouragée pour illustrer les calculs. La résolution de problèmes en groupe favorisera le développement de la logique et de la rigueur, préparant l’élève aux exigences du monde professionnel.
PARTIE I : FONDEMENTS DE L’ARITHMÉTIQUE COMMERCIALE 📊
Cette première partie a pour vocation de consolider et d’orienter les acquis de l’élève en arithmétique vers des applications purement commerciales. Elle constitue le socle indispensable sur lequel reposeront tous les développements ultérieurs des mathématiques financières. L’accent est mis sur la maîtrise parfaite des outils de base comme le calcul rapide, les pourcentages et les proportions, en les sortant de leur cadre abstrait pour les ancrer dans la réalité des transactions commerciales, qu’il s’agisse de la fixation d’un prix de vente au marché central de Kinshasa ou du calcul d’une remise sur un achat de produits agricoles à Bukavu.
Chapitre 1 : Outils de Calcul Essentiels
1.1. Procédés de Calcul Rapide
1.1.1. L’Addition et la Soustraction
Cette section renforce la maîtrise des opérations d’addition et de soustraction, en insistant sur les techniques de calcul mental et de vérification (preuve par 9) pour garantir l’exactitude des résultats dans des situations de gestion de caisse ou d’inventaire rapide.
1.1.2. La Multiplication et la Division
La maîtrise des techniques de multiplication et de division est ici approfondie, avec un focus sur les cas pratiques tels que le calcul du montant total d’un lot de marchandises ou la détermination d’un coût unitaire.
1.2. Le Pourcentage
1.2.1. Définition et principes
Sont exposés ici les concepts fondamentaux du pourcentage comme expression d’une proportion par rapport à cent. La manipulation des formules de base (calcul d’un pourcentage, application d’un taux, recherche du taux ou de la base) est systématiquement exercée.
1.2.2. Application aux prix : majorations et réductions
Ce point aborde l’application directe des pourcentages dans la vie commerciale : calcul de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), détermination d’un prix de vente hors taxe, application de remises, rabais et ristournes sur une facture.
1.2.3. Application aux quantités physiques
L’utilisation des pourcentages est étendue à des grandeurs non monétaires, comme le calcul du taux de perte lors du transport de denrées périssables entre le Kongo Central et Kinshasa ou la détermination de la part d’un composant dans un produit fini.
Chapitre 2 : Rapports et Proportions
2.1. La Règle de Trois
2.1.1. Principe de la Règle de Trois simple
La logique de la « règle de trois » ou « quatrième proportionnelle » est ici décortiquée comme un outil fondamental pour résoudre une multitude de problèmes commerciaux où trois valeurs sont connues et une quatrième est recherchée.
2.1.2. Grandeurs directement et inversement proportionnelles
L’élève apprend à distinguer les situations où les grandeurs varient dans le même sens (proportionnalité directe, ex: quantité et prix) de celles où elles varient en sens inverse (proportionnalité inverse, ex: nombre d’ouvriers et temps de travail), et à adapter son raisonnement en conséquence.
2.2. Les Partages Proportionnels
2.2.1. Principe des partages proportionnels
Ce sous-chapitre introduit les méthodes de répartition d’une somme (bénéfice, héritage, prime) en parts directement ou inversement proportionnelles à des nombres donnés, un concept essentiel en droit des sociétés et en gestion.
2.2.2. Applications pratiques
Des cas concrets de partages proportionnels sont traités, allant de la répartition simple à des cas complexes impliquant plusieurs critères de répartition, préparant ainsi l’élève à la résolution de problèmes de la « règle de société ».
PARTIE II : CALCULS FINANCIERS À COURT TERME 💰
Cette deuxième partie marque l’entrée effective dans le domaine des mathématiques financières en se concentrant sur les deux opérations fondamentales du court terme : la rémunération du capital (l’intérêt) et la mobilisation des créances (l’escompte). L’objectif est de permettre à l’élève de comprendre et de calculer le coût ou le produit d’une opération financière simple, compétence indispensable pour tout agent économique. Les exemples s’inspireront des pratiques des institutions de microfinance de Goma ou des conditions de crédit fournisseur proposées aux commerçants de Lubumbashi.
Chapitre 3 : L’Intérêt Simple
3.1. Concepts Fondamentaux de l’Intérêt
3.1.1. Définition et terminologie (Capital, Taux, Temps, Intérêt)
Les quatre grandeurs fondamentales de l’intérêt simple sont définies avec rigueur. L’élève apprend à identifier chaque variable dans une situation donnée et à comprendre leur interrelation à travers la formule de base de l’intérêt.
3.1.2. Distinction entre Intérêt commercial et Intérêt civil
La différence conceptuelle et calculatoire entre l’année commerciale (360 jours) et l’année civile (365 ou 366 jours) est expliquée, en soulignant l’usage prédominant de l’année commerciale dans les transactions bancaires et financières.
3.2. Méthodes de Calcul de l’Intérêt Simple
3.2.1. La méthode simple (formule générale)
Cette section est consacrée à l’application systématique de la formule et de ses dérivées pour trouver l’une des quatre grandeurs, les trois autres étant connues.
3.2.2. Les méthodes commerciales (nombres et diviseurs fixes, parties aliquotes)
Sont introduites ici des techniques de calcul rapide utilisées par les praticiens pour calculer l’intérêt sur une série de capitaux placés à des durées différentes. Ces méthodes visent à optimiser le temps de calcul tout en garantissant la précision.
Chapitre 4 : L’Escompte
4.1. Principes de l’Escompte
4.1.1. Définition et concepts clés
L’escompte est présenté comme la retenue effectuée par un banquier sur un effet de commerce en cas de négociation avant son échéance. Les concepts de valeur nominale, valeur actuelle et échéance sont clairement définis.
4.1.2. Distinction entre l’escompte commercial (en dehors) et l’escompte rationnel (en dedans)
La différence fondamentale entre l’escompte commercial, calculé sur la valeur nominale, et l’escompte rationnel, calculé sur la valeur actuelle, est établie. L’élève apprendra pourquoi l’escompte commercial est systématiquement utilisé en pratique bancaire.
4.2. Pratique de l’Escompte
4.2.1. Calcul de la valeur actuelle
L’élève s’exerce au calcul de la somme effectivement perçue par le porteur d’un effet de commerce après déduction de l’escompte, en appliquant les formules de la valeur actuelle commerciale.
4.2.2. Le bordereau d’escompte et le calcul de l’agio
Le calcul est complexifié pour refléter la réalité bancaire par l’introduction du bordereau d’escompte, qui inclut, en plus de l’escompte proprement dit, diverses commissions et taxes formant l’agio, coût total de l’opération pour l’entreprise.
PARTIE III : APPLICATIONS SPÉCIFIQUES À LA GESTION D’ENTREPRISE 🌍
Cette dernière partie vise à appliquer les outils mathématiques étudiés à des problématiques concrètes et transversales de la gestion d’entreprise en République Démocratique du Congo. Il s’agit de montrer comment les calculs financiers irriguent différentes fonctions de l’entreprise, de la gestion de trésorerie internationale à la répartition des résultats entre associés. Les exemples porteront sur la conversion des recettes d’exportation de minerais du Katanga ou sur la répartition des bénéfices d’une coopérative agricole du Kivu.
Chapitre 5 : Opérations de Change
5.1. Notions de Base du Change
5.1.1. Définitions : monnaie, change, conversion, cotes
Ce point introduit le vocabulaire technique lié aux opérations de change, en expliquant les notions de cours d’achat, cours de vente et de cotation au certain ou à l’incertain, dans le contexte de la dualité monétaire (Franc Congolais – Dollar Américain) caractéristique de l’économie nationale.
5.1.2. Application de la règle de change
Des exercices pratiques permettent à l’élève de maîtriser la conversion d’une monnaie à une autre en appliquant le bon cours (achat ou vente) selon le sens de l’opération, une compétence cruciale pour toute entreprise impliquée dans le commerce international.
Chapitre 6 : La Règle de Société
6.1. Principe de Répartition des Résultats
Ce chapitre expose la méthode de répartition des bénéfices ou des pertes d’une société entre ses associés, conformément aux stipulations des statuts ou, à défaut, proportionnellement à leurs apports en capital.
6.2. Cas Pratiques de Répartition
6.2.1. Cas des durées et mises égales
Le cas le plus simple de répartition, où les capitaux investis et les durées d’investissement sont identiques pour tous les associés, menant à un partage en parts égales.
6.2.2. Cas des durées égales et mises inégales
La répartition s’effectue ici proportionnellement aux capitaux apportés par chaque associé, la durée d’investissement étant la même pour tous.
6.2.3. Cas des durées inégales et mises égales
Ici, la répartition est proportionnelle à la durée pendant laquelle le capital de chaque associé a été engagé dans l’entreprise, les mises initiales étant identiques.
6.2.4. Cas des durées et mises inégales
Ce dernier cas, le plus complexe et le plus réaliste, combine les deux critères précédents. La répartition se fait proportionnellement au produit des capitaux par leurs durées respectives d’investissement.
ANNEXES 📎
Les annexes regroupent un ensemble d’outils pratiques et de documents de référence destinés à faciliter le travail de l’élève et à l’ancrer davantage dans la pratique professionnelle. Elles constituent une ressource complémentaire pour la résolution des exercices et la préparation aux évaluations.
Annexe 1 : Grille de conversion des principales devises
Tableau de référence présentant les cours de change indicatifs du Franc Congolais (CDF) par rapport aux principales devises utilisées dans le commerce régional et international (USD, EUR, ZAR, TZS, etc.).
Annexe 2 : Modèles de bordereaux d’escompte
Présentation de modèles de bordereaux d’escompte utilisés par les banques congolaises, illustrant la structure de calcul de l’agio (escompte, commissions, TVA).
Annexe 3 : Glossaire des termes financiers
Un lexique définissant de manière claire et concise les principaux termes techniques rencontrés tout au long du cours, afin d’assurer une parfaite compréhension et une appropriation durable du vocabulaire professionnel.



