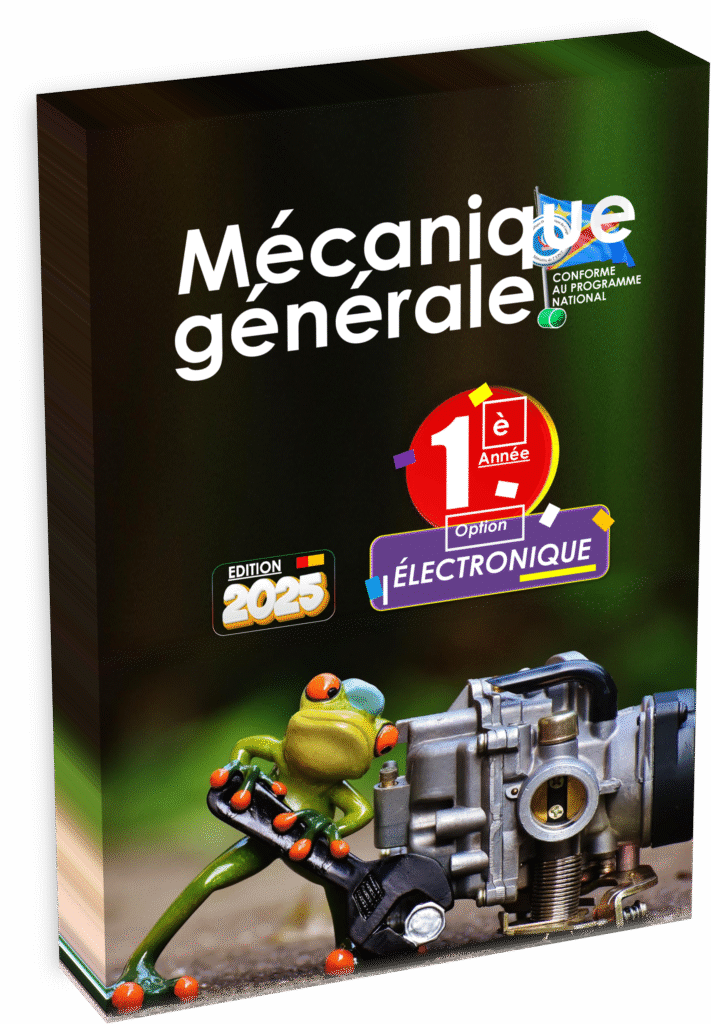
MECANIQUE GENERALE
1ÈRE ANNÉE – OPTION ÉLECTRONIQUE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
Préliminaires
1. Objectifs Généraux du Cours
Ce manuel a pour vocation de doter l’élève des outils conceptuels et mathématiques indispensables à l’analyse des systèmes mécaniques simples. Le cours établit les principes fondamentaux qui régissent le mouvement et l’équilibre des corps, constituant ainsi une base scientifique essentielle pour tout futur technicien. L’objectif est de permettre à l’élève de modéliser des situations physiques réelles, de les traduire en langage mathématique et d’en prédire l’évolution.
2. Compétences Visées
Au terme de cette année d’apprentissage, l’élève détiendra la capacité de :
- Appliquer les lois de la cinématique pour décrire quantitativement les mouvements rectilignes et circulaires.
- Utiliser les principes de la statique pour analyser les conditions d’équilibre d’un solide soumis à un ensemble de forces.
- Mettre en œuvre le principe fondamental de la dynamique pour relier les forces appliquées à l’accélération d’un corps.
- Calculer le travail, la puissance et l’énergie mécanique d’un système pour en analyser le comportement énergétique.
3. Approche Pédagogique
La démarche pédagogique privilégie une approche qui part de l’observation de phénomènes concrets pour aboutir à leur modélisation abstraite. Chaque loi ou principe est introduit à partir d’exemples pratiques avant d’être formalisé mathématiquement. La résolution de problèmes constitue le cœur de l’apprentissage, avec des exercices de difficulté progressive qui ancrent les connaissances. Des contextes variés, comme l’étude de la stabilité d’une grue sur un chantier à Lubumbashi ou le calcul de la vitesse d’un wagonnet minier au Kasaï, permettent d’illustrer la pertinence universelle des lois de la mécanique.
PREMIÈRE PARTIE : OUTILS ET CONCEPTS FONDAMENTAUX DE LA MÉCANIQUE 📐
Cette partie introductive met en place les fondations sur lesquelles repose toute l’étude de la mécanique. Avant d’analyser le mouvement ou l’équilibre, il est impératif de maîtriser le langage et les outils de description. L’élève y découvrira les grandeurs physiques pertinentes, le système international d’unités, la nécessité de la modélisation pour simplifier la réalité, et la puissance de l’outil vectoriel pour décrire les grandeurs qui possèdent à la fois une magnitude et une direction.
CHAPITRE 1 : GRANDEURS PHYSIQUES ET SYSTÈMES D’UNITÉS
1.1. Grandeurs physiques fondamentales et dérivées
Ce sous-chapitre introduit la distinction entre les grandeurs fondamentales (longueur, masse, temps) qui sont les piliers de la mécanique, et les grandeurs dérivées (vitesse, accélération, force) qui en découlent. La nécessité d’une définition précise et universelle pour chaque grandeur est mise en exergue.
1.2. Le Système International d’Unités (SI)
La standardisation des mesures est au cœur de la science. L’élève étudiera le Système International (SI) et ses unités de base pour la mécanique : le mètre (m), le kilogramme (kg) et la seconde (s). L’importance de l’homogénéité des formules physiques sera soulignée.
1.3. Multiples, sous-multiples et notation scientifique
La manipulation de nombres très grands ou très petits est courante en physique. L’élève apprendra à utiliser les préfixes normalisés (kilo, méga, milli, micro, etc.) et la notation scientifique pour exprimer les résultats de manière concise et pour faciliter les calculs.
1.4. Analyse dimensionnelle
L’analyse dimensionnelle est présentée comme un outil puissant pour vérifier la cohérence d’une formule physique. L’élève s’exercera à retrouver l’équation aux dimensions d’une grandeur dérivée et à contrôler la validité de ses propres résultats en s’assurant que les deux membres d’une équation ont la même dimension.
CHAPITRE 2 : LA MODÉLISATION EN MÉCANIQUE
2.1. Du système réel au modèle
Ce sous-chapitre explique que la première étape de toute étude mécanique consiste à simplifier le système réel en un modèle pertinent. L’élève apprendra à isoler le système d’étude et à identifier les hypothèses simplificatrices qui permettent de se concentrer sur l’essentiel du phénomène physique.
2.2. Le point matériel
Pour de nombreux problèmes où les dimensions de l’objet sont négligeables par rapport à celles de son mouvement (ex: un satellite en orbite), l’objet peut être modélisé par un point matériel. Ce modèle, qui ramène l’objet à un point géométrique doté d’une masse, simplifie considérablement l’étude de sa trajectoire.
2.3. Le solide indéformable
Lorsque les dimensions de l’objet et sa rotation potentielle sont importantes, on utilise le modèle du solide indéformable. L’élève comprendra que ce modèle considère l’objet comme un ensemble de points dont les distances mutuelles restent constantes, ce qui permet d’étudier à la fois sa translation et sa rotation.
2.4. Le référentiel d’étude
Le mouvement n’a de sens que s’il est décrit par rapport à un observateur ou un repère, appelé référentiel. Les concepts de référentiel terrestre et de référentiel galiléen (ou d’inertie) sont introduits, soulignant que les lois de la mécanique ne s’appliquent simplement que dans ce dernier.
CHAPITRE 3 : LE LANGAGE DES VECTEURS EN MÉCANIQUE
3.1. Grandeurs scalaires et grandeurs vectorielles
La distinction fondamentale entre les grandeurs scalaires (définies par un seul nombre, comme la masse ou le temps) et les grandeurs vectorielles (définies par une direction, un sens et une norme, comme la vitesse ou la force) est établie.
3.2. Représentation et caractéristiques d’un vecteur
L’élève apprendra à représenter graphiquement un vecteur par une flèche et à identifier ses quatre caractéristiques : son point d’application, sa direction (la droite qui le porte), son sens et sa norme (sa longueur, ou intensité).
3.3. Opérations sur les vecteurs : somme et différence
Les opérations vectorielles de base sont introduites. La somme de deux vecteurs par la méthode du parallélogramme ou par la relation de Chasles est détaillée graphiquement. La notion de vecteur opposé et la soustraction vectorielle en découlent naturellement.
3.4. Projection d’un vecteur sur des axes
Pour mener des calculs, il est indispensable de décomposer les vecteurs en composantes scalaires selon les axes d’un repère cartésien (O, x, y). L’élève s’exercera à projeter un vecteur et à utiliser la trigonométrie pour calculer ses composantes, une compétence transversale à toute la mécanique.
DEUXIÈME PARTIE : CINÉMATIQUE DU POINT MATÉRIEL – L’ÉTUDE DU MOUVEMENT 🏃
La cinématique est la branche de la mécanique qui décrit le mouvement des corps sans se préoccuper des causes qui le provoquent. Cette partie se concentre sur la description mathématique de la trajectoire, de la vitesse et de l’accélération. En analysant les types de mouvements les plus fondamentaux, du simple déplacement en ligne droite à vitesse constante jusqu’au mouvement circulaire, l’élève acquiert le vocabulaire et les outils mathématiques nécessaires pour quantifier tout type de déplacement.
CHAPITRE 4 : MOUVEMENT RECTILIGNE UNIFORME (MRU)
4.1. Trajectoire, vitesse et position
Le MRU est défini comme le mouvement d’un point se déplaçant en ligne droite à vitesse constante. Les concepts de trajectoire, de vitesse moyenne et de vitesse instantanée sont introduits.
4.2. Équations horaires du mouvement
L’élève apprendra à établir et à utiliser l’équation horaire de la position en MRU : . Cette relation mathématique permet de prédire la position du mobile à n’importe quel instant, connaissant sa vitesse et sa position initiale.
4.3. Représentations graphiques
Les lois du MRU sont traduites en graphiques. L’élève tracera et interprétera le diagramme de la vitesse (une droite horizontale) et le diagramme de la position (une droite affine), en comprenant la signification physique de la pente et de l’ordonnée à l’origine.
4.4. Problèmes de rencontre et de poursuite
Des problèmes classiques d’application sont résolus. L’élève mettra en équation des situations de rencontre ou de poursuite entre deux mobiles en MRU, par exemple deux pirogues naviguant sur le fleuve Congo, pour déterminer l’instant et le lieu de leur croisement.
CHAPITRE 5 : MOUVEMENT RECTILIGNE UNIFORMÉMENT VARIÉ (MRUV)
5.1. Le vecteur accélération
Le MRUV est caractérisé par une accélération constante. Le concept d’accélération est défini comme le taux de variation de la vitesse, et son unité (m/s²) est présentée. La distinction entre mouvement accéléré et mouvement retardé (décéléré) est établie.
5.2. Équations horaires du mouvement
Les deux équations horaires fondamentales du MRUV sont établies : celle de la vitesse, , et celle de la position, . L’élève s’exercera à les manipuler pour résoudre des problèmes.
5.3. Représentations graphiques
L’élève apprendra à tracer les diagrammes caractéristiques du MRUV : le diagramme de l’accélération (droite horizontale), le diagramme de la vitesse (droite affine dont la pente est l’accélération) et le diagramme de la position (parabole).
5.4. Relation indépendante du temps
Une relation très utile liant la vitesse et la distance parcourue sans faire intervenir le temps est démontrée : . Cette équation est particulièrement efficace pour résoudre des problèmes de freinage, comme celui d’un train arrivant en gare de Kananga.
CHAPITRE 6 : CHUTE LIBRE ET MOUVEMENT VERTICAL
6.1. Le champ de pesanteur terrestre
La chute des corps est un cas particulier de MRUV. L’élève apprendra que, en l’absence de frottement de l’air, tous les objets à la surface de la Terre chutent avec la même accélération, notée g, appelée accélération de la pesanteur (environ 9,81 m/s²).
6.2. Équations du mouvement de chute libre
Les équations du MRUV sont adaptées au cas de la chute libre verticale sans vitesse initiale. L’élève calculera la vitesse et la position d’un objet en fonction du temps de chute.
6.3. Lancement vertical vers le haut
Le cas d’un objet lancé verticalement vers le haut est analysé. L’élève étudiera la phase de montée (mouvement retardé) et la phase de descente (mouvement accéléré), et calculera la hauteur maximale atteinte ainsi que le temps de vol total.
6.4. Influence de la résistance de l’air
Ce sous-chapitre qualitatif (enrichissement) explique que dans la réalité, la résistance de l’air s’oppose au mouvement et ne peut être négligée pour les objets légers ou à grande vitesse. Le concept de vitesse limite est introduit.
CHAPITRE 7 : MOUVEMENT CIRCULAIRE UNIFORME (MCU)
7.1. Grandeurs angulaires
Pour décrire un mouvement circulaire, les grandeurs angulaires (position angulaire , vitesse angulaire ) sont plus adaptées que les grandeurs linéaires. L’élève apprendra à utiliser le radian comme unité d’angle et le rad/s pour la vitesse angulaire.
7.2. Période et fréquence
Le MCU est un mouvement périodique. Les notions de période (T), durée d’un tour complet, et de fréquence (f), nombre de tours par seconde, sont définies. La relation entre la fréquence et la vitesse angulaire () est établie.
7.3. Relation entre grandeurs linéaires et angulaires
Ce sous-chapitre établit le pont entre la description linéaire et la description angulaire. La relation entre la vitesse linéaire (ou circonférentielle) et la vitesse angulaire () est démontrée et appliquée, par exemple pour calculer la vitesse d’un point sur la pale d’une éolienne.
7.4. L’accélération centripète
Bien que la vitesse soit constante en norme dans un MCU, sa direction change constamment. L’élève découvrira qu’il existe donc une accélération, dirigée vers le centre du cercle, appelée accélération centripète ou normale, dont le module vaut .
TROISIÈME PARTIE : STATIQUE DU SOLIDE – L’ÉTUDE DE L’ÉQUILIBRE ⚖️
Après avoir décrit le mouvement, cette partie s’intéresse aux situations où il n’y a pas de mouvement, c’est-à-dire à l’équilibre. La statique est la branche de la mécanique qui étudie les conditions qu’un système de forces doit respecter pour qu’un objet reste immobile. Ces principes sont fondamentaux en génie civil et en conception mécanique pour assurer la stabilité et la résistance des structures, des machines et des bâtiments.
CHAPITRE 8 : PRINCIPE D’INERTIE ET ACTIONS MÉCANIQUES (FORCES)
8.1. Le principe d’inertie (Première loi de Newton)
Le principe d’inertie est énoncé : en l’absence de force extérieure, un corps au repos reste au repos et un corps en mouvement rectiligne uniforme continue sur sa lancée. Ce principe fondamental établit un lien entre la force et la variation du mouvement.
8.2. Le concept de force
Une force est définie comme toute cause capable de déformer un corps ou de modifier son état de mouvement. L’élève apprendra à modéliser une action mécanique (pousser, tirer, porter) par un vecteur force.
8.3. Inventaire des forces courantes
Les forces les plus fréquemment rencontrées en mécanique sont présentées : le poids (force de gravité), la réaction d’un support (force de contact), la tension d’un fil et la force de frottement. L’élève s’exercera à les identifier et à les représenter sur un schéma.
8.4. Le principe des actions réciproques (Troisième loi de Newton)
Le principe d’action-réaction est énoncé : si un corps A exerce une force sur un corps B, alors le corps B exerce sur A une force de même intensité, de même direction mais de sens opposé. Ce principe est crucial pour l’analyse des interactions entre objets.
CHAPITRE 9 : COMPOSITION DES FORCES ET ÉQUILIBRE D’UN POINT MATÉRIEL
9.1. Force résultante
La force résultante est la somme vectorielle de toutes les forces s’appliquant sur un corps. L’élève apprendra à calculer cette résultante, soit graphiquement par composition des vecteurs, soit analytiquement en additionnant leurs composantes.
9.2. Condition d’équilibre d’un point matériel
Un point matériel est en équilibre si et seulement si la somme vectorielle des forces qui s’exercent sur lui est nulle (). Cette condition simple est la clé de la résolution de tous les problèmes de statique du point.
9.3. Méthode de résolution graphique : le dynamique des forces
Pour un système de trois forces concourantes en équilibre, leurs vecteurs mis bout à bout forment un triangle fermé. Cette propriété est utilisée pour la résolution graphique de problèmes de statique, par exemple pour trouver les tensions dans les câbles soutenant un objet.
9.4. Méthode de résolution analytique : projection sur les axes
La méthode la plus générale consiste à projeter la condition d’équilibre vectorielle sur les axes d’un repère. L’élève apprendra à écrire les deux équations scalaires ( et ) et à résoudre le système d’équations pour trouver les forces inconnues.
CHAPITRE 10 : LE MOMENT D’UNE FORCE ET L’ÉQUILIBRE D’UN SOLIDE EN ROTATION
10.1. Effet de rotation d’une force : le moment
Une force appliquée à un solide peut non seulement le translater, mais aussi le faire tourner. Le moment d’une force par rapport à un axe est la grandeur qui quantifie cette capacité à provoquer une rotation. Sa définition (Moment = Force × bras de levier) est établie.
10.2. Le bras de levier
Le bras de levier est défini comme la distance perpendiculaire entre l’axe de rotation et la droite d’action de la force. L’élève s’exercera à l’identifier géométriquement dans diverses configurations.
10.3. Le couple de forces
Un couple est un ensemble de deux forces égales, parallèles et de sens contraires. L’élève apprendra qu’un couple ne provoque qu’une rotation pure (pas de translation) et que son moment est constant quel que soit le point de calcul.
10.4. Condition d’équilibre de rotation
Pour qu’un solide susceptible de tourner soit en équilibre, il faut non seulement que la somme des forces soit nulle, mais aussi que la somme des moments de toutes les forces par rapport à n’importe quel axe soit nulle ().
CHAPITRE 11 : CENTRE DE GRAVITÉ ET CONDITIONS GÉNÉRALES D’ÉQUILIBRE
11.1. Le centre de gravité
Le centre de gravité (G) d’un corps est le point d’application de son poids. Pour des objets homogènes et de forme simple (barre, disque, rectangle), sa position coïncide avec le centre géométrique.
11.2. Détermination expérimentale du centre de gravité
Une méthode simple pour trouver le centre de gravité d’un objet plat consiste à le suspendre par plusieurs points. L’élève apprendra que le centre de gravité se trouve à l’intersection des verticales passant par les points de suspension.
11.3. Les conditions générales d’équilibre du solide
Ce sous-chapitre synthétise les conditions nécessaires et suffisantes pour qu’un solide indéformable soit en équilibre statique : la somme vectorielle des forces extérieures doit être nulle, et la somme des moments de ces forces par rapport à un point quelconque doit être nulle.
11.4. Application à l’équilibre sur un plan incliné
Les principes de la statique sont appliqués à un problème classique : l’équilibre d’un objet sur un plan incliné, en présence de frottements. L’élève analysera les forces en jeu et déterminera les conditions pour que l’objet ne glisse pas, une situation pertinente pour la conception de systèmes de transport dans les mines de la région de Kipushi.
Annexes
1. Mémento des Formules Clés
Cette section fournirait un résumé de toutes les équations importantes de la cinématique, de la statique et de la dynamique vues durant l’année. Organisé par chapitre, cet outil servirait de référence rapide pour la résolution d’exercices.
2. Valeurs Physiques Usuelles
Un tableau regrouperait des valeurs numériques utiles en mécanique, comme l’accélération de la pesanteur (g) en différents points du globe, des coefficients de frottement typiques pour divers matériaux, et des masses volumiques de substances courantes.
3. Introduction à la Décomposition des Mouvements
Ce complément (enrichissement) introduirait le principe de l’indépendance des mouvements selon x et y, et l’appliquerait à l’étude de la trajectoire d’un projectile (mouvement parabolique). Cette section ouvrirait une perspective sur des problèmes de cinématique à deux dimensions.
4. Guide de Résolution de Problèmes en Mécanique
Une méthodologie structurée pour aborder un problème de mécanique serait proposée. Les étapes clés (lire et comprendre l’énoncé, faire un schéma, isoler le système, faire le bilan des forces, choisir le référentiel et les axes, appliquer les principes, résoudre et critiquer le résultat) seraient détaillées pour guider l’élève vers une résolution efficace et rigoureuse.