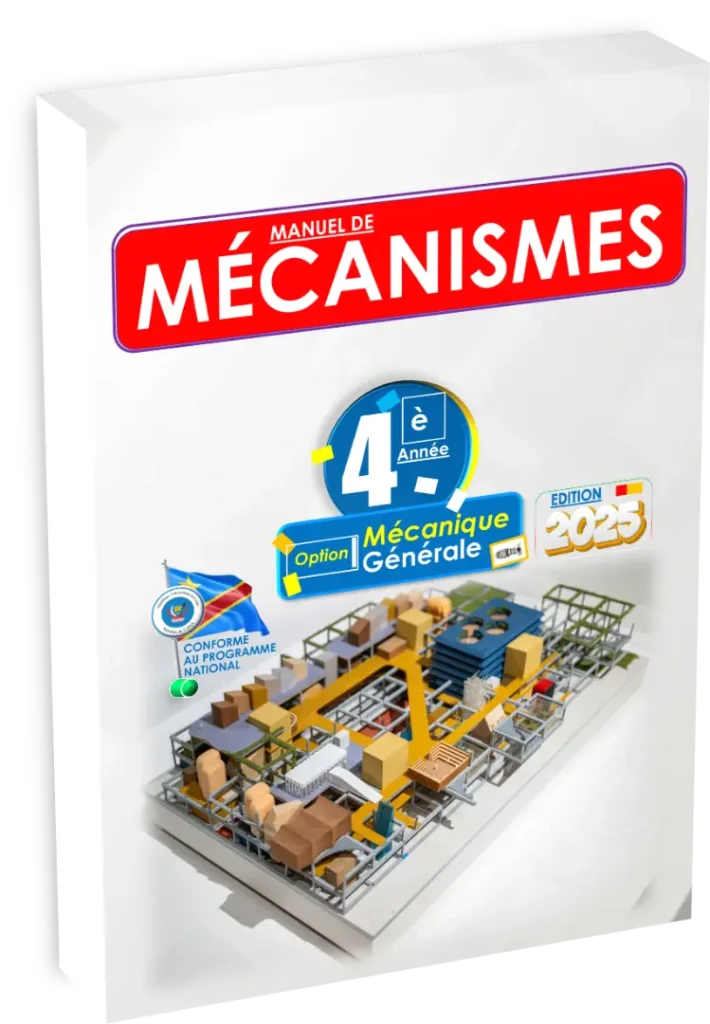
ÉTUDE ET CALCUL DES MÉCANISMES, 4 ÈME ANNEE, OPTION MECANIQUE GENERALE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
Préliminaires
Objectifs Pédagogiques du Cours 🎯
Ce cours constitue la synthèse ultime de la formation du technicien mécanicien, en fusionnant l’étude des mécanismes complexes avec l’application directe de la Résistance des Matériaux pour le dimensionnement. L’objectif est de rendre l’élève capable non seulement de décrire un mécanisme, mais aussi de le modéliser, d’en analyser les efforts et de calculer chacun de ses composants critiques. Au terme de cette année, l’apprenant doit pouvoir mener une analyse complète d’un système mécanique, depuis sa cinématique jusqu’au dimensionnement final de ses pièces, validant ainsi son aptitude à la conception et à la vérification.
Approche Didactique et Méthodologique 🛠️
L’enseignement est organisé en deux grandes phases complémentaires. La première phase est consacrée à l’étude technologique et cinématique de mécanismes avancés (réducteurs, variateurs, systèmes de transformation de mouvement) et d’appareils complets (levage). La seconde phase, intitulée « Résistance Appliquée », consiste en une série d’études de cas où les élèves appliquent les formules de RDM au calcul concret et intégral d’éléments de machines étudiés précédemment. Cette approche par problèmes permet de contextualiser et de donner un sens pratique aux outils de calcul, en formant des techniciens capables de justifier leurs choix de dimensionnement.
Contexte Industriel et Applications 🏭
Le cours s’ancre dans des applications industrielles concrètes et variées, reflétant les besoins du pays. L’étude des appareils de levage fait écho aux activités des ports de Matadi et de Boma, ainsi qu’aux chantiers de construction. L’analyse des réducteurs et des transmissions de puissance est directement liée à la maintenance des équipements de l’industrie minière du Katanga, des cimenteries du Kongo Central ou des usines de transformation agro-alimentaire. Chaque exercice de calcul est présenté comme la résolution d’un problème réel de technicien : « Ce câble résistera-t-il ? », « Quel diamètre pour cet arbre ? », « Combien de boulons pour cet assemblage ? ».
Partie I : Systèmes de Transmission et Variation de Vitesse
Cette partie explore les mécanismes sophistiqués conçus pour adapter la vitesse et le couple issus d’un moteur aux besoins d’une machine. Elle se concentre sur les systèmes à engrenages, qui sont au cœur de la transmission de puissance de haute performance.
Chapitre 1 : Les Réducteurs de Vitesse à Engrenages
Ce chapitre analyse la constitution et le fonctionnement des réducteurs, des boîtiers autonomes qui intègrent un train d’engrenages pour réduire la vitesse et augmenter le couple.
1.1. Fonction et Utilité des Réducteurs
Le rôle fondamental du réducteur de vitesse est expliqué : adapter la vitesse de rotation élevée d’un moteur électrique à la vitesse de travail, plus lente mais nécessitant plus de couple, d’une machine réceptrice (convoyeur, malaxeur, etc.).
1.2. Les Réducteurs à Axes Parallèles (Engrenages Cylindriques)
La technologie des réducteurs à un ou plusieurs étages d’engrenages cylindriques (à denture droite ou hélicoïdale) est présentée. L’analyse de leur schéma cinématique permet de calculer le rapport de réduction global.
1.3. Les Réducteurs à Axes Orthogonaux (Engrenages Coniques, Roue et Vis)
Les solutions pour transmettre la puissance entre des axes perpendiculaires sont étudiées : le réducteur à couple conique et le réducteur à roue et vis sans fin, ce dernier étant remarquable par sa capacité à offrir de très grands rapports de réduction et un caractère souvent irréversible.
1.4. Lubrification et Étanchéité des Carters de Réducteur
Les aspects technologiques liés à la vie du réducteur sont abordés : les méthodes de lubrification des engrenages (barbotage, projection) et les solutions d’étanchéité des arbres d’entrée et de sortie pour éviter les fuites d’huile.
Chapitre 2 : Les Trains d’Engrenages Épicycloïdaux
Ce chapitre est consacré à l’étude des trains épicycloïdaux, des mécanismes compacts et performants dont la cinématique complexe offre de vastes possibilités.
2.1. Constitution d’un Train Épicycloïdal Simple
La constitution d’un train planétaire est décrite : un planétaire central, des satellites, un porte-satellites et une couronne. La notion d’axes mobiles des satellites est mise en avant comme la clé de leur fonctionnement.
2.2. La Formule de Willis pour le Calcul du Rapport
La formule de Willis est introduite comme l’outil mathématique indispensable pour analyser la cinématique complexe de ces trains et calculer le rapport de transmission en fonction de l’élément qui est bloqué (planétaire, couronne ou porte-satellites).
2.3. Applications : Réducteurs Coaxiaux et Multiplicateurs
Les avantages des trains épicycloïdaux (compacité, coaxialité de l’entrée et de la sortie, capacité de couple élevée) sont soulignés, justifiant leur emploi dans les réducteurs de moyeux de roue des engins de chantier ou les boîtes de vitesses automatiques.
2.4. Le Différentiel Automobile : Principe et Fonctionnement
Le différentiel est présenté comme une application ingénieuse du train épicycloïdal, permettant de répartir le couple moteur entre deux roues motrices tout en les autorisant à tourner à des vitesses différentes dans les virages, une nécessité pour les véhicules circulant sur les routes sinueuses du pays.
Chapitre 3 : Les Variateurs et Inverseurs de Mouvement
Ce chapitre étudie les mécanismes qui permettent non seulement de réduire la vitesse, mais aussi de la faire varier ou d’inverser le sens du mouvement.
3.1. Les Variateurs de Vitesse Mécaniques
Le principe des variateurs continus de vitesse est expliqué, notamment les variateurs à poulies extensibles (pour courroies trapézoïdales) et les variateurs à friction (à plateaux, à cônes), qui permettent un réglage progressif de la vitesse.
3.2. Les Boîtes de Vitesses : Principe des Baladeurs
La boîte de vitesses à engrenages parallèles est analysée. Le principe des pignons baladeurs ou des crabots, qui permettent de solidariser sélectivement différents couples de pignons pour obtenir plusieurs rapports de vitesse fixes, est détaillé.
3.3. Les Inverseurs de Marche à Engrenages
Le mécanisme de l’inverseur, qui utilise un pignon intermédiaire (le « pignon fou ») pour inverser le sens de rotation de l’arbre de sortie sans changer celui de l’entrée, est expliqué. C’est un dispositif essentiel sur les machines-outils.
3.4. Étude de cas : Schéma cinématique d’une boîte de vitesses simple
L’analyse complète du schéma cinématique d’une boîte de vitesses simple (par exemple, 3 vitesses avant et 1 arrière) est réalisée, en identifiant le chemin de la puissance pour chaque rapport engagé.
Partie II : Analyse des Mécanismes de Transformation de Mouvement
Cette partie se concentre sur les mécanismes qui ne se contentent pas de transmettre ou de modifier une rotation, mais qui la convertissent en un autre type de mouvement, le plus souvent une translation.
Chapitre 4 : Le Système Bielle-Manivelle et ses Variantes
Ce chapitre analyse le mécanisme articulé le plus important de l’histoire de la mécanique, celui qui est au cœur de toutes les machines alternatives.
4.1. Analyse Cinématique du Système Bielle-Manivelle
Les relations géométriques qui lient la position, la vitesse et l’accélération du piston au mouvement de rotation du vilebrequin (manivelle) sont établies.
4.2. Détermination des Efforts : Piston, Bielle, Vilebrequin
L’analyse dynamique du mécanisme est abordée. En partant de la force des gaz sur le piston, on détermine les efforts de compression et de traction dans la bielle, ainsi que les efforts sur les paliers du vilebrequin.
4.3. Le Mécanisme de la Coulisse Oscillante de Whitworth
Ce mécanisme, variante du système bielle-manivelle, est présenté. Sa capacité à générer un mouvement de translation alternatif avec une course de retour beaucoup plus rapide que la course de travail le rend très utile pour les machines-outils comme les étaux-limeurs.
4.4. Applications : Moteurs à Pistons, Compresseurs, Presses Mécaniques
La polyvalence du système bielle-manivelle est illustrée par son utilisation dans les moteurs (où la translation crée la rotation) et dans les compresseurs ou les presses (où la rotation crée la translation).
Chapitre 5 : Les Mécanismes à Vis
Ce chapitre étudie l’utilisation du couple vis-écrou comme mécanisme de transformation de mouvement, permettant d’obtenir des translations précises et des efforts importants.
5.1. Le Système Vis-Écrou : Irréversibilité et Rendement
Le principe de la transformation de mouvement est rappelé. La condition d’irréversibilité (liée à l’angle d’hélice et au frottement), qui empêche le mouvement de retour sous charge, est expliquée. Le calcul du rendement est abordé.
5.2. Application au Déplacement de Précision (Machines-Outils)
L’utilisation des vis-mères et des vis à billes pour la commande des déplacements des chariots de machines-outils est présentée comme l’application principale de ce mécanisme, où la précision est le critère de performance clé.
5.3. Le Système de Vis Différentielles
Le mécanisme de la vis différentielle, qui utilise deux pas de vis différents pour générer des déplacements extrêmement faibles et précis, est expliqué.
5.4. Le Cric à Vis : Étude et Application
Le cric à vis simple est analysé comme un appareil de levage robuste et sûr (grâce à son irréversibilité). La chaîne cinématique complète, de la manivelle à la charge, est étudiée.
Partie III : Technologie des Appareils de Levage et Manutention
Cette partie est une application technologique des principes mécaniques à l’étude des appareils conçus pour soulever et déplacer des charges, des équipements essentiels sur les chantiers, dans les ports et les usines.
Chapitre 6 : Les Vérins et les Crics – Appareils de Levage par Poussée
Ce chapitre se concentre sur les appareils qui soulèvent la charge en exerçant une force de poussée depuis le sol.
6.1. Le Cric à Crémaillère et son Système de Sécurité
La technologie du cric à crémaillère, avec son système de manivelle et son cliquet de sécurité (roue à rochet) qui empêche la descente de la charge, est décrite.
6.2. Le Vérin à Vis et son Levier à Cliquet
Le vérin à vis (ou cric-bouteille mécanique) est analysé, en se concentrant sur le mécanisme de levier à cliquet qui permet la manœuvre.
6.3. Le Vérin Hydraulique : Principe et Technologie
Le vérin hydraulique est présenté comme l’appareil de levage par poussée le plus puissant. Son principe, basé sur la multiplication de l’effort par la loi de Pascal, et sa constitution (pompe, réservoir, clapet) sont étudiés.
6.4. Critères de Choix et de Sécurité pour les Appareils de Levage
Les critères de sélection (capacité, course, stabilité) et les règles de sécurité impératives pour l’utilisation de ces appareils (calage, centrage de la charge) sont passés en revue.
Chapitre 7 : Les Treuils et Palans – Appareils de Levage par Traction
Ce chapitre étudie les appareils qui soulèvent une charge en la tirant vers le haut à l’aide d’un lien flexible (câble ou chaîne).
7.1. Les Palans à Chaîne et à Câble
Le principe du palan, qui utilise des moufles (poulies multiples) pour démultiplier l’effort, est expliqué. Les palans manuels à chaîne et les palans électriques à câble sont décrits.
7.2. Le Treuil Manuel et Motorisé : Constitution
Le treuil est analysé comme un système composé d’un tambour d’enroulement, d’un réducteur de vitesse, d’une manivelle ou d’un moteur, et d’un système de freinage et de sécurité.
7.3. Le Chariot-Treuil d’un Pont Roulant
Le mécanisme complet d’un chariot de pont roulant est étudié, en identifiant la motorisation de levage (treuil), la motorisation de direction (translation du chariot) et l’ensemble des composants (poulies, crochet, frein).
7.4. Le Tambour d’Enroulement : Conception et Fixation du Câble
La conception du tambour est abordée : lisse ou à gorges, son diamètre doit être suffisamment grand pour ne pas endommager le câble. Les méthodes de fixation sûre de l’extrémité du câble sur le tambour sont présentées.
Partie IV : Dimensionnement et Calcul des Éléments de Mécanismes (Résistance Appliquée)
Cette dernière partie, cruciale, met en application les connaissances de Résistance des Matériaux pour le calcul et la vérification des composants étudiés dans les parties précédentes.
Chapitre 8 : Le Calcul des Organes d’Assemblage et de Fixation
Ce chapitre applique la RDM au dimensionnement des liaisons, qui sont souvent les points critiques d’une structure.
8.1. Calcul des Vis d’un Fond de Cylindre sous Pression
Un cas classique de calcul de boulons en traction est traité : la détermination du nombre et du diamètre des vis nécessaires pour assurer l’étanchéité d’un couvercle de réservoir sous pression.
8.2. Calcul d’un Assemblage Fretté (par Adhérence)
La méthode de calcul de la pression de contact et du couple transmissible par un assemblage monté serré (frettage) est présentée, en lien avec l’industrie de réparation navale à Boma.
8.3. Calcul d’une Clavette au Cisaillement et au Matage
La double vérification d’une clavette est détaillée : la vérification au cisaillement dans la section transversale et la vérification au matage (pression de contact) sur les flancs de la clavette.
8.4. Calcul d’un Cordon de Soudure
La méthode de calcul simplifiée pour la vérification de la résistance d’un cordon de soudure d’angle, en le considérant comme travaillant au cisaillement dans son plan de gorge, est enseignée.
Chapitre 9 : Le Calcul des Arbres et des Organes de Guidage
Ce chapitre est consacré au dimensionnement des arbres, qui sont presque toujours soumis à des sollicitations combinées, et à leurs supports.
9.1. Calcul des Arbres à la Torsion et à la Flexion Composées
La méthode de dimensionnement d’un arbre soumis simultanément à un couple de torsion et à des efforts de flexion est détaillée, en utilisant la notion de contrainte ou de moment équivalent pour la vérification de la résistance.
9.2. Vérification de la Rigidité en Torsion et en Flexion
En plus de la résistance, la vérification de la déformation de l’arbre (angle de torsion, flèche) est abordée comme un critère de rigidité souvent déterminant pour le bon fonctionnement de la machine.
9.3. Calcul des Tourillons et des Paliers Lisses
La vérification de la pression de contact entre un arbre (tourillon) et son palier lisse est présentée, pour s’assurer que la pression reste dans les limites admissibles pour le matériau du coussinet.
9.4. Le Choix d’un Roulement à Partir des Charges (Durée de vie)
La démarche de sélection d’un roulement dans un catalogue est introduite. Elle consiste à calculer les charges radiale et axiale équivalentes et à utiliser les formules du fabricant pour estimer la durée de vie du roulement.
Chapitre 10 : Le Calcul des Organes de Transmission de Puissance
Ce chapitre applique la RDM au calcul des composants spécifiques aux transmissions de puissance, notamment les engrenages et les courroies.
10.1. Calcul de la Résistance des Dents d’Engrenages (Formule de Lewis)
La formule de Lewis, qui modélise une dent d’engrenage comme une poutre en console encastrée sur le moyeu et soumise à un effort de flexion, est présentée comme une méthode de prédimensionnement de la denture.
10.2. Calcul d’une Transmission par Courroie Plate
La méthode de calcul d’une transmission par courroie est abordée, en déterminant les tensions dans les brins mou et tendu et en vérifiant la contrainte de traction dans la courroie.
10.3. Calcul d’un Accouplement Rigide à Plateaux
Le dimensionnement d’un accouplement à brides est étudié, en calculant le cisaillement dans les boulons d’assemblage qui transmettent le couple d’un plateau à l’autre.
10.4. Calcul d’un Ressort de Compression
La méthode de calcul d’un ressort hélicoïdal est présentée, incluant la vérification de la contrainte de torsion dans le fil et le calcul de la flèche (déformation) en fonction de la charge.
Chapitre 11 : Le Calcul des Éléments de Levage
Ce chapitre est une application directe des principes de la RDM au dimensionnement des composants critiques des appareils de levage, où la sécurité est l’enjeu principal.
11.1. Calcul d’un Câble de Levage (Traction, flexion, fatigue)
Le calcul d’un câble métallique est détaillé, en tenant compte non seulement de la charge statique (traction), mais aussi des contraintes de flexion dues à l’enroulement sur les poulies et le tambour, et en appliquant un coefficient de sécurité élevé.
11.2. Calcul d’un Crochet de Levage (Flexion composée)
Le crochet est analysé comme une poutre courbe soumise à de la flexion composée (traction + flexion). La méthode de calcul de la contrainte maximale dans la section la plus sollicitée est expliquée.
11.3. Calcul de la Dent d’une Roue à Rochet
La dent d’un cliquet de sécurité est modélisée comme une petite poutre en console soumise à un effort de flexion, et sa résistance est vérifiée.
11.4. Calcul du Tambour d’un Treuil
Le calcul de l’épaisseur de la virole du tambour d’un treuil est abordé, en le considérant comme un tube soumis à la pression d’écrasement des spires de câble et à la flexion entre ses supports.
Chapitre 12 : Introduction aux Sollicitations Complexes : Flambage et Efforts Composés
Ce chapitre de synthèse revient sur les sollicitations les plus complexes et les applique à des cas concrets de pièces de machines.
12.1. Le Flambage : Vérification d’une Bielle de Compresseur
La bielle d’un compresseur, longue et soumise à un effort de compression intense, est présentée comme un cas d’école pour l’application des formules de vérification au flambage.
12.2. La Flexion et la Traction Combinées
Des exemples de pièces soumises à cette sollicitation composée (poteaux excentrés, crochets) sont analysés en appliquant le principe de superposition des contraintes.
12.3. La Torsion et le Cisaillement Combinés
Le cas d’un arbre claveté, où la contrainte de torsion dans l’arbre se combine avec la contrainte de cisaillement dans la clavette, est étudié.
12.4. Synthèse : Application au calcul complet du système bielle-manivelle
Un exercice de synthèse complet est proposé, consistant à calculer toutes les pièces critiques du mécanisme bielle-manivelle (maneton, corps de bielle, axe de piston) en appliquant les différentes formules de RDM étudiées.
Annexes
Les annexes sont des outils de travail qui regroupent des données et des formules pour faciliter la résolution des problèmes de dimensionnement.
Formulaire de Résistance des Matériaux Appliquée 📝
Un formulaire complet rappelle les expressions des contraintes et les conditions de résistance pour toutes les sollicitations simples et composées, ainsi que pour les cas spécifiques (câbles, ressorts, etc.).
Tableau des Propriétés des Matériaux et Coefficients de Sécurité 📊
Un tableau fournit les caractéristiques mécaniques (limite d’élasticité, résistance à la rupture) des matériaux de construction les plus courants, ainsi que des recommandations pour le choix du coefficient de sécurité en fonction de l’application.
Aide-Mémoire pour le Calcul des Engrenages ⚙️
Cette annexe fournit les relations géométriques et la formule de Lewis pour le prédimensionnement rapide des engrenages cylindriques à denture droite.



