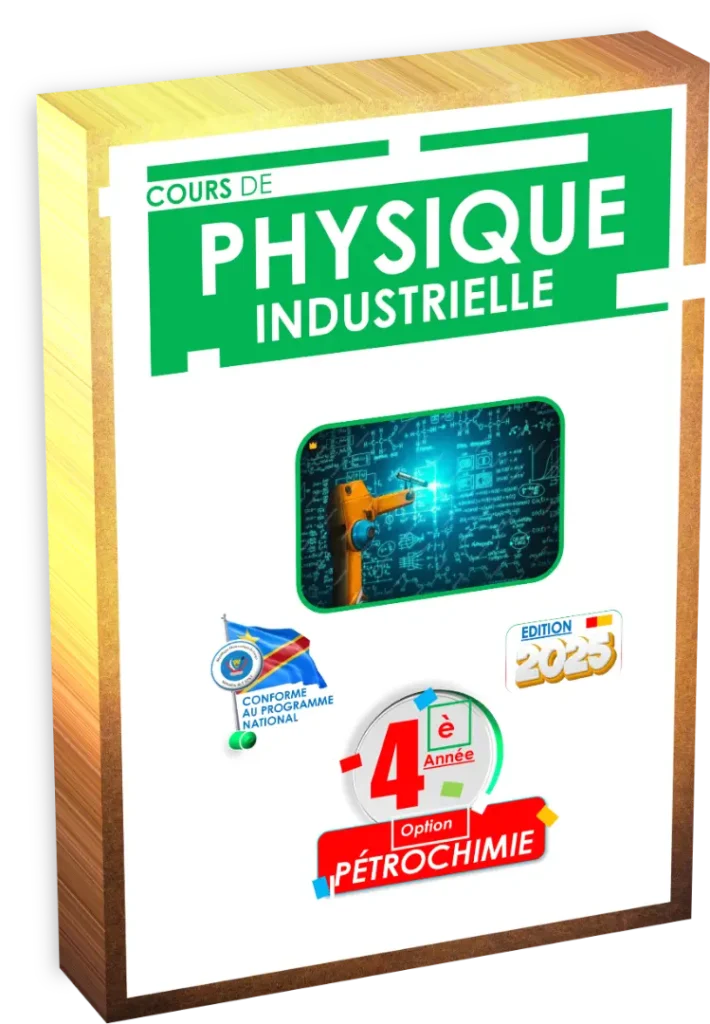
PHYSIQUE INDUSTRIELLE, 4ÈME ANNÉE / OPTION : PÉTROCHIMIE INDUSTRIELLE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
Préliminaires
1. Finalités de la formation
La formation en physique industrielle de quatrième année a pour finalité de doter l’élève d’une maîtrise approfondie des principes physiques qui gouvernent la performance, la fiabilité et l’optimisation des systèmes industriels complexes. L’objectif est de former un technicien de haut niveau, capable de diagnostiquer des dysfonctionnements, de participer à l’amélioration des procédés et d’intégrer les nouvelles technologies en s’appuyant sur une solide compréhension des phénomènes de transfert, de la science des matériaux et de la dynamique des systèmes.
2. Compétences visées
À l’issue de cette année de perfectionnement, l’élève devra être capable d’analyser des écoulements compressibles et diphasiques, de modéliser des transferts thermiques complexes incluant le rayonnement et les changements de phase, et d’évaluer les modes de dégradation des matériaux. Il pourra également interpréter les résultats de contrôles non destructifs, analyser la réponse dynamique d’un procédé et proposer des stratégies de régulation avancées pour en optimiser l’efficacité énergétique et la productivité.
3. Approche Pédagogique
L’enseignement est axé sur la modélisation et la simulation de phénomènes industriels. S’appuyant sur les acquis des années précédentes, le cours utilise des études de cas approfondies pour développer les compétences d’analyse et de synthèse. Des projets intégrateurs, tels que le bilan exergétique d’une unité de la raffinerie SOCIR, l’analyse des risques de corrosion d’un pipeline dans le Bas-Congo, ou la conception d’une stratégie de contrôle pour un réacteur chimique, permettent à l’élève d’appliquer ses connaissances à la résolution de problèmes industriels réalistes.
4. La Modélisation Physique des Systèmes Industriels
Cette dernière année introduit l’élève à l’approche de la modélisation, qui consiste à représenter un système industriel complexe par un ensemble d’équations physiques pour en prédire le comportement. L’élève comprendra que cette démarche est à la base de la conception, de l’optimisation et de la commande numérique des procédés modernes, et constitue une compétence clé pour le technicien supérieur.
Partie I : Mécanique des Fluides Appliquée et Turbomachines 💨
Cette partie approfondit l’étude des écoulements en abordant des cas plus complexes et plus représentatifs des réalités industrielles que les écoulements de liquides incompressibles. L’élève y étudiera le comportement des gaz à haute vitesse, les écoulements de mélanges, et la physique des machines qui échangent de l’énergie avec les fluides, les turbomachines.
Chapitre 1 : L’Écoulement des Fluides Compressibles
Ce chapitre se concentre sur la dynamique des gaz, où les variations de masse volumique deviennent significatives.
1.1. Thermodynamique des Gaz Parfaits et Réels
Les lois des gaz parfaits et les notions de capacités thermiques seront révisées. L’élève sera initié aux équations d’état des gaz réels (Van der Waals) et à l’utilisation des diagrammes thermodynamiques pour déterminer les propriétés d’un gaz.
1.2. La Vitesse du Son et le Nombre de Mach
La vitesse du son dans un gaz sera définie comme la célérité de propagation des petites perturbations. Le nombre de Mach sera introduit comme le rapport entre la vitesse de l’écoulement et la vitesse du son, permettant de distinguer les régimes subsoniques, soniques et supersoniques.
1.3. L’Écoulement dans les Tuyères
L’écoulement isentropique d’un gaz dans une tuyère convergente-divergente (tuyère de Laval) sera analysé. L’élève comprendra comment ce dispositif permet d’accélérer un gaz jusqu’à des vitesses supersoniques, un principe utilisé dans les turbines à vapeur et les moteurs de fusée.
1.4. Les Ondes de Choc
Le phénomène de l’onde de choc, une discontinuité brutale des propriétés de l’écoulement qui apparaît en régime supersonique, sera décrit. Ses implications sur les pertes d’énergie et les efforts mécaniques seront soulignées.
Chapitre 2 : Les Écoulements Diphasiques
Ce chapitre aborde l’étude complexe des écoulements de mélanges liquide-gaz ou solide-fluide.
2.1. Définition et Caractérisation des Écoulements Diphasiques
Les grandeurs clés pour décrire un mélange (fractions volumique et massique, vitesse de chaque phase) seront définies. L’importance de ces écoulements dans les industries pétrolière (remontée des effluents des puits) et chimique (réacteurs bouillants) sera mise en évidence.
2.2. Les Configurations d’Écoulement (Flow Patterns)
L’élève découvrira que, selon les débits respectifs des phases, un écoulement diphasique dans une conduite peut adopter différentes configurations : écoulement à bulles, à poches, stratifié, annulaire. Des cartes de régimes d’écoulement seront présentées.
2.3. Les Modèles d’Écoulement Diphasique
Une introduction aux approches de modélisation sera proposée : le modèle homogène (le plus simple, considérant le mélange comme un fluide unique) et les modèles à deux fluides, plus complexes, qui résolvent les équations de conservation pour chaque phase.
2.4. La Chute de Pression en Écoulement Diphasique
Le calcul de la perte de charge en écoulement diphasique, plus complexe qu’en monophasique car elle inclut des termes de friction et d’accélération liés à l’interaction entre les phases, sera abordé.
Chapitre 3 : Les Turbomachines Hydrauliques et Thermiques
Ce chapitre se concentre sur la physique des machines tournantes qui échangent de l’énergie avec un fluide.
3.1. Le Triangle des Vitesses et l’Équation d’Euler
Le triangle des vitesses (absolue, relative, d’entraînement) à l’entrée et à la sortie d’une roue de turbomachine sera construit. L’équation fondamentale d’Euler, qui relie le couple transmis à la variation du moment cinétique du fluide, sera établie.
3.2. Les Pompes Centrifuges
L’élève appliquera l’équation d’Euler pour analyser le fonctionnement d’une pompe centrifuge, omniprésente dans l’industrie. Les courbes caractéristiques (Hauteur-Débit, Rendement-Débit) et le phénomène de cavitation seront étudiés.
3.3. Les Turbines Hydrauliques
Les différents types de turbines hydrauliques (Pelton, Francis, Kaplan) seront classifiés en fonction de la hauteur de chute et du débit. Leur rôle dans la production d’hydroélectricité, pilier de l’énergie en RDC avec les barrages d’Inga, sera analysé.
3.4. Les Compresseurs et les Turbines à Gaz
Le fonctionnement des compresseurs axiaux et centrifuges (utilisés pour augmenter la pression des gaz) et des turbines à gaz (utilisées pour la propulsion et la production d’électricité) sera analysé à l’aide des mêmes principes fondamentaux.
Partie II : Phénomènes de Transfert et Applications 🌡️
Cette partie approfondit l’étude des transferts de chaleur et introduit la discipline parente du transfert de matière. Elle vise à donner à l’élève une compréhension unifiée des phénomènes de transport, qui sont au cœur de la performance de la plupart des opérations unitaires en génie chimique (réacteurs, colonnes de distillation, sécheurs).
Chapitre 4 : Transfert de Chaleur par Rayonnement
Ce chapitre explore en détail le mode de transfert qui domine à haute température.
4.1. Le Rayonnement du Corps Noir
Le concept de corps noir, émetteur et absorbeur idéal, sera introduit. La loi de Planck (distribution spectrale de l’énergie) et la loi de Stefan-Boltzmann (puissance totale émise) seront étudiées.
4.2. Le Rayonnement des Surfaces Réelles
Les surfaces réelles seront décrites par leur émissivité, leur absorptivité et leur réflectivité. La loi de Kirchhoff, qui relie l’émissivité et l’absorptivité à l’équilibre thermique, sera présentée.
4.3. L’Échange Radiatif entre Surfaces
Le concept de facteur de forme (ou facteur de vue) sera introduit pour quantifier la fraction du rayonnement émis par une surface qui est interceptée par une autre. L’élève apprendra à calculer le flux de chaleur net échangé entre deux surfaces.
4.4. Application aux Fours Industriels
Les connaissances seront appliquées à l’analyse du transfert de chaleur dans un four, en modélisant l’échange radiatif entre les flammes, les gaz de combustion chauds et les tubes de procédé. L’importance de l’émissivité des gaz sera soulignée.
Chapitre 5 : Transfert de Chaleur avec Changement de Phase
Ce chapitre se concentre sur les phénomènes d’ébullition et de condensation, qui impliquent des transferts de chaleur très intenses.
5.1. L’Ébullition en Convection Libre (Pool Boiling)
Les différents régimes de l’ébullition sur une surface chauffante immergée dans un liquide (ébullition nucléée, film d’ébullition) seront décrits à l’aide de la courbe de Nukiyama. Le flux de chaleur critique, qui représente une limite de sécurité, sera identifié.
5.2. L’Ébullition en Convection Forcée
L’ébullition à l’intérieur de tubes chauffés, situation typique des chaudières et des rebouilleurs de colonnes de distillation, sera analysée.
5.3. La Condensation en Film et en Gouttes
L’élève distinguera la condensation en film, qui se produit sur la plupart des surfaces industrielles, de la condensation en gouttes, beaucoup plus efficace mais difficile à maintenir. Le calcul du coefficient de transfert thermique pour la condensation en film sur une paroi plane sera abordé.
5.4. Conception des Bouilleurs et des Condenseurs
L’élève appliquera ces connaissances pour comprendre la conception des équipements industriels basés sur le changement de phase, comme les rebouilleurs et les condenseurs associés aux colonnes de distillation de la raffinerie SOCIR.
Chapitre 6 : Introduction au Transfert de Matière
Ce chapitre introduit les mécanismes de transport d’espèces chimiques au sein d’un mélange.
6.1. Les Mécanismes de Transfert de Matière
L’analogie entre les phénomènes de transfert sera mise en évidence. L’élève découvrira la diffusion moléculaire (loi de Fick), analogue à la conduction (loi de Fourier), et la convection de matière, analogue à la convection thermique.
6.2. Le Transfert de Matière à travers une Interface
Le transfert d’une espèce chimique entre deux phases (par exemple, gaz et liquide) sera modélisé à l’aide d’un coefficient de transfert de matière et d’une force motrice basée sur la différence de concentration.
6.3. Application à l’Absorption
Le cas de l’absorption d’un gaz dans une colonne garnie sera analysé. L’élève comprendra comment le transfert de matière régit la hauteur nécessaire de la colonne pour atteindre le niveau de purification souhaité.
6.4. Application à la Distillation
L’élève reverra le principe de la distillation sous l’angle du transfert de matière : sur chaque plateau, un transfert de matière se produit entre la phase vapeur et la phase liquide, permettant l’enrichissement progressif du composant le plus volatil dans la vapeur.
Partie III : Physique des Matériaux, Durabilité et Contrôle 🔬
Cette partie est consacrée à la durabilité et à la surveillance des équipements industriels. Elle approfondit l’étude du comportement des matériaux en s’intéressant à leurs modes de défaillance à long terme. Elle introduit également les techniques de contrôle non destructif qui permettent d’inspecter les installations sans les arrêter, une compétence essentielle pour la maintenance et la sécurité.
Chapitre 7 : Les Modes de Dégradation des Matériaux
Ce chapitre explore les mécanismes qui limitent la durée de vie des équipements.
7.1. La Fatigue des Matériaux
La fatigue sera présentée comme la principale cause de rupture des pièces soumises à des sollicitations cycliques (vibrations, cycles de pression). L’élève étudiera les courbes de Wöhler (courbes S-N) et la notion de limite d’endurance.
7.2. Le Fluage
Le fluage sera défini comme la déformation progressive et irréversible d’un matériau soumis à une contrainte constante à haute température. Son importance pour le dimensionnement des équipements travaillant à chaud (tubes de fours, aubes de turbines) sera soulignée.
7.3. La Corrosion sous Contrainte
Ce mode de défaillance, qui combine les effets d’un environnement corrosif et d’une contrainte mécanique, sera analysé. L’élève comprendra qu’il peut conduire à des ruptures brutales et imprévisibles d’équipements, un risque majeur dans l’industrie chimique.
7.4. L’Érosion et l’Abrasion
La dégradation des matériaux par usure mécanique sera étudiée : l’érosion par des fluides chargés de particules (pipelines de transport de pulpe minière dans le Katanga) et l’abrasion par contact et frottement entre deux surfaces.
Chapitre 8 : Les Techniques de Contrôle Non Destructif (CND)
Ce chapitre présente les méthodes d’inspection qui permettent de détecter des défauts sans endommager la pièce.
8.1. Le Contrôle Visuel et le Ressuage
Le contrôle visuel, méthode la plus simple, et le ressuage, qui permet de révéler les fissures débouchant en surface par pénétration d’un liquide coloré ou fluorescent, seront décrits.
8.2. La Magnétoscopie et les Courants de Foucault
Deux méthodes électromagnétiques seront introduites : la magnétoscopie (pour les matériaux ferromagnétiques) et les courants de Foucault (pour les matériaux conducteurs), toutes deux très sensibles aux défauts de surface.
8.3. Le Contrôle par Ultrasons
Le principe du contrôle par ultrasons, analogue à l’échographie médicale, sera expliqué. L’élève comprendra comment l’analyse de l’écho d’une onde ultrasonore permet de détecter des défauts internes (inclusions, fissures) et de mesurer des épaisseurs.
8.4. La Radiographie Industrielle
La radiographie par rayons X ou gamma sera présentée comme la méthode permettant d’obtenir une image volumique de la pièce et de visualiser les défauts internes. Son utilisation pour le contrôle des soudures sur les sphères de stockage de gaz ou les pipelines sera citée en exemple.
Chapitre 9 : Notions de Fiabilité et de Maintenance Industrielle
Ce chapitre introduit les concepts qui permettent de gérer la durée de vie et la disponibilité des équipements.
9.1. La Fiabilité des Équipements
La fiabilité sera définie comme la probabilité qu’un équipement accomplisse sa fonction sans défaillance pendant une période donnée. La courbe en baignoire, qui décrit les taux de défaillance au cours de la vie d’un équipement, sera présentée.
9.2. La Maintenabilité et la Disponibilité
La maintenabilité (facilité de réparation) et la disponibilité (pourcentage du temps où l’équipement est apte à fonctionner) seront définies comme des indicateurs clés de la performance d’un système industriel.
9.3. Les Stratégies de Maintenance
L’élève distinguera les trois grandes stratégies de maintenance : la maintenance corrective (réparation après panne), la maintenance préventive systématique (intervention à intervalles fixes) et la maintenance préventive conditionnelle ou prédictive (intervention basée sur la surveillance de l’état de la machine).
9.4. Introduction à l’Analyse des Modes de Défaillance (AMDEC)
L’AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité) sera présentée comme une méthode systématique d’analyse de risques qui permet d’identifier les défaillances potentielles et de mettre en place des actions préventives ciblées.
Partie IV : Dynamique et Contrôle des Systèmes Industriels ⚙️
Cette dernière partie est une synthèse qui vise à intégrer les connaissances physiques dans une vision systémique des procédés. Elle aborde la manière dont les processus industriels réagissent aux perturbations dans le temps (leur dynamique) et explore les stratégies de contrôle avancées qui permettent de maintenir leur fonctionnement de manière stable, sûre et optimale. C’est le sommet de la pyramide de la physique appliquée à l’industrie.
Chapitre 10 : La Dynamique des Procédés
Ce chapitre étudie le comportement temporel des systèmes industriels.
10.1. La Modélisation Dynamique
L’élève apprendra à écrire les bilans de matière et d’énergie en régime transitoire (non stationnaire), conduisant à des équations différentielles qui décrivent l’évolution du système dans le temps.
10.2. La Transformée de Laplace
La transformée de Laplace sera introduite comme un outil mathématique puissant qui permet de transformer les équations différentielles en équations algébriques simples, facilitant grandement leur résolution.
10.3. La Fonction de Transfert
La fonction de transfert d’un système sera définie comme le rapport de la transformée de Laplace de la sortie à celle de l’entrée. Elle caractérise de manière concise la réponse dynamique du procédé.
10.4. La Réponse des Systèmes du Premier et du Second Ordre
L’élève étudiera la réponse temporelle (à un échelon) des systèmes les plus courants : les systèmes du premier ordre (caractérisés par une constante de temps) et les systèmes du second ordre (qui peuvent présenter des oscillations).
Chapitre 11 : Les Stratégies de Contrôle Avancées
Ce chapitre va au-delà de la simple boucle de régulation PID vue en troisième année.
11.1. Le Réglage des Régulateurs PID
Les méthodes de réglage des paramètres (P, I, D) d’un régulateur, comme la méthode de Ziegler-Nichols, seront présentées pour optimiser la performance d’une boucle de régulation (rapidité, stabilité, précision).
11.2. La Régulation en Cascade
La régulation en cascade, qui utilise une boucle de régulation esclave rapide pour améliorer la performance d’une boucle maître plus lente, sera expliquée. Un exemple classique est la régulation de la température d’un réacteur en cascadant avec la régulation du débit du fluide de refroidissement.
11.3. La Régulation Feedforward (Anticipative)
La stratégie feedforward, qui mesure une perturbation avant qu’elle n’affecte le procédé et agit de manière anticipative pour en contrer l’effet, sera présentée comme un moyen d’améliorer considérablement la régulation.
11.4. La Régulation de Ratio
La régulation de ratio, qui vise à maintenir un rapport constant entre deux débits (par exemple, le rapport air/carburant dans un brûleur), sera étudiée comme une stratégie de contrôle très courante dans l’industrie de procédé.
Chapitre 12 : L’Optimisation et l’Efficacité Énergétique des Procédés
Ce chapitre final ouvre sur les enjeux de performance économique et environnementale.
12.1. L’Optimisation des Procédés
L’optimisation sera présentée comme la recherche des conditions opératoires (température, pression, débits) qui maximisent un critère de performance (production, qualité, rentabilité) tout en respectant les contraintes de sécurité et d’équipement.
12.2. L’Analyse Pinch
L’analyse Pinch sera introduite comme une méthode systématique pour l’intégration thermique des procédés. L’élève découvrira comment cette méthode permet de maximiser la récupération de chaleur interne et de minimiser la consommation d’énergies externes (vapeur, combustible).
12.3. Le Bilan Exergétique
Le concept d’exergie, qui représente la fraction « utile » de l’énergie, sera introduit. Le bilan exergétique permettra d’identifier les sources d’irréversibilités et les points du procédé où l’énergie de haute qualité est détruite, offrant des pistes d’amélioration ciblées.
12.4. Le Technicien Supérieur et l’Industrie 4.0
Le cours se conclura sur une ouverture vers l’industrie du futur (Industrie 4.0), en montrant comment les compétences en physique industrielle, combinées aux technologies numériques (capteurs intelligents, analyse de données massives), sont au cœur de la création d’usines plus intelligentes, plus efficaces et plus durables.
Annexes
Cette section fournit des documents de référence pour une consultation rapide et une meilleure assimilation des concepts.
1. Glossaire de la Physique des Procédés
Une définition claire des termes techniques clés (ex: cavitation, exergie, fluage, CND, fonction de transfert) est fournie pour assurer la maîtrise du vocabulaire spécialisé.
2. Diagrammes Psychrométriques et de Moody
Des diagrammes utiles pour des applications spécifiques : le diagramme de l’air humide (psychrométrique) pour les opérations de séchage, et le diagramme de Moody pour le calcul des pertes de charge.
3. Tableaux des Facteurs de Forme pour le Rayonnement
Des tableaux donnant les valeurs des facteurs de forme pour des géométries simples (plaques parallèles, cylindres concentriques), nécessaires au calcul des échanges radiatifs.
4. Schémas de Boucles de Régulation Complexes
Des schémas d’instrumentation (P&ID) illustrant les stratégies de contrôle avancées étudiées (cascade, feedforward, ratio) sur des exemples de procédés industriels typiques.



