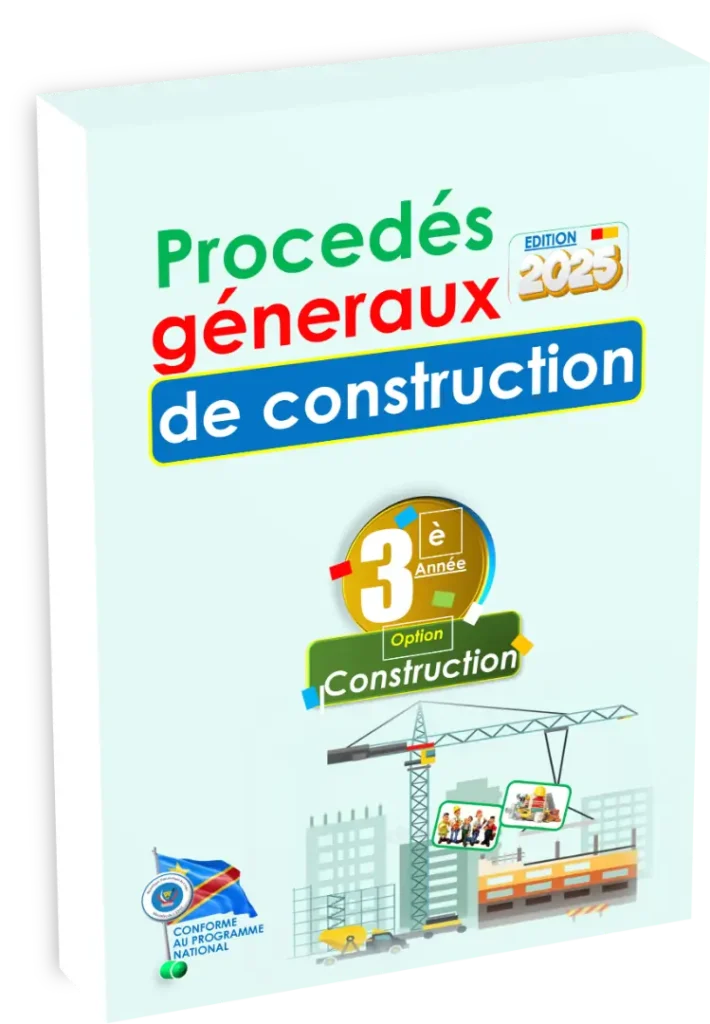
PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION
OPTION CONSTRUCTION – 3ÈME ANNÉE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
Préliminaire
Objectifs du cours
Ce cours a pour objectif de confronter le futur technicien aux problématiques fondamentales du génie civil, en partant de l’élément premier et le plus incertain : le sol. L’ambition est de développer une méthodologie d’analyse rigoureuse qui, partant de l’examen du terrain, aboutit au choix et à la conception de la solution de fondation la plus appropriée. L’élève devra maîtriser les techniques d’investigation des sols et acquérir une connaissance approfondie des différentes technologies de fondations, des plus superficielles aux plus profondes, pour garantir l’assise et la pérennité de tout ouvrage. 🏗️
Approche Pédagogique
Fondé sur une démarche de résolution de problèmes, l’enseignement suivra le parcours logique de l’ingénieur géotechnicien et de l’ingénieur en structures. Chaque chapitre s’ouvrira sur une problématique concrète (Comment connaître la nature d’un sol ? Comment fonder un bâtiment sur un terrain médiocre ?) pour ensuite en explorer les solutions techniques. L’apprentissage sera illustré par des études de cas tirées des défis constructifs spécifiques à la RDC, comme la construction sur les sols argileux de la Cuvette Centrale ou la réalisation de fondations pour un pont sur la Lulua.
Compétences Visées
Au terme de cette année, l’élève détiendra les compétences suivantes :
- Investiguer : Planifier et décrire un programme de reconnaissance des sols, en choisissant les techniques d’investigation in-situ et de laboratoire appropriées.
- Analyser : Interpréter les résultats des essais géotechniques pour classifier un sol et en déduire ses caractéristiques générales du point de vue de la construction.
- Concevoir : Choisir le type de fondation (superficielle, semi-profonde, profonde) le plus adapté à un contexte de sol et de projet donné, en justifiant ses choix.
- Détailler : Décrire la technologie et les procédés d’exécution des principaux types de fondations, des semelles directes aux pieux.
Modalités d’Évaluation
L’évaluation mesurera la capacité de l’élève à analyser une situation géotechnique et à proposer une solution de fondation pertinente. Elle se composera d’études de cas basées sur des rapports de forage simplifiés, d’épreuves écrites testant la connaissance des technologies de fondation, et de projets de conception où l’élève devra dessiner et justifier le système de fondation d’un bâtiment simple. 📋
Partie I : L’Examen du Sol – Le Dialogue avec le Terrain
Cette partie fondamentale est entièrement consacrée à l’investigation géotechnique. Avant de concevoir le moindre ouvrage, il est impératif de « dialoguer » avec le terrain pour comprendre sa nature, sa résistance et son comportement. La maîtrise de ces techniques d’examen est la clé pour prévenir les sinistres et garantir la sécurité des constructions.
Chapitre 1 : La Reconnaissance Préliminaire des Sols
La première phase de l’examen des sols fait appel à l’enquête et à l’observation, des méthodes peu coûteuses qui fournissent des informations précieuses avant toute investigation lourde.
1.1. La Nécessité de l’Examen du Sol
L’étude de sol n’est pas une option mais une obligation technique et morale. Ce prérequis absolu, qui conditionne la sécurité de l’ouvrage et de ses occupants, est justifié par l’analyse de cas de sinistres dus à une mauvaise appréciation du terrain.
1.2. L’Enquête Documentaire et de Voisinage
Une investigation efficace commence par la collecte d’informations existantes : cartes géologiques, études sur des projets voisins, et surtout, l’enquête auprès des riverains qui possèdent une connaissance empirique précieuse de l’histoire du site.
1.3. L’Examen Visuel du Site
L’inspection visuelle du site par un technicien averti permet de déceler de nombreux indices sur la nature du sous-sol, en observant la topographie, la végétation, la présence d’eau et les désordres sur les bâtiments avoisinants.
1.4. L’Identification Manuelle des Sols
Des tests simples, réalisables à la main (examen au toucher, test de cohésion, essai de sédimentation), permettent une première identification et classification des sols (argile, limon, sable), orientant ainsi les investigations futures.
Chapitre 2 : Les Techniques de Reconnaissance in-situ
Pour obtenir une information directe sur le sous-sol, il faut y pénétrer. Ce chapitre explore les techniques de forage et de sondage qui permettent d’accéder aux couches de terrain en profondeur.
2.1. Les Puits et Tranchées de Reconnaissance
Creuser des puits ou des tranchées est la méthode la plus directe pour observer les couches de sol en place, prélever des échantillons intacts et visualiser directement la présence de la nappe phréatique.
2.2. Les Forages et l’Échantillonnage (Carottage)
Pour les investigations profondes, le forage mécanique est la solution. Les techniques d’échantillonnage, notamment le carottage, permettent de remonter à la surface des échantillons représentatifs de chaque couche traversée.
2.3. Le Relevé Piézométrique
La connaissance du niveau de la nappe phréatique est une information capitale. Le relevé de son niveau et de ses variations saisonnières, grâce à des tubes piézométriques, est une étape standard de toute étude de sol.
2.4. La Rédaction du Rapport de Forage
Toute l’information recueillie lors d’un forage doit être consignée de manière rigoureuse dans un rapport, ou « log » de forage, qui décrit la succession des couches, la nature des sols et les résultats des essais.
Chapitre 3 : Les Essais de Pénétration sur le Terrain
Pour mesurer la résistance du sol directement en place, les essais de pénétration sont des outils rapides et efficaces. Ils consistent à enfoncer une pointe dans le sol et à mesurer l’effort nécessaire.
3.1. Les Méthodes d’Essai Statiques
Dans un essai statique, la pointe est enfoncée à vitesse lente et constante. Le pénétromètre statique, largement utilisé, fournit un diagramme continu de la résistance du sol en fonction de la profondeur.
3.2. Les Méthodes d’Essai Dynamiques
Dans un essai dynamique, la pointe est enfoncée par battage. Le nombre de coups nécessaires pour un enfoncement donné (essai SPT, par exemple) est une mesure de la compacité des sols pulvérulents.
3.3. L’Interprétation des Résultats de Pénétration
Les résultats bruts des essais de pénétration doivent être interprétés par le technicien pour en déduire des ordres de grandeur de la capacité portante du sol et pour identifier les couches résistantes et les couches molles.
3.4. La Détermination de la Profondeur des Investigations
La profondeur des sondages doit être suffisante pour explorer toutes les couches de sol qui seront influencées par le futur ouvrage. Des règles empiriques permettent de définir cette profondeur d’investigation.
Chapitre 4 : L’Analyse du Sol en Laboratoire
Les échantillons prélevés sur le terrain sont ensuite analysés en laboratoire pour une caractérisation fine et quantitative de leurs propriétés physiques et mécaniques.
4.1. L’Analyse Granulométrique
Cette analyse, qui consiste à séparer les grains du sol par tamisage, permet de déterminer la proportion de graviers, de sables, de limons et d’argiles, et de tracer la courbe granulométrique, véritable carte d’identité du sol. 🔬
4.2. La Détermination des Limites d’Atterberg
Pour les sols fins (argiles, limons), les limites d’Atterberg mesurent leur consistance en fonction de leur teneur en eau. Elles permettent de définir l’état du sol (solide, plastique, liquide) et d’évaluer son potentiel de gonflement ou de retrait.
4.3. La Détermination des Caractéristiques Physiques
La mesure en laboratoire de la teneur en eau, du poids volumique et de la densité des grains solides permet de calculer d’autres paramètres essentiels comme l’indice des vides et le degré de saturation.
4.4. L’Essai de Cisaillement
L’essai de cisaillement, réalisé à la boîte de Casagrande ou à l’appareil triaxial, est l’essai mécanique le plus important. Il permet de mesurer les deux paramètres fondamentaux de la résistance d’un sol : sa cohésion et son angle de frottement interne.
Partie II : La Technologie des Fondations – L’Ancrage de l’Ouvrage
Forte des connaissances acquises sur le sol, cette deuxième partie aborde la conception et la technologie des fondations. Elle explore l’arsenal des solutions techniques dont dispose le constructeur pour asseoir durablement son ouvrage sur le terrain.
Chapitre 5 : Conception Générale des Fondations
Ce chapitre établit les principes directeurs qui guident tout projet de fondation, de la descente des charges à la vérification de la sécurité vis-à-vis du sol.
5.1. Les Critères de Conception d’une Fondation
Le choix et le dimensionnement d’une fondation résultent d’un compromis entre des critères techniques (nature du sol, type de structure), économiques (coût de la solution) et d’exécution (faisabilité sur le chantier).
5.2. La Descente des Charges et la Répartition des Contraintes
La première étape de la conception consiste à évaluer l’ensemble des charges (permanentes, d’exploitation, climatiques) qui descendent dans la structure jusqu’aux fondations, et à calculer la contrainte appliquée au sol.
5.3. La Notion de Tassement (Absolu et Différentiel)
Sous l’effet des charges, le sol se déforme, entraînant un enfoncement de la fondation appelé tassement. La maîtrise des tassements, et surtout des tassements différentiels entre plusieurs points de l’ouvrage, est un enjeu majeur.
5.4. La Sécurité vis-à-vis du Poinçonnement et du Glissement
Une fondation doit être dimensionnée pour éviter la rupture du sol par poinçonnement (enfoncement brutal). Si elle est soumise à des efforts horizontaux, sa stabilité au glissement doit également être vérifiée.
Chapitre 6 : Les Fondations Directes ou Superficielles
Lorsque le sol présente des caractéristiques mécaniques suffisantes à faible profondeur, la solution la plus simple et la plus économique est celle des fondations directes.
6.1. Les Semelles en Béton ou en Maçonnerie
Les semelles, qu’elles soient filantes sous les murs ou isolées sous les poteaux, ont pour rôle d’élargir la base de la structure pour répartir la charge sur une plus grande surface et diminuer ainsi la contrainte sur le sol.
6.2. Le Radier Général pour les Sols de Faible Portance
Lorsque la capacité portante du sol est faible ou que les charges sont très importantes, un radier général, sorte de dalle épaisse sous tout le bâtiment, peut être la solution la plus appropriée.
6.3. Les Techniques de Creusement et de Protection des Fouilles
La réalisation des fouilles doit respecter les règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la stabilité des talus. Les techniques de blindage pour les fouilles profondes sont introduites.
6.4. Le Remblayage et le Compactage Autour des Fondations
Après la construction des fondations, le remblayage des fouilles doit être effectué avec soin, en utilisant des matériaux de qualité et en les compactant par couches successives.
Chapitre 7 : Les Fondations sur Puits et Pieux
Quand le bon sol est trop profond pour être atteint par de simples fouilles, il faut recourir à des fondations semi-profondes (puits) ou profondes (pieux).
7.1. Le Domaine d’Application des Fondations sur Puits
Les fondations sur puits, sortes de gros poteaux en béton creusés dans le sol, sont une solution intermédiaire intéressante lorsque le bon sol se trouve entre 3 et 6 mètres de profondeur.
7.2. La Technologie des Puits et le Blindage des Fouilles
La technologie des puits de petites, moyennes et grandes dimensions est décrite. Une attention particulière est portée aux techniques de blindage qui assurent la sécurité des ouvriers lors du creusement.
7.3. Le Principe de Fonctionnement des Pieux
Les pieux reportent les charges en profondeur de deux manières : soit par effet de pointe, en s’appuyant sur une couche très résistante, soit par frottement latéral, en se « frottant » aux couches de sol traversées, une technique indispensable pour fonder les grands immeubles de la Gombe.
7.4. La Technologie des Différents Types de Pieux
Une revue des principaux types de pieux est proposée : les pieux en bois (pour les ouvrages légers en site marécageux), les pieux préfabriqués en béton (battus ou vibrés) et les pieux métalliques. Le cas spécifique du pieu Franki, battu et moulé dans le sol, est également abordé.
Chapitre 8 : Les Procédés Spéciaux de Génie Civil
Ce chapitre final ouvre sur des techniques plus avancées, qui permettent soit d’améliorer les caractéristiques d’un sol médiocre, soit de construire dans des conditions difficiles, notamment en présence d’eau.
8.1. Les Techniques d’Amélioration des Sols
Plutôt que de contourner un mauvais sol, il est parfois possible de l’améliorer. Les techniques de compactage dynamique, de préchargement ou d’injection de coulis de ciment sont présentées.
8.2. Le Rabattement de la Nappe Phréatique
Pour pouvoir creuser à sec sous le niveau de la nappe, il est nécessaire d’abaisser temporairement le niveau de l’eau. Le principe du rabattement par puits filtrants et pompage est expliqué.
8.3. L’Utilisation des Enceintes de Palplanches
Une autre solution pour travailler à sec est de créer une « boîte » étanche dans le sol à l’aide d’une paroi de palplanches métalliques enfoncées avant le début du terrassement.
8.4. La Problématique des Reprises en Sous-Œuvre
Intervenir sur les fondations d’un bâtiment existant (reprise en sous-œuvre) est une opération extrêmement délicate. Les principes de cette technique, qui exige un phasage et des précautions rigoureuses, sont introduits.
Annexes
Tableau de Classification des Sols
Un tableau synthétique présentera les principales familles de sols (graves, sables, limons, argiles) avec leurs caractéristiques d’identification et leur comportement typique en génie civil. 🏞️
Guide des Essais Géotechniques
Des fiches descriptives illustreront le principe et l’appareillage pour les principaux essais in-situ (pénétromètre) et de laboratoire (granulométrie, limites d’Atterberg, cisaillement).
Catalogue des Technologies de Fondations
Un recueil de schémas de principe montrera les différentes solutions de fondation (semelles, radier, puits, pieux) avec leur domaine d’application privilégié.
Lexique Illustré de la Géotechnique
Un glossaire visuel définira les termes techniques spécifiques à la mécanique des sols et aux fondations (cohésion, portance, tassement, blindage, etc.), pour une parfaite maîtrise du vocabulaire professionnel.



