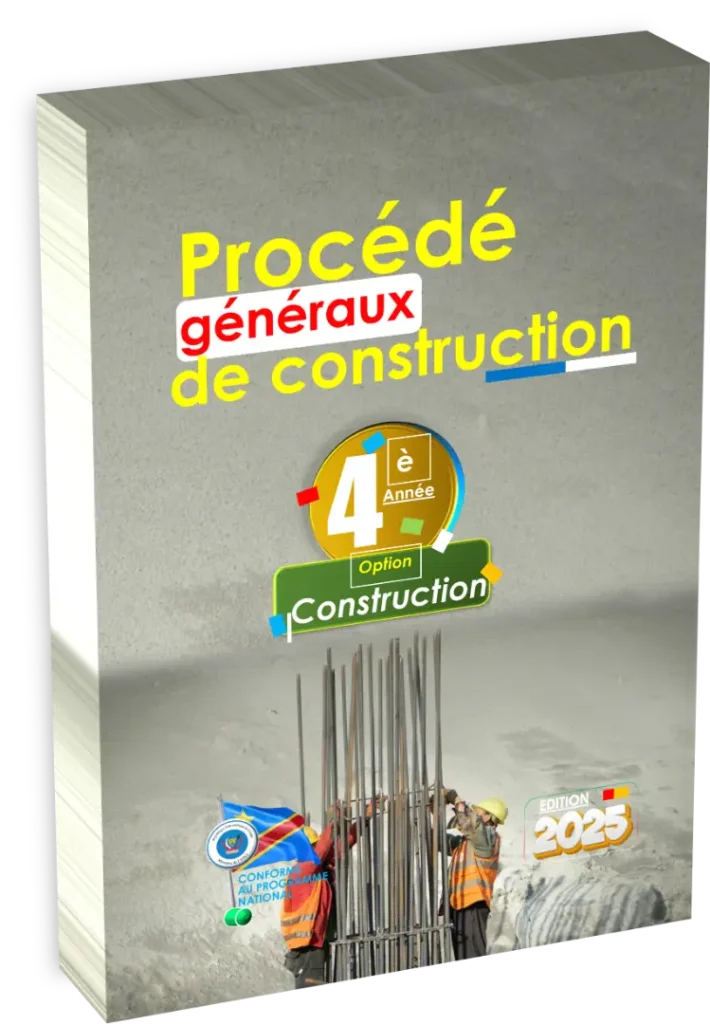
PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION
OPTION CONSTRUCTION – 4ÈME ANNÉE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
Préliminaire
Objectifs du cours
Ce cours terminal a pour ambition de confronter le futur technicien supérieur aux défis les plus complexes du génie civil : la construction sur des terrains difficiles et en présence d’eau. L’objectif est de maîtriser un éventail de procédés spéciaux qui permettent de modifier les propriétés d’un sol, de travailler sous le niveau de la nappe phréatique et de protéger les ouvrages contre les actions agressives de l’eau. Il s’agit de former un professionnel capable d’analyser une situation géotechnique et hydraulique complexe et de participer au choix et à la supervision de la mise en œuvre de solutions techniques avancées. 🌊
Approche Pédagogique
Structuré comme un manuel de résolution de problèmes, l’enseignement partira systématiquement d’un défi constructif (un sol médiocre, une fouille inondée, un risque d’affouillement) pour en explorer les différentes solutions technologiques. Chaque procédé sera analysé sous l’angle de son principe de fonctionnement, de son domaine d’application, de ses avantages et de ses limites. L’apprentissage sera enrichi par l’étude de cas concrets, en analysant les techniques de consolidation des sols pour un grand bâtiment à Kinshasa ou les méthodes de protection des piles du pont Maréchal contre les affouillements du fleuve Congo.
Compétences Visées
Au terme de cette année, l’élève détiendra les compétences suivantes :
- Diagnostiquer : Identifier les problématiques liées à un sol de faibles caractéristiques ou à la présence d’eau, et comprendre les risques associés pour un projet de construction.
- Analyser : Expliquer le principe de fonctionnement, le domaine d’emploi et les limites des principales techniques d’amélioration des sols et de travaux en site aquatique.
- Proposer : Participer au choix de la méthode de fondation ou de protection la plus pertinente face à une contrainte géotechnique ou hydraulique donnée.
- Décrire : Détailler les grandes phases de mise en œuvre d’un procédé de construction spécial, comme le rabattement de nappe ou la construction d’un batardeau.
Modalités d’Évaluation
L’évaluation mesurera la capacité de l’élève à analyser des situations complexes et à proposer des solutions technologiques argumentées. Elle se composera d’études de cas basées sur des rapports géotechniques et des contextes de chantier difficiles, et d’épreuves écrites testant la connaissance approfondie des différents procédés. Un projet final de synthèse demandera à l’élève d’élaborer une note technique proposant et justifiant une ou plusieurs solutions pour la réalisation d’un ouvrage fictif dans des conditions de site particulièrement contraignantes. 👷
Partie I : Les Techniques d’Amélioration et de Traitement des Sols
Cette partie est consacrée aux techniques qui permettent de construire sur des terrains aux caractéristiques médiocres. Plutôt que de recourir systématiquement à des fondations profondes coûteuses, il est souvent possible d’améliorer les propriétés du sol en place pour le rendre apte à supporter l’ouvrage.
Chapitre 1 : Le Diagnostic des Sols et les Stratégies d’Amélioration
Avant de traiter un sol, il faut établir un diagnostic précis de ses faiblesses et définir une stratégie d’intervention.
1.1. L’Identification des Sols à Problèmes
Une typologie des sols posant des défis particuliers à la construction est dressée : argiles molles et compressibles, sables lâches et liquéfiables, vases, remblais non contrôlés, etc.
1.2. Les Risques Associés : Tassements et Glissements
Les risques encourus en cas de construction sur ces sols sans traitement sont analysés en détail : tassements excessifs et différentiels, pouvant entraîner la ruine de l’ouvrage, et risques de glissements de terrain.
1.3. Les Essais Géotechniques Spécifiques
Le diagnostic de ces sols exige des essais de laboratoire poussés, comme l’essai œdométrique pour mesurer la compressibilité ou l’essai triaxial pour mesurer la résistance au cisaillement.
1.4. L’Objectif et la Classification des Techniques d’Amélioration
L’objectif de l’amélioration des sols est d’augmenter leur portance, de réduire leur compressibilité et/ou de les rendre moins perméables. Les techniques sont classifiées selon leur principe d’action (mécanique, hydraulique, physique, chimique).
Chapitre 2 : L’Amélioration des Sols par Action Mécanique
Cette famille de techniques vise à améliorer les propriétés du sol par des actions purement mécaniques, comme le compactage ou l’ajout de matériaux plus résistants.
2.1. Le Compactage en Place : Techniques et Contrôles
Le compactage dynamique ou le vibrocompactage permettent de densifier les sols granulaires en place sur une grande profondeur, une solution efficace pour les grands terre-pleins industriels près de Boma.
2.2. La Précompression des Sols par Préchargement
Pour les sols argileux mous, la technique du préchargement consiste à appliquer une charge temporaire (souvent un remblai) pour provoquer et accélérer les tassements avant la construction de l’ouvrage définitif.
2.3. La Substitution de Sol : Remplacement et Purge
Lorsque la couche de mauvais sol est de faible épaisseur, la solution la plus simple est souvent de l’excaver entièrement (purge) et de la remplacer par des matériaux de meilleure qualité.
2.4. Le Renforcement par Inclusions Rigides et Colonnes Ballastées
Cette technique consiste à introduire dans le sol des colonnes rigides (en béton) ou granulaires (colonnes ballastées) qui vont servir d’éléments porteurs et de drains, reportant les charges vers les couches profondes.
Chapitre 3 : L’Amélioration des Sols par Injection
L’injection consiste à introduire sous pression dans le sol un coulis qui, en se solidifiant ou en se répandant, va en modifier les propriétés de résistance ou de perméabilité.
3.1. Le Principe des Injections de Sol
Le principe général de l’injection est présenté, avec la notion de « claquage » du sol et de rayon d’action du traitement autour d’un point d’injection.
3.2. L’Injection de Coulis de Ciment pour la Consolidation
L’injection d’un coulis de ciment est la technique la plus courante pour combler des vides, consolider des maçonneries ou améliorer la résistance de sols fissurés ou de graves lâches.
3.3. L’Injection de Produits Chimiques pour l’Étanchéification
Pour créer des barrières étanches dans des sols plus fins, des coulis chimiques à base de silicates ou de résines polyuréthanes sont utilisés. C’est la technique du « jet grouting ».
3.4. Le Contrôle de l’Efficacité des Traitements par Injection
Après un traitement par injection, des essais de contrôle (sondages, essais de perméabilité) sont nécessaires pour vérifier que les objectifs de consolidation ou d’étanchéité ont bien été atteints.
Partie II : Les Travaux en Présence d’Eau
La gestion de l’eau, qu’elle soit souterraine (nappe phréatique) ou de surface (rivière), est l’un des défis majeurs du génie civil. Cette partie explore les procédés qui permettent de construire « au sec » dans des environnements saturés en eau.
Chapitre 4 : Les Fondamentaux de l’Hydraulique Souterraine
Pour maîtriser l’eau dans le sol, il faut d’abord comprendre comment elle s’y trouve et comment elle s’y écoule.
4.1. La Notion de Nappe Phréatique et de Pression Interstitielle
La définition de la nappe phréatique, des pressions interstitielles et de la poussée d’Archimède permet de comprendre les forces que l’eau exerce sur les ouvrages souterrains.
4.2. La Perméabilité des Sols et la Loi de Darcy
La perméabilité est la propriété d’un sol à se laisser traverser par l’eau. La loi de Darcy, qui lie le débit d’écoulement au gradient hydraulique, est la loi fondamentale de l’hydraulique souterraine.
4.3. Le Problème des Sous-pressions
La pression de l’eau sous un ouvrage (radier, barrage) crée une force de soulèvement, appelée sous-pression, qui peut compromettre sa stabilité si elle n’est pas prise en compte.
4.4. Le Phénomène de Boulance dans les Fouilles
Dans les sables fins sous nappe, un débit d’eau ascendant peut entraîner le soulèvement des grains et la liquéfaction du fond de fouille : c’est le phénomène redouté de la boulance.
Chapitre 5 : Les Techniques d’Assèchement des Fouilles
Pour réaliser des terrassements sous le niveau de la nappe, il est généralement nécessaire d’abaisser temporairement le niveau de l’eau par pompage.
5.1. L’Épuisement à Ciel Ouvert par Pompage
La méthode la plus simple, mais limitée à des sols peu perméables et à des faibles profondeurs, consiste à pomper l’eau directement depuis le fond de la fouille.
5.2. Le Rabattement de Nappe par Pointes Filtrantes
Pour les sols sableux, le rabattement de nappe par pointes filtrantes est une technique très efficace. Elle consiste à enfoncer une série de tubes crépinés autour de la fouille et à les connecter à une pompe qui aspire l’eau.
5.3. Le Rabattement par Puits Profonds
Pour des rabattements de grande ampleur, des puits de grand diamètre équipés de pompes immergées sont forés à la périphérie de l’excavation.
5.4. L’Encuvement par une Enceinte de Palplanches
Une alternative au pompage est de créer une enceinte étanche autour de la fouille, par exemple avec des palplanches métalliques, pour empêcher l’eau d’entrer.
Chapitre 6 : Les Ouvrages de Protection Contre l’Eau (Batardeaux)
Un batardeau est un ouvrage provisoire qui permet de mettre à sec une zone de travail en site aquatique, par exemple pour construire les piles d’un pont dans une rivière.
6.1. Le Rôle et la Conception d’un Batardeau
La conception d’un batardeau doit garantir sa stabilité vis-à-vis des poussées de l’eau et sa propre étanchéité pendant toute la durée des travaux.
6.2. Le Batardeau en Remblai de Terre
Pour les faibles hauteurs d’eau et les faibles courants, un simple remblai en terre ou en enrochements, muni d’un noyau d’étanchéité, peut suffire.
6.3. Le Batardeau par Enceinte de Palplanches
La solution la plus courante et la plus sûre est le batardeau en palplanches métalliques, constitué d’une ou de deux parois de rideaux de palplanches.
6.4. La Stabilité et la Sécurité des Batardeaux
La vérification de la stabilité d’un batardeau, notamment au renversement et au glissement, et la gestion des infiltrations résiduelles sont des points cruciaux pour la sécurité du chantier.
Partie III : La Protection des Ouvrages en Site Hydraulique
Cette dernière partie est consacrée aux procédés de construction spécifiques aux ouvrages implantés dans des cours d’eau (ponts, barrages, quais), qui doivent être protégés contre les actions érosives du courant.
Chapitre 7 : La Protection Contre les Affouillements
L’affouillement est le creusement du lit de la rivière au pied d’un ouvrage par le courant, un phénomène qui est la principale cause de ruine des ponts dans le monde.
7.1. Le Phénomène d’Affouillement au Pied des Piles de Pont
Le mécanisme de l’affouillement, lié à l’accélération des courants autour des obstacles que constituent les piles et les culées, est expliqué.
7.2. La Protection par Abaissement du Niveau de Fondation
La première méthode de protection, la plus sûre, consiste à fonder l’ouvrage à une profondeur supérieure à la profondeur maximale d’affouillement prévisible.
7.3. La Protection par Enrochements et Perrés
Une autre approche consiste à protéger le lit de la rivière autour des appuis par un tapis d’enrochements ou un revêtement en maçonnerie (perré) qui résiste à l’érosion.
7.4. La Protection par Gabions et Matelas
L’utilisation de gabions (cages métalliques remplies de pierres) et de matelas de gabions est une technique flexible et efficace pour la protection des berges et des fonds de rivière, largement utilisée pour les projets de voirie à Kinshasa.
Chapitre 8 : La Maîtrise des Sous-pressions et de l’Érosion Interne
Pour les ouvrages de retenue (barrages, digues), le principal risque est lié à l’écoulement de l’eau sous l’ouvrage, qui peut générer des sous-pressions et des phénomènes d’érosion interne.
8.1. La Théorie des Lignes de Courant sous un Barrage
L’écoulement de l’eau sous un barrage est visualisé par un réseau de lignes de courant. La longueur de ce parcours de percolation est un paramètre clé de la stabilité.
8.2. L’Application des Règles de Bligh et de Lane
Des règles empiriques, comme celles de Bligh et de Lane, permettent de vérifier qu’un ouvrage est correctement dimensionné pour éviter le risque de « renard hydraulique », une érosion interne qui peut conduire à la ruine.
8.3. Les Dispositifs pour Augmenter le Chemin de Percolation
Pour améliorer la sécurité, des dispositifs comme les parafouilles (écrans verticaux sous la fondation) sont construits pour allonger le chemin de l’eau et dissiper son énergie.
8.4. Les Filtres et Drains pour Prévenir l’Érosion Interne
À la sortie de l’écoulement, un filtre granulaire correctement dimensionné est mis en place pour laisser passer l’eau sans laisser s’échapper les fines particules du sol, prévenant ainsi toute érosion.
Chapitre 9 : Synthèse et Étude de Cas d’un Projet Fluvial
Ce chapitre final vise à intégrer l’ensemble des connaissances sur les travaux en site aquatique à travers l’analyse d’un projet complet.
9.1. L’Analyse des Risques pour un Projet de Quai
Le projet d’un quai de déchargement sur le fleuve Congo, par exemple à Kisangani, est pris comme cas d’étude pour identifier l’ensemble des risques hydrauliques et géotechniques.
9.2. Le Choix des Méthodes de Construction
Face à ces risques, l’élève devra analyser et proposer les méthodes de construction les plus adaptées, en justifiant le choix d’un type de batardeau ou d’une méthode d’assèchement.
9.3. La Conception des Protections contre l’Affouillement
Le dimensionnement des ouvrages de protection des fondations du quai contre les affouillements du fleuve fera l’objet d’une attention particulière.
9.4. La Planification des Phases de Travaux
La réussite d’un tel projet dépend d’une planification rigoureuse qui tient compte des contraintes saisonnières, notamment les variations de niveau du fleuve entre la saison des pluies et la saison sèche.
Annexes
Catalogue des Procédés Spéciaux
Des fiches illustrées synthétiseront les principaux procédés étudiés (rabattement de nappe, injections, colonnes ballastées), avec leur principe, leur domaine d’emploi et leurs limites. Water wave
Guide de Conception d’un Batardeau
Une fiche méthodologique décrira la procédure pas à pas pour la conception et la vérification de la stabilité d’un batardeau simple en palplanches.
Mémento sur la Protection contre les Affouillements
Un recueil de schémas types montrera les différentes solutions de protection des piles de pont et des berges, avec leurs règles de dimensionnement simplifiées.
Lexique Illustré du Génie Civil Spécial
Un glossaire visuel définira les termes techniques spécifiques à la géotechnique avancée et aux travaux fluviaux (boulance, affouillement, batardeau, para-fouille, etc.), pour une parfaite maîtrise du vocabulaire professionnel. Building construction



