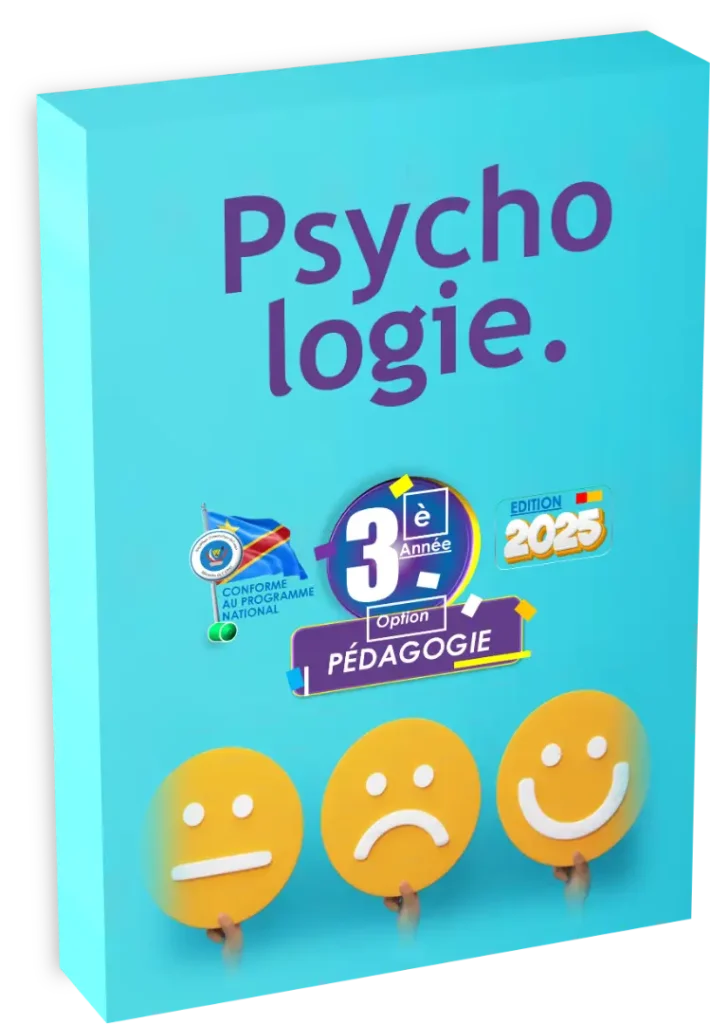
MANUEL DE PSYCHOLOGIE, 3ème ANNEE, (5ème DES HUMANITÉS), OPTION PÉDAGOGIE GÉNÉRALE
Edition 2025 / Enseignement Primaire, Secondaire et Technique en RDC
PRÉLIMINAIRES
Note aux Enseignants et aux Apprenants 📝
Ce manuel constitue un outil didactique fondamental conçu pour les élèves de la 3ème année des Humanités Pédagogiques (5ème année secondaire) en République Démocratique du Congo. Il s’aligne rigoureusement sur le Programme National révisé, transformant les concepts théoriques de la psychologie cognitive et différentielle en compétences professionnelles tangibles. L’objectif premier réside dans l’équipement du futur enseignant d’une compréhension fine des mécanismes mentaux de l’élève, condition sine qua non d’une transmission efficace des savoirs. La maîtrise de ces contenus permet à l’éducateur d’adapter sa méthodologie aux réalités psychologiques de sa classe, qu’elle se situe dans une zone rurale du Kwilu ou dans un milieu urbain dense comme Kinshasa.
Profil de sortie de l’élève 🎓
Au terme de ce cours, l’apprenant démontre une capacité à analyser les processus cognitifs régissant l’apprentissage. Il distingue avec précision les nuances de la vie intellectuelle, depuis la simple sensation jusqu’au raisonnement complexe. Il possède les compétences nécessaires pour identifier les traits de caractère de ses futurs élèves en utilisant les typologies classiques et modernes. Enfin, il intègre ces connaissances psychologiques pour concevoir des interventions pédagogiques qui respectent le rythme de développement et la personnalité unique de chaque enfant congolais.
Planification et Volume Horaire général ⏳
Le volume horaire respecte les directives officielles du Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique. La répartition des matières assure une progression logique : l’analyse des « entrées » sensorielles (connaissance sensible) précède l’étude des traitements intellectuels (connaissance rationnelle), pour aboutir à une synthèse sur la personnalité globale de l’enfant (caractérologie). Cette structure garantit une assimilation graduelle et structurée des concepts.
PREMIÈRE PARTIE : LES FONDEMENTS DE LA CONNAISSANCE SENSIBLE
Cette première partie explore les mécanismes par lesquels l’être humain entre en contact avec son environnement. Elle analyse la manière dont les stimuli extérieurs sont captés, transmis et interprétés par le cerveau, constituant ainsi la base de toute activité intellectuelle ultérieure. L’accent est mis sur l’importance de l’éducation sensorielle dans le contexte scolaire congolais.
Chapitre 1 : Introduction à la Vie Cognitive et Rappels
Ce chapitre établit la jonction entre les acquis de la classe précédente et les nouvelles matières, assurant une continuité pédagogique fluide.
1.1. Rappel des acquis de la 4ème année
La psychologie enseignée en 4ème année se concentrait sur la vie affective (sentiments, émotions, passions) et la vie active (tendances, volonté, habitudes). Il est impératif de remobiliser ces notions pour comprendre que la cognition ne fonctionne jamais en vase clos ; elle est constamment influencée par l’état émotionnel de l’élève. Un enfant anxieux à l’idée d’un examen à Lubumbashi verra ses capacités cognitives perturbées par son affectivité.
1.2. Définition et portée de la Vie Cognitive
La vie cognitive, ou représentative, englobe l’ensemble des processus mentaux qui permettent à l’homme d’acquérir, de conserver et d’utiliser des connaissances sur le monde et sur lui-même. Elle se distingue de la vie affective (sentir) et de la vie active (agir), bien qu’elle les nourrisse. Elle constitue le champ d’action principal de l’instruction scolaire.
1.3. Distinction entre Connaissance Sensible et Rationnelle
La connaissance sensible provient directement de l’interaction des organes des sens avec la matière (voir, toucher, entendre). Elle est concrète, immédiate et singulière. La connaissance rationnelle, quant à elle, opère par abstraction et généralisation. L’enseignement primaire en RDC, notamment au degré élémentaire, s’appuie massivement sur la connaissance sensible pour mener progressivement l’enfant vers l’abstraction rationnelle.
1.4. L’importance de la cognition en pédagogie
L’enseignant étudie la psychologie cognitive pour optimiser les apprentissages. Comprendre comment un élève perçoit, mémorise et réfléchit permet d’ajuster les méthodes didactiques. Par exemple, l’utilisation de matériel didactique concret (objets réels, schémas) sollicite la connaissance sensible pour faciliter la compréhension de concepts abstraits.
Chapitre 2 : Les Sens et la Sensibilité
Ce chapitre décortique la porte d’entrée de toute information : le système sensoriel.
2.1. Anatomie et physiologie des organes des sens
L’étude débute par une analyse biologique succincte mais précise. Chaque sens (vue, ouïe, odorat, goût, toucher, sens kinesthésique) possède un organe récepteur spécifique. L’élève-maître doit connaître la structure de l’œil ou de l’oreille pour comprendre les troubles sensoriels potentiels (myopie, surdité partielle) qui peuvent entraver la scolarité d’un enfant assis au fond d’une classe surpeuplée à Mbuji-Mayi.
2.2. Distinction entre Sens et Organe de sens
Le concept de « sens » réfère à la faculté physiologique de percevoir, tandis que « l’organe » est la structure anatomique instrumentale. Il est crucial de différencier la fonction (la vision) de l’outil (l’œil). Cette distinction permet d’aborder les cas où l’organe est intact mais la fonction altérée (cécité corticale, par exemple), bien que le cours se focalise sur les aspects fonctionnels courants.
2.3. La Sensibilité : Notion et Critères
La sensibilité désigne la capacité d’un organisme à réagir à des excitations. Elle varie selon les individus et les conditions (fatigue, attention). Les critères de sensibilité incluent le seuil absolu (l’intensité minimale pour qu’une sensation naisse) et le seuil différentiel (la variation minimale pour percevoir une différence).
2.4. Classification et mesure de la sensibilité
On distingue la sensibilité extéroceptive (monde extérieur), intéroceptive (viscères, faim, soif) et proprioceptive (position du corps, équilibre). La mesure de la sensibilité permet de dépister des déficits. En classe, l’enseignant veille à ce que les conditions d’éclairage et d’acoustique respectent les limites de la sensibilité moyenne des élèves.
Chapitre 3 : La Sensation et la Perception
Ce chapitre traite du passage de l’excitation physiologique à la prise de conscience psychologique de l’objet.
3.1. La Sensation : Phénomène initial
La sensation est la prise de conscience élémentaire d’une qualité de l’objet (rouge, chaud, aigu) suite à l’excitation d’un organe sensoriel. Elle est un phénomène purement psychophysiologique. Le cours insiste sur ses caractères (intensité, durée, tonalité affective) et ses propriétés. Une sensation isolée est une abstraction théorique chez l’adulte, car elle est toujours immédiatement interprétée.
3.2. La Perception : Construction du réel
La perception est l’acte par lequel l’esprit organise et interprète les sensations pour identifier un objet. Elle transforme le « bruit » en « son de cloche » ou la « tache colorée » en « drapeau de la RDC ». Elle implique l’intervention de la mémoire et de l’intelligence. C’est une connaissance sensible complète.
3.3. Facteurs et Lois de la Perception
La perception est subjective et sélective. Elle dépend de facteurs objectifs (taille, mouvement, contraste de l’objet) et subjectifs (besoins, intérêts, culture de l’observateur). Les lois de la perception (la Gestalt) expliquent comment nous regroupons les éléments : loi de proximité, de similarité, de clôture. Un enfant percevra un mot globalement avant d’en distinguer les lettres (méthode globale de lecture).
3.4. Applications pédagogiques de la perception
L’enseignant tire profit de ces notions en présentant des documents clairs, en variant les stimuli et en éduquant la perception. L’exercice d’observation d’une plante dans la cour de l’école ou l’analyse d’une carte de géographie du bassin du Congo sont des activités d’éducation perceptive essentielles.
Chapitre 4 : La Mémoire et l’Imagination
Ce chapitre aborde les facultés de conservation et de reproduction des images mentales.
4.1. La Mémoire : Fixation et Conservation
La mémoire est la faculté de fixer, conserver, rappeler et reconnaître des états de conscience passés. Elle n’est pas un simple réservoir passif. L’étude des types de mémoire (sensorielle, à court terme, à long terme) est capitale. En RDC, où la tradition orale est forte, la mémoire auditive est souvent très développée, mais l’école doit aussi cultiver la mémoire visuelle et logique.
4.2. Le Rappel et la Reconnaissance (Mémoire chez l’enfant)
L’évocation peut être spontanée ou volontaire. La reconnaissance identifie le souvenir comme passé. Chez l’enfant, la mémoire est mécanique et instable avant de devenir logique. L’enseignant doit structurer les apprentissages (plans, résumés) pour faciliter le passage d’une mémoire « par cœur » à une mémoire intelligente. Les pathologies (amnésies, dysmnésies) sont brièvement abordées.
4.3. L’Imagination : Reproductive et Créatrice
L’imagination est la faculté de se représenter des images sensibles en l’absence des objets. L’imagination reproductrice (souvenir imagé) diffère de l’imagination créatrice (combinaison nouvelle d’images). Cette dernière est le moteur de l’innovation artistique et scientifique.
4.4. Gestion pédagogique de l’Imagination
L’imagination de l’enfant est débordante et parfois confondue avec la réalité (fabulation). L’éducateur ne doit pas brider cette faculté mais la canaliser vers la créativité (dessin, rédaction, résolution de problèmes). Les dangers d’une imagination déréglée (rêverie excessive, mensonge compensatoire) sont analysés pour permettre une intervention éducative appropriée.
DEUXIÈME PARTIE : DYNAMIQUE DE L’ESPRIT ET PROCESSUS INTELLECTUELS
Cette partie examine comment l’esprit manipule les données sensorielles pour construire des pensées complexes, résoudre des problèmes et atteindre la vérité rationnelle. Elle couvre les fonctions de liaison et d’élaboration supérieure.
Chapitre 5 : L’Association des Idées et l’Attention
Ce chapitre explique comment les pensées s’enchaînent et comment l’esprit se focalise.
5.1. L’Association des Idées : Lois et Formes
Les idées ne surgissent pas au hasard ; elles s’appellent les unes les autres. L’association se fait par contiguïté (table/chaise), par ressemblance (portrait/modèle) ou par contraste (blanc/noir). Comprendre ces mécanismes permet à l’enseignant de lier la matière nouvelle aux connaissances antérieures de l’élève (« rappel »), créant ainsi un réseau de savoirs solide.
5.2. L’Attention : Définition et Types
L’attention est la concentration de l’activité mentale sur un objet déterminé. Elle peut être spontanée (attirée par l’intérêt) ou volontaire (exigeant un effort). En classe, l’attention volontaire est coûteuse en énergie. L’enseignant alterne les phases d’effort et de détente pour optimiser la vigilance.
5.3. Facteurs favorisant l’Attention
L’intensité du stimulus, la nouveauté, le mouvement et surtout l’intérêt (motivation) sont des facteurs clés. Dans une classe bruyante à Matadi, maintenir l’attention est un défi. L’enseignant utilise la variation de la voix, les gestes et des supports visuels attrayants pour capter l’esprit des élèves.
5.4. La Distraction : Causes et Remèdes
La distraction est l’absence d’attention sur l’objet requis. Elle peut être apparente (élève concentré sur autre chose) ou réelle (fatigue mentale). Les causes physiologiques (faim, maladie), psychologiques (soucis familiaux) ou pédagogiques (cours ennuyeux) doivent être diagnostiquées. Le remède réside souvent dans une pédagogie active et participative.
Chapitre 6 : L’Observation et l’Intérêt
Ce chapitre traite de l’attitude active de l’esprit face au réel et de son moteur affectif.
6.1. L’Observation comme méthode
L’observation est une perception volontaire, prolongée et planifiée. Elle dépasse le simple regard. C’est une démarche scientifique de base. À l’école primaire, les leçons d’observation (leçon de choses) sont fondamentales pour ancrer le savoir dans le concret. L’enfant apprend à observer avec méthode : voir le tout, puis les détails, puis reconstituer le tout.
6.2. Stades de l’observation chez l’enfant
L’observation de l’enfant évolue : d’abord syncrétique (globale et confuse), elle devient analytique (détails juxtaposés) puis synthétique (liens logiques). L’éducateur guide cette progression par des consignes précises (« Regardez la forme des feuilles, puis la couleur… »).
6.3. L’Intérêt : Moteur de l’apprentissage
L’intérêt est la tendance qui porte l’esprit vers un objet qui répond à un besoin. Sans intérêt, l’effort d’attention est épuisant et stérile. Il existe des intérêts innés (jeu, mouvement) et acquis. La loi de l’intérêt commande de fonder l’enseignement sur les besoins de l’enfant.
6.4. Evolution et exploitation des intérêts
Les centres d’intérêt évoluent avec l’âge (intérêts glosso-moteurs, subjectifs, objectifs, sociaux). Le maître habile connecte les matières arides aux intérêts actuels de ses élèves (ex: utiliser le football pour enseigner la géométrie ou les statistiques).
Chapitre 7 : L’Intelligence et sa Mesure (Psychométrie)
Ce chapitre aborde la faculté suprême d’adaptation et de compréhension.
7.1. Nature et Formes de l’Intelligence
L’intelligence est définie comme la capacité globale d’adaptation à des situations nouvelles par la pensée. On distingue l’intelligence pratique (manipulation d’objets), abstraite (concepts, symboles) et sociale (relations humaines). Le cours souligne que l’intelligence n’est pas unique mais multiforme.
7.2. Intelligence vs Instinct
Contrairement à l’instinct, qui est inné, rigide et spécifique à l’espèce (comme la construction du nid chez l’oiseau), l’intelligence est souple, individuelle et progresse par l’expérience. L’éducation vise à développer l’intelligence pour libérer l’homme des automatismes instinctifs.
7.3. La Mesure de l’Intelligence : Tests et Q.I.
L’introduction à la psychométrie inclut la notion de test (épreuve standardisée). On étudie l’échelle métrique de Binet-Simon et le concept d’Âge Mental. Le Quotient Intellectuel (Q.I.) est le rapport entre l’âge mental et l’âge chronologique. Le calcul du Q.I. permet de classer les individus (moyen, supérieur, déficience).
7.4. Limites et éthique des tests
L’enseignant apprend à interpréter ces mesures avec prudence. Un Q.I. n’est pas un destin figé. Les facteurs culturels, linguistiques et émotionnels peuvent biaiser les résultats. En RDC, l’utilisation de tests occidentaux non calibrés doit être sujette à critique. L’évaluation de l’intelligence sert à dépister les difficultés pour mieux aider, non pour exclure.
Chapitre 8 : La Pensée, l’Idée et Le Jugement
Ce chapitre analyse les constituants de la connaissance rationnelle.
8.1. La Pensée et la formation de l’Idée
La pensée est l’activité psychique qui élabore des concepts. L’idée (ou concept) est la représentation abstraite et générale d’un objet (l’idée de « chaise » s’applique à toutes les chaises). Elle se forme par abstraction (isoler une qualité) et généralisation (l’étendre à une classe d’objets). L’enseignant aide l’élève à passer de l’image (concrète) à l’idée (abstraite).
8.2. Caractères et Classification des Idées
L’idée est abstraite, générale et universelle. On distingue les idées concrètes (homme, arbre) et abstraites (bonté, justice). La clarté des idées est essentielle pour la clarté du discours. Le vocabulaire est le vêtement de l’idée ; enrichir le vocabulaire, c’est affiner la pensée.
8.3. Le Jugement : Affirmation de rapports
Le jugement est l’acte par lequel l’esprit affirme ou nie un rapport entre deux idées (« La terre est ronde »). C’est l’acte central de l’intelligence. Il implique une prise de position et un engagement de la personnalité. Le jugement critique est la capacité d’évaluer la valeur d’une affirmation avant de l’accepter.
8.4. Éducation du Jugement
L’école doit former le jugement, pas seulement la mémoire. Cela passe par l’exercice du sens critique, l’analyse de documents, la vérification des sources et la lutte contre les préjugés tribaux ou sociaux. Un citoyen congolais éclairé est un citoyen capable de jugement autonome.
Chapitre 9 : Le Raisonnement et la Logique
Ce chapitre clôt la partie cognitive par l’étude de l’enchaînement des jugements.
9.1. Le Raisonnement : Définition et Mécanisme
Le raisonnement est l’opération discursive par laquelle l’esprit tire une conclusion nouvelle d’une ou plusieurs propositions connues (prémisses). C’est la marche de la pensée vers la vérité. Il exige rigueur et cohérence.
9.2. Raisonnement Inductif et Déductif
L’induction remonte des faits particuliers à la loi générale (démarche scientifique expérimentale). La déduction descend de la loi générale au cas particulier (syllogisme, mathématiques). La didactique moderne en RDC privilégie la démarche inductive à l’école primaire : partir de l’observation pour arriver à la règle.
9.3. Les causes de l’erreur et les remèdes
L’erreur provient souvent de la précipitation, des passions, des préjugés ou de l’ignorance. La logique étudie les règles formelles de la vérité. L’enseignant inculque la probité intellectuelle : vérifier ses hypothèses, reconnaître ses erreurs et chercher les preuves.
9.4. Applications didactiques
La structure des leçons (analyse, synthèse, application) reflète le mouvement du raisonnement. L’enseignant veille à la cohérence de ses explications et encourage les élèves à justifier leurs réponses (« Pourquoi dis-tu cela ? »), transformant la classe en une communauté de recherche.
TROISIÈME PARTIE : PERSONNALITÉ, CARACTÉROLOGIE ET APPLICATIONS
Cette dernière partie synthétise l’ensemble des fonctions psychologiques pour étudier l’individu dans sa globalité et sa singularité. Elle fournit les clés pour comprendre la diversité des profils d’élèves.
Chapitre 10 : La Personnalité et ses Composantes
Ce chapitre définit l’individualité psychologique totale.
10.1. Notion de Personnalité
La personnalité est l’organisation dynamique des aspects cognitifs, affectifs, conatifs (volonté) et physiologiques de l’individu. Elle est ce qui fait que chaque personne est unique. Elle comprend le tempérament (inné, biologique) et le caractère (acquis, psychologique).
10.2. Les éléments constitutifs
On analyse les strates de la personnalité : le physique (constitution), le tempérament (base physiologique), les aptitudes (capacités intellectuelles et physiques) et le caractère (manière habituelle de réagir). Le « Moi » assure l’unité de la personne.
10.3. Le développement de la personnalité
La personnalité se construit tout au long de la vie sous l’influence de l’hérédité et du milieu (famille, école, société). L’adolescence est une période critique de restructuration de la personnalité. L’éducateur joue un rôle de modèle et de guide dans cette construction.
10.4. L’étude de la personnalité (Méthodes)
Pour connaître la personnalité de l’élève, l’enseignant utilise l’observation du comportement, l’analyse des travaux scolaires, les entretiens et les tests de personnalité (projectifs ou questionnaires, adaptés au niveau).
Chapitre 11 : Le Caractère et ses Facteurs d’Évolution
Ce chapitre se focalise sur l’aspect le plus stable et distinctif de la conduite.
11.1. Définition et Importance du Caractère
Le caractère est l’ensemble des dispositions congénitales qui forment le squelette mental de l’homme. Il détermine la manière constante de sentir, de penser et d’agir. Connaître le caractère d’un élève permet de prévoir ses réactions et de choisir les leviers de motivation efficaces.
11.2. Éléments fondamentaux du Caractère
Selon l’école de Groningue (Heymans et Wiersma), trois propriétés fondamentales définissent le caractère :
- L’Émotivité : La force de la réaction affective aux événements.
- L’Activité : Le besoin spontané d’agir et de transformer la réalité.
- Le Retentissement : La durée de l’effet d’une impression (Primaire = réaction immédiate et courte ; Secondaire = réaction différée et durable).
11.3. Facteurs d’évolution du caractère
Bien que le noyau caractériel soit inné, il n’est pas immuable. Le caractère évolue sous l’action de l’éducation, de l’auto-éducation (effort volontaire), de la santé, et des expériences de vie. Le rôle de l’école est d’aider l’enfant à tirer le meilleur parti de son caractère, en compensant ses défauts et en exaltant ses qualités.
11.4. Caractère et réussite scolaire
Certains caractères sont naturellement plus adaptés au système scolaire classique (ex: les calmes, appliqués) que d’autres (ex: les hyperactifs, impulsifs). L’enseignant évite de stigmatiser les élèves « difficiles » et cherche des voies pédagogiques adaptées à chaque profil.
Chapitre 12 : Les Typologies et Applications Pédagogiques
Ce chapitre présente les classifications qui permettent de catégoriser les profils psychologiques pour mieux agir.
12.1. La Typologie de Heymans et Wiersma (Le Senne)
C’est la classification la plus utilisée en pédagogie. Elle combine les trois facteurs (E, A, R) pour définir 8 types :
- Le Nerveux (Emotif, Non-Actif, Primaire)
- Le Sentimental (Emotif, Non-Actif, Secondaire)
- Le Colérique (Emotif, Actif, Primaire)
- Le Passionné (Emotif, Actif, Secondaire)
- Le Sanguin (Non-Emotif, Actif, Primaire)
- Le Flegmatique (Non-Emotif, Actif, Secondaire)
- L’Amorphe (Non-Emotif, Non-Actif, Primaire)
- L’Apathique (Non-Emotif, Non-Actif, Secondaire)
12.2. Autres Typologies (Morphopsychologie et Psychanalyse)
Le cours survole d’autres approches pour enrichir la perspective :
- Hippocrate : Les 4 tempéraments basés sur les humeurs.
- Kretchmer et Sheldon : Le lien entre morphologie (corps) et caractère (ex: le pycnique sociable, le leptosome renfermé).
- Jung : Introverti (tourné vers soi) vs Extraverti (tourné vers le monde).
- Freud : Les types érotique, narcissique, obsessionnel (mention brève).
- Spranger : Les types basés sur les valeurs (théorique, économique, esthétique, social, politique, religieux).
- Viola : Classification morphologique italienne.
12.3. Portrait pédagogique des 8 types caractérologiques
Pour chaque type (Nerveux, Colérique, etc.), le manuel détaille :
- Les traits dominants (qualités/défauts).
- Le comportement en classe.
- Les conseils éducatifs spécifiques (ex : encourager le Nerveux sans le brusquer, occuper le Colérique avec des responsabilités, stimuler l’Amorphe par des objectifs courts).
12.4. Applications Pédagogiques Globales
La caractérologie ne sert pas à étiqueter l’enfant mais à comprendre sa « formule personnelle ». Elle fonde une pédagogie différenciée. Dans une classe hétérogène à Kisangani, l’enseignant sait qu’il ne peut exiger la même forme de participation d’un Sentimental timide et d’un Sanguin exubérant. L’objectif est l’épanouissement de chacun dans le respect de sa nature propre.
ANNEXES
Guide des Travaux Pratiques 🛠️
Cette section propose des modèles d’exercices d’observation : fiches d’analyse de comportement, grilles d’évaluation de l’attention en classe, et canevas pour l’étude de cas d’un élève. Elle inclut des exercices de calcul de Q.I. (fictifs pour l’entraînement) et des scénarios de gestion de conflits basés sur les types de caractères.
Glossaire des Termes Techniques 📖
Un lexique détaillé définit les concepts clés (Seuil différentiel, Synesthésie, Introspection, Syllogisme, Homéostasie, etc.) pour assurer la précision du langage professionnel des futurs pédagogues.
Bibliographie et Webographie Sélective 📚
Une liste de références classiques (Piaget, Wallon, Le Senne) et de ressources modernes accessibles aux enseignants en RDC pour approfondir leur formation continue.



