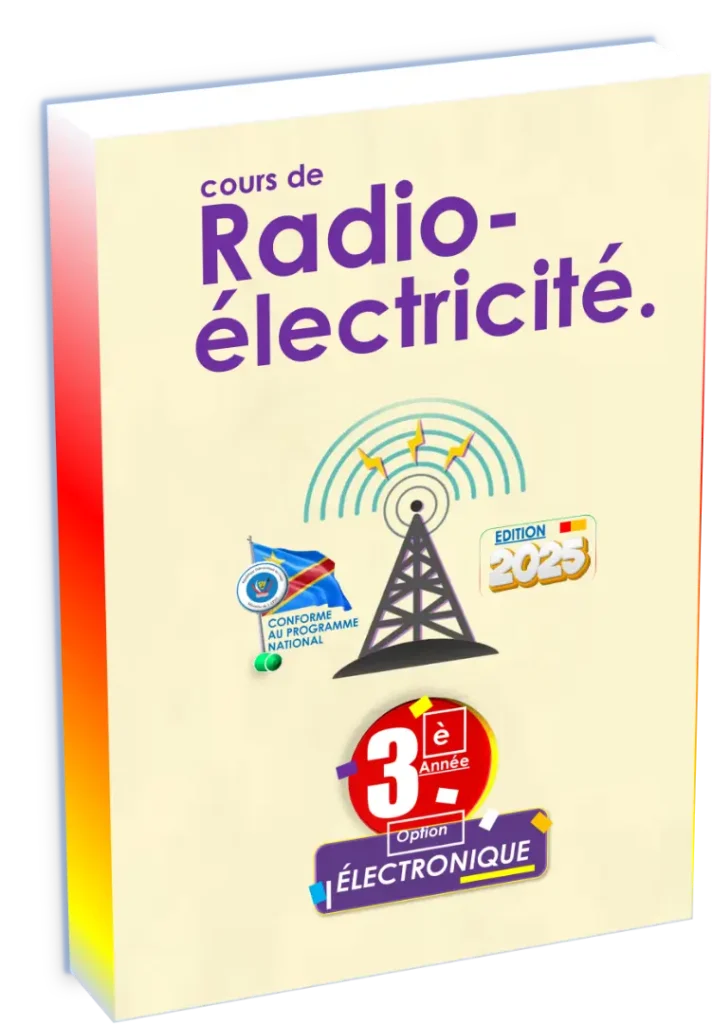
RADIO ÉLECTRICITÉ
3ÈME ANNÉE – OPTION ÉLECTRONIQUE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
Préliminaires
1. Objectifs Généraux du Cours
Ce manuel a pour objectif de fournir à l’élève une compréhension approfondie des principes fondamentaux de la transmission et de la réception des signaux radioélectriques. Le cours établit les bases théoriques des ondes électromagnétiques, explore les techniques de modulation qui permettent de superposer une information sur une onde porteuse, et dissèque l’architecture des récepteurs radio. La finalité est de développer une compétence systémique, permettant à l’élève d’analyser une chaîne de radiocommunication dans son ensemble, de l’antenne émettrice à l’étage de démodulation du récepteur.
2. Compétences Visées
Au terme de cette année de formation, l’élève détiendra la capacité de :
- Expliquer la nature des ondes électromagnétiques et décrire leurs modes de propagation.
- Analyser les principes de la modulation et de la démodulation d’amplitude (AM) et de fréquence (FM).
- Décrire le principe de fonctionnement et justifier l’architecture d’un récepteur superhétérodyne.
- Identifier le rôle et analyser le fonctionnement des étages clés d’un récepteur : étage d’entrée, oscillateur local, mélangeur, amplificateur FI.
- Interpréter les caractéristiques des circuits radiofréquences et justifier leur utilisation dans une chaîne de réception.
3. Approche Pédagogique
La démarche pédagogique est construite comme un voyage qui suit le parcours du signal radio. Partant des généralités sur les ondes, le cours aborde ensuite la manière de « coder » l’information (modulation), avant de se consacrer en détail à la manière de la « décoder » (réception et démodulation). L’architecture du récepteur superhétérodyne sert de fil conducteur pour l’étude des différentes fonctions électroniques spécialisées. Des études de cas, comme l’analyse de la chaîne de réception d’une station de radio commerciale à Kinshasa ou la conception d’un étage d’entrée pour un récepteur destiné à capter des signaux faibles dans la région du Kasaï, permettent d’illustrer la mise en œuvre pratique des concepts théoriques.
PREMIÈRE PARTIE : FONDEMENTS DES ONDES ET DE LA PROPAGATION RADIOÉLECTRIQUE 📡
Cette partie inaugurale pose les fondations physiques indispensables à la compréhension de toute communication sans fil. Avant d’étudier les circuits, il est crucial de comprendre la nature du médium de transmission : l’espace libre. L’élève y découvrira la nature des ondes électromagnétiques, les mécanismes qui régissent leur voyage sur de courtes et de longues distances, et le rôle de l’antenne comme transducteur essentiel entre le monde des circuits guidés et l’univers des ondes propagées.
CHAPITRE 1 : LES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
1.1. Nature du champ électromagnétique
L’onde électromagnétique est présentée comme la propagation couplée d’un champ électrique et d’un champ magnétique, perpendiculaires entre eux et à la direction de propagation. Le concept d’onde transversale est établi.
1.2. Le spectre électromagnétique
Le spectre électromagnétique est décrit comme un continuum d’ondes classées par fréquence ou par longueur d’onde. L’élève apprendra à situer les ondes radio (des VLF aux hyperfréquences) au sein de ce spectre, aux côtés de la lumière visible, des rayons X et d’autres rayonnements.
1.3. Caractéristiques d’une onde radio
Les paramètres fondamentaux d’une onde radio sont définis : sa fréquence (en Hertz), sa longueur d’onde (en mètres) et la relation qui les lie via la vitesse de la lumière (). La notion de polarisation de l’onde (verticale, horizontale, circulaire) est également introduite.
1.4. Classification des bandes de fréquences
La terminologie officielle des bandes de fréquences radio (LF, MF, HF, VHF, UHF, etc.) est présentée. L’élève associera chaque bande à ses propriétés de propagation et à ses usages typiques (radiodiffusion, télécommunications mobiles, liaisons satellitaires).
CHAPITRE 2 : PROPAGATION DES ONDES RADIO
2.1. L’onde de sol
L’onde de sol est le mode de propagation qui suit la courbure de la Terre. L’élève comprendra que ce mode est efficace pour les basses fréquences (grandes ondes, ondes moyennes) et qu’il permet des liaisons stables sur plusieurs centaines de kilomètres, comme pour la diffusion de la radio nationale (RTNC).
2.2. L’onde d’espace (ou onde directe)
L’onde d’espace se propage en ligne droite, en visibilité directe entre l’émetteur et le récepteur. Ce mode est prédominant pour les fréquences élevées (VHF, UHF et au-delà). Son utilisation pour la radio FM, la télévision et les liaisons par faisceau hertzien est expliquée.
2.3. L’onde réfléchie (ou onde ionosphérique)
Les couches ionisées de la haute atmosphère (l’ionosphère) peuvent réfléchir les ondes HF (ondes courtes). L’élève découvrira ce phénomène qui permet des communications à très longue distance, voire intercontinentales, en faisant « rebondir » le signal.
2.4. Phénomènes affectant la propagation
Les principaux phénomènes qui peuvent perturber une liaison radio sont décrits : l’atténuation due à la distance et aux obstacles, les évanouissements (fading) dus aux trajets multiples, et les interférences causées par d’autres sources.
CHAPITRE 3 : LES ANTENNES : INTERFACE AVEC L’ESPACE
3.1. Le principe de réciprocité
Le principe de réciprocité est énoncé : les propriétés d’une antenne (gain, diagramme de rayonnement, impédance) sont identiques, qu’elle soit utilisée en émission ou en réception.
3.2. L’antenne dipôle demi-onde
L’antenne la plus fondamentale, le dipôle , est présentée. Sa structure, sa longueur physique et son diagramme de rayonnement en forme de tore sont décrits. Son impédance caractéristique (environ 73 Ω) est introduite.
3.3. Gain et directivité
Le gain d’une antenne est défini comme sa capacité à concentrer l’énergie rayonnée dans une direction privilégiée. Le concept de diagramme de rayonnement, qui représente graphiquement cette répartition spatiale de l’énergie, est expliqué.
3.4. Adaptation d’impédance
Pour un transfert de puissance maximal, l’impédance de l’antenne doit être adaptée à celle de la ligne de transmission (le câble coaxial). L’élève comprendra l’importance de cette adaptation pour éviter les pertes par désadaptation, un enjeu majeur pour les stations de télécommunication de la SCTP.
DEUXIÈME PARTIE : LES PRINCIPES DE LA MODULATION ET DE LA DÉMODULATION D’AMPLITUDE (AM) 📻
Cette partie plonge au cœur du processus de communication en étudiant la technique la plus ancienne et la plus simple pour transmettre une information (comme la voix) par voie radio : la modulation d’amplitude. L’élève apprendra comment on peut faire varier l’amplitude d’une onde porteuse haute fréquence au rythme du signal basse fréquence à transmettre. La contrepartie, la démodulation, qui consiste à extraire l’information originale de l’onde reçue, sera également étudiée en détail.
CHAPITRE 4 : LA MODULATION D’AMPLITUDE (AM)
4.1. Le but de la modulation
La nécessité de la modulation est justifiée. L’élève comprendra qu’il est impossible de rayonner directement des signaux basse fréquence (audio) et que la modulation permet de translater le spectre du signal informatif autour d’une fréquence porteuse élevée, apte à être propagée.
4.2. Le principe de la modulation d’amplitude
Le principe est expliqué : l’amplitude de la porteuse HF est rendue proportionnelle à l’amplitude instantanée du signal modulant BF. L’expression mathématique du signal modulé en amplitude est présentée.
4.3. Spectre et puissance d’un signal AM
L’analyse spectrale du signal AM révèle la présence de trois composantes : la porteuse et deux bandes latérales (supérieure et inférieure) qui contiennent l’information. L’élève apprendra à calculer la puissance totale émise et sa répartition entre la porteuse et les bandes latérales.
4.4. Les différentes classes de modulation AM
Les variantes de la modulation AM sont introduites : la modulation à double bande latérale avec porteuse (la plus simple), à porteuse supprimée (plus efficace en puissance), et à bande latérale unique (BLU ou SSB), la plus efficace en puissance et en bande passante, utilisée par les radioamateurs et pour certaines liaisons professionnelles.
CHAPITRE 5 : LA DÉMODULATION D’AMPLITUDE (DÉTECTION AM)
5.1. Le but de la démodulation
La démodulation (ou détection) est le processus inverse de la modulation. Son but est d’extraire le signal modulant basse fréquence (l’enveloppe) de l’onde porteuse haute fréquence reçue.
5.2. La détection par diode
Le circuit de démodulation AM le plus simple, la détection d’enveloppe par diode, est analysé en détail. Son fonctionnement repose sur le redressement simple alternance du signal HF, suivi d’un filtrage passe-bas par une cellule RC pour ne conserver que l’enveloppe.
5.3. Performances et limitations de la détection par diode
Les avantages (grande simplicité) et les inconvénients (distorsion pour les forts taux de modulation) de ce démodulateur sont discutés. Le choix correct de la constante de temps du circuit RC est présenté comme un compromis essentiel.
5.4. Démodulation synchrone
La démodulation synchrone, une technique plus performante, est introduite. Elle consiste à multiplier le signal reçu par un signal sinusoïdal local de même fréquence et de même phase que la porteuse originale. Cette méthode est nécessaire pour démoduler les signaux à porteuse supprimée.
CHAPITRE 6 : LES RÉCEPTEURS RADIO AM SIMPLES
6.1. Le récepteur à cristal (poste à galène)
Le schéma du récepteur radio le plus élémentaire est présenté. Il est constitué d’une antenne, d’un circuit d’accord LC, d’une diode de détection et d’un écouteur. Son fonctionnement sans aucune source d’alimentation est expliqué.
6.2. Le récepteur à amplification directe
Pour améliorer la sensibilité, on peut ajouter des étages d’amplification. Le schéma d’un récepteur à amplification directe est analysé : il amplifie directement le signal radiofréquence (RF) reçu, le démodule, puis amplifie le signal audio (BF).
6.3. Limitations des récepteurs à amplification directe
Les problèmes inhérents à cette architecture simple sont expliqués : une sélectivité et une sensibilité qui varient avec la fréquence d’accord, et un risque d’instabilité si le gain RF est élevé. Ces limitations justifient le passage à une architecture plus complexe.
6.4. Identification des blocs fonctionnels
L’élève s’exercera à identifier sur un schéma les différents blocs fonctionnels d’un récepteur simple : le circuit d’accord d’antenne, l’amplificateur RF, le détecteur, et l’amplificateur BF.
TROISIÈME PARTIE : LE RÉCEPTEUR SUPERHÉTÉRODYNE ET SES ÉTAGES 🔧
Cette partie est consacrée à l’étude de l’architecture de récepteur qui est, depuis son invention, universellement utilisée dans la quasi-totalité des appareils de radiocommunication : le récepteur superhétérodyne. Son principe génial consiste à convertir la fréquence de tous les signaux reçus en une fréquence unique et fixe, appelée fréquence intermédiaire, où l’essentiel de l’amplification et du filtrage peut être réalisé avec de très hautes performances. Chaque étage de cette architecture est disséqué.
CHAPITRE 7 : LE PRINCIPE DU RÉCEPTEUR SUPERHÉTÉRODYNE
7.1. Le but du changement de fréquence
Le principe du changement de fréquence est expliqué comme la solution aux problèmes de l’amplification directe. En transposant le signal RF reçu à une fréquence intermédiaire (FI) constante, on peut concevoir des amplificateurs et des filtres très performants, optimisés pour cette seule fréquence.
7.2. Le schéma bloc du récepteur superhétérodyne
Le schéma synoptique du récepteur superhétérodyne AM est présenté et analysé bloc par bloc : étage d’entrée RF, oscillateur local, mélangeur, amplificateur FI, démodulateur, CAG, et amplificateur BF.
7.3. Le phénomène de battement et la fréquence image
La transposition de fréquence est réalisée dans le mélangeur, qui produit en sortie des signaux dont les fréquences sont la somme et la différence des fréquences d’entrée (signal RF et oscillateur local). Le concept de fréquence image, une fréquence indésirable qui peut aussi être convertie en FI, est introduit comme étant le principal « talon d’Achille » de cette architecture.
7.4. La commande unique
Pour simplifier l’accord du récepteur, la commande du condensateur variable du circuit d’accord RF et de celui de l’oscillateur local est mécaniquement couplée. L’élève comprendra comment cette « commande unique » permet de maintenir un écart de fréquence constant entre les deux circuits sur toute la gamme de réception.
CHAPITRE 8 : L’ÉTAGE D’ENTRÉE HAUTE FRÉQUENCE (HF)
8.1. Rôles de l’étage d’entrée
Les trois rôles de l’étage d’entrée (ou étage RF) sont détaillés : assurer un premier filtrage pour améliorer la sélectivité et rejeter la fréquence image, réaliser une première amplification pour améliorer la sensibilité, et adapter l’impédance de l’antenne.
8.2. Les circuits d’accord RF
Les circuits d’accord utilisés à l’entrée sont des filtres passe-bande LC dont la fréquence centrale est rendue variable. L’élève étudiera le schéma de ces circuits et leur courbe de réponse.
8.3. L’amplificateur RF
L’amplificateur RF est un amplificateur accordé, conçu pour un gain modéré mais surtout un faible bruit, afin de ne pas dégrader le rapport signal/bruit du signal reçu, un facteur critique pour la réception des stations lointaines dans les zones rurales comme celles du Maniema.
8.4. Différents modes de réception
Les différents modes de couplage de l’antenne à l’étage d’entrée sont présentés : couplage direct, capacitif ou inductif (par transformateur RF). Les caractéristiques de chaque mode sont énoncées.
CHAPITRE 9 : LE CHANGEMENT DE FRÉQUENCE : MÉLANGEUR ET OSCILLATEUR LOCAL
9.1. L’oscillateur local (OL)
L’oscillateur local est un oscillateur LC de bonne stabilité dont la fréquence est toujours décalée de la valeur de la fréquence intermédiaire par rapport à la fréquence reçue (). Son rôle est de fournir le signal qui sera « battu » avec le signal RF.
9.2. Le mélangeur
Le mélangeur est un circuit non linéaire qui reçoit deux signaux (RF et OL) et produit en sortie un signal complexe contenant de nombreuses fréquences, dont la somme et la différence. L’élève étudiera le principe de ce circuit, qui peut être réalisé à l’aide d’une diode ou d’un transistor.
9.3. Avantages et inconvénients du changement de fréquence
Les avantages (gain et sélectivité élevés et constants) et les inconvénients (complexité, présence de la fréquence image et d’autres fréquences parasites) de la conversion de fréquence sont synthétisés.
9.4. La réjection de la fréquence image
La capacité de l’étage d’entrée RF à atténuer la fréquence image est un critère de qualité majeur pour un récepteur. L’élève comprendra que plus la fréquence intermédiaire est élevée, plus la fréquence image est éloignée et plus elle est facile à rejeter.
CHAPITRE 10 : L’AMPLIFICATEUR À FRÉQUENCE INTERMÉDIAIRE (FI)
10.1. Rôle de la chaîne FI
La chaîne d’amplification à fréquence intermédiaire est le cœur du récepteur. C’est elle qui fournit l’essentiel du gain (puisque la FI est constante) et surtout l’essentiel de la sélectivité, c’est-à-dire la capacité du récepteur à séparer la station désirée des stations adjacentes.
10.2. Les filtres FI
Pour obtenir une sélectivité élevée (une bande passante très étroite), on utilise des filtres très performants. L’élève découvrira les technologies utilisées : les transformateurs FI accordés, et surtout les filtres céramiques ou à quartz qui offrent des flancs de coupure extrêmement raides.
10.3. Les étages amplificateurs FI
Les amplificateurs FI sont des amplificateurs accordés à bande étroite, optimisés pour fonctionner à la fréquence intermédiaire (par exemple, 455 kHz pour la radio AM). Ils sont conçus pour fournir un gain élevé et stable.
10.4. La courbe de réponse globale
La courbe de réponse de la chaîne FI, en forme de « cloche » très étroite, détermine la sélectivité globale du récepteur. L’élève apprendra à interpréter cette courbe et à comprendre son impact sur la qualité de la réception.
CHAPITRE 11 : LA COMMANDE AUTOMATIQUE DE GAIN (CAG)
11.1. Le problème des variations de niveau
Le niveau des signaux reçus à l’antenne peut varier dans des proportions énormes, selon que la station est proche ou lointaine. Sans correction, une station forte saturerait le récepteur, tandis qu’une station faible serait inaudible.
11.2. Le principe de la CAG
La Commande Automatique de Gain (ou AGC en anglais) est une boucle de contre-réaction qui maintient le niveau du signal à la sortie de la chaîne FI à une valeur quasi constante. Elle détecte le niveau moyen du signal et génère une tension de commande continue.
11.3. Le schéma de principe de la CAG
Le schéma de la boucle de CAG est analysé. La tension de commande est appliquée aux étages amplificateurs RF et FI pour réduire leur gain lorsque le signal reçu est fort, et l’augmenter lorsqu’il est faible.
11.4. Effets de la CAG sur la réception
L’élève comprendra que la CAG assure un confort d’écoute en maintenant un volume sonore constant lors d’un balayage des stations ou lors des évanouissements du signal. C’est une fonction indispensable dans tout récepteur moderne.
Annexes
1. Mémento des Blocs Fonctionnels du Récepteur Superhétérodyne
Cette section fournirait un schéma bloc détaillé et commenté du récepteur superhétérodyne. Pour chaque bloc (Ampli RF, Mélangeur, OL, Ampli FI, Détecteur, CAG, Ampli BF), sa fonction principale, les signaux d’entrée et de sortie typiques et les composants clés seraient résumés.
2. Tableau des Bandes de Radiodiffusion et Fréquences Intermédiaires
Un tableau récapitulerait les gammes de fréquences allouées à la radiodiffusion AM (GO, PO, OC) et FM, ainsi que les valeurs de fréquences intermédiaires standardisées au niveau international (par exemple, 455 kHz pour l’AM, 10.7 MHz pour la FM).
3. Guide sur les Filtres Électroniques
Un guide visuel présenterait les schémas de base et les courbes de réponse des quatre grands types de filtres (passe-bas, passe-haut, passe-bande, coupe-bande). Ce rappel est essentiel pour comprendre les circuits d’accord et les filtres FI.
4. Introduction aux Facteurs de Qualité (Q) et de Bruit (NF)
Ce complément (enrichissement) introduirait deux notions fondamentales en RF. Le facteur de qualité (Q) d’un circuit accordé, qui mesure sa sélectivité, et le facteur de bruit (NF) d’un amplificateur, qui quantifie sa capacité à ne pas dégrader un signal faible. Ces deux paramètres sont les indicateurs clés de la performance d’un récepteur.



