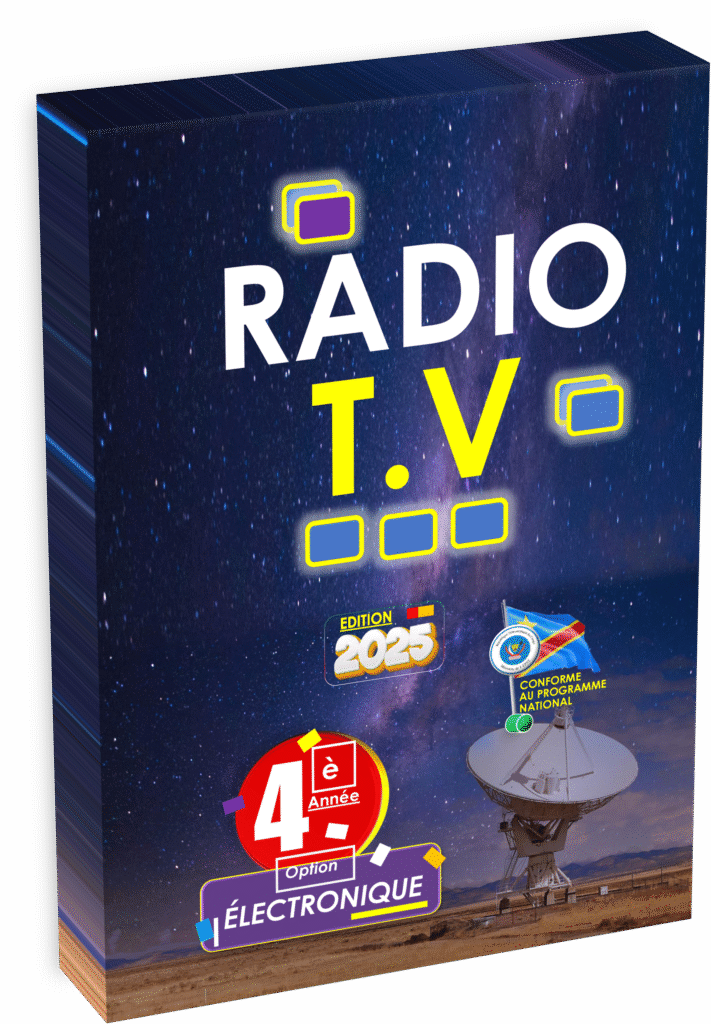
RADIO TV
4ÈME ANNÉE – OPTION ÉLECTRONIQUE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
Préliminaires
1. Objectifs Généraux du Cours
Ce manuel a pour objectif de fournir à l’élève une compréhension systémique et approfondie des principes de la télévision analogique et une introduction à sa contrepartie numérique. Le cours décompose la chaîne de télévision, de la formation du signal vidéo à sa restitution sur un écran, en analysant en détail chaque bloc fonctionnel du récepteur. La finalité est de former un technicien de haut niveau, capable de diagnostiquer, de dépanner et de maintenir des équipements de réception télévisuelle, en maîtrisant la complexité des signaux vidéo et des circuits de traitement associés.
2. Compétences Visées
Au terme de cette année de formation, l’élève détiendra la capacité de :
- Expliquer le principe du balayage entrelacé et décrire la structure d’un signal vidéo composite monochrome et couleur.
- Identifier les différents standards de télévision (PAL, SECAM, NTSC) et leurs spécificités.
- Analyser le schéma bloc d’un récepteur de télévision et justifier le rôle de chaque étage (tuner, FI, détection, synchronisation, balayage).
- Expliquer le principe de fonctionnement des bases de temps horizontale et verticale et le mécanisme de génération de la très haute tension.
- Comprendre les principes de la restitution d’une image couleur sur un tube cathodique et les fondements de la télévision numérique.
3. Approche Pédagogique
La démarche pédagogique est structurée autour du parcours du signal à travers le récepteur de télévision. Chaque grande partie du cours correspond à une étape majeure du traitement, depuis la réception haute fréquence jusqu’à la commande du dispositif d’affichage. L’approche est résolument systémique, montrant en permanence comment les différents blocs interagissent pour reconstituer l’image et le son. Des études de cas, comme l’analyse des pannes typiques d’un récepteur ou l’étude de la chaîne de diffusion de la Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC), permettent d’ancrer les connaissances dans une réalité technique et professionnelle concrète.
PREMIÈRE PARTIE : LES FONDEMENTS DU SIGNAL VIDÉO ET DE LA TÉLÉVISION COULEUR 🎨
Cette partie fondamentale se consacre à l’étude de la nature même du signal de télévision. Avant d’aborder l’électronique du récepteur, il est indispensable de comprendre comment une image fixe ou en mouvement peut être transformée en un signal électrique unidimensionnel. L’élève y découvrira les principes de l’analyse d’image, les astuces de la colorimétrie pour intégrer l’information de couleur de manière compatible avec le noir et blanc, et les différents standards qui ont régi le monde de la diffusion analogique.
CHAPITRE 1 : LE SIGNAL VIDÉO MONOCHROME ET L’ANALYSE D’IMAGE
1.1. Le principe de l’analyse séquentielle de l’image
Ce sous-chapitre explique le principe de base de la télévision : décomposer l’image en une succession de points (pixels) lus ligne par ligne, de gauche à droite et de haut en bas, pour la transformer en un signal électrique dont l’amplitude varie en fonction de la luminosité de chaque point.
1.2. Le balayage entrelacé
Pour réduire le scintillement de l’image tout en limitant la bande passante, la technique du balayage entrelacé est utilisée. L’élève apprendra comment l’image est décomposée en deux trames successives (lignes paires puis lignes impaires), un concept fondamental des standards analogiques.
1.3. Les signaux de synchronisation
Pour que le récepteur puisse reconstruire l’image correctement, le signal vidéo doit contenir des « instructions » de synchronisation. Les impulsions de synchronisation de ligne et de trame, qui indiquent la fin de chaque ligne et de chaque trame, sont décrites.
1.4. Structure du signal vidéo monochrome composite
Le signal vidéo composite est présenté comme la somme du signal de luminance (l’information d’image) et des signaux de synchronisation. L’élève apprendra à tracer la forme d’onde complète d’une ligne de signal vidéo, en identifiant les différents niveaux (noir, blanc, tops de synchro).
CHAPITRE 2 : LA COLORIMÉTRIE : LUMINANCE, CHROMINANCE ET SYSTÈMES DE COULEURS
2.1. La synthèse additive des couleurs (RVB)
Le principe de la restitution des couleurs par synthèse additive des trois couleurs primaires (Rouge, Vert, Bleu) est expliqué. Le modèle RVB est présenté comme le standard pour la captation et l’affichage des images couleur.
2.2. Luminance et Chrominance
Pour assurer la compatibilité avec les récepteurs monochromes, l’information de couleur n’est pas transmise en RVB. L’élève découvrira comment le signal RVB est transformé en un signal de luminance (Y), qui représente l’intensité lumineuse (le noir et blanc), et deux signaux de chrominance, qui portent l’information de couleur (teinte et saturation).
2.3. La sous-porteuse couleur
L’information de chrominance est modulée sur une sous-porteuse haute fréquence qui vient s’insérer dans le spectre du signal de luminance. Ce principe ingénieux permet de transmettre la couleur « par-dessus » le signal noir et blanc sans perturber les anciens récepteurs.
2.4. Teinte, saturation et luminance
Les trois attributs perceptuels de la couleur sont définis. La teinte correspond à la couleur elle-même (rouge, vert, bleu). La saturation correspond à l’intensité de la couleur (d’un rose pâle à un rouge vif). La luminance correspond à sa brillance. L’élève comprendra comment ces attributs sont codés dans les signaux de chrominance.
CHAPITRE 3 : LES STANDARDS DE DIFFUSION ANALOGIQUE (PAL, SECAM, NTSC)
3.1. Les contraintes de la transmission couleur
La transmission de l’information de chrominance est délicate et sensible aux distorsions. Les trois grands standards mondiaux sont présentés comme trois solutions techniques différentes pour moduler et transmettre la chrominance de la manière la plus robuste possible.
3.2. Le standard NTSC
Le standard NTSC (National Television System Committee), utilisé en Amérique du Nord et au Japon, est le plus ancien. Son principe, basé sur une modulation d’amplitude en quadrature de la sous-porteuse couleur, est expliqué. Sa sensibilité aux erreurs de phase, qui se traduit par des variations de teinte, est son principal défaut.
3.3. Le standard PAL
Le standard PAL (Phase Alternation Line), utilisé en Europe de l’Ouest et en RDC, est présenté comme une amélioration du NTSC. L’élève apprendra comment l’inversion de la phase d’un des signaux de chrominance une ligne sur deux permet de compenser automatiquement les erreurs de phase, garantissant une grande stabilité des couleurs.
3.4. Le standard SECAM
Le standard SECAM (Séquentiel Couleur À Mémoire), utilisé en France et en Russie, adopte une approche différente. Il transmet les deux informations de chrominance séquentiellement, une ligne après l’autre, en utilisant une modulation de fréquence. Sa robustesse face aux distorsions de transmission est son principal atout.
CHAPITRE 4 : LE SIGNAL VIDÉO COMPOSITE ET LA CHAÎNE DE TRANSMISSION
4.1. Spectre du signal vidéo couleur
Le spectre du signal vidéo composite couleur est analysé. Il montre comment le spectre de la chrominance (centré sur la sous-porteuse) s’imbrique dans le spectre de la luminance, en occupant les « trous » de ce dernier.
4.2. La salve de synchronisation couleur (« burst »)
Pour que le récepteur puisse démoduler correctement la chrominance, il doit connaître la fréquence et la phase exactes de la sous-porteuse. L’élève découvrira la salve (« burst »), un court échantillon de la sous-porteuse inséré au début de chaque ligne, qui sert de référence de synchronisation.
4.3. Le schéma bloc de la chaîne de transmission
Le schéma synoptique d’un émetteur de télévision est présenté. Il montre les étapes de la création du signal vidéo composite, la modulation du son, et la modulation de l’image sur la porteuse RF principale (modulation d’amplitude à bande latérale résiduelle).
4.4. Le schéma bloc des récepteurs
En miroir, les schémas blocs généraux des récepteurs monochromes et couleurs sont présentés. L’élève comparera les deux architectures et identifiera les blocs supplémentaires nécessaires à la réception couleur : le décodeur de chrominance et les circuits de traitement des signaux couleur.
DEUXIÈME PARTIE : LA CHAÎNE DE RÉCEPTION RF ET FRÉQUENCE INTERMÉDIAIRE 📡
Cette partie se concentre sur les premiers étages du récepteur de télévision, qui ont pour mission de capter le signal radiofréquence (RF) très faible venu de l’antenne, de sélectionner le canal désiré et de le transposer en un signal à fréquence intermédiaire (FI) plus facile à traiter. L’élève y appliquera les principes du récepteur superhétérodyne, déjà étudiés en radio, aux contraintes spécifiques et bien plus exigeantes de la réception télévisuelle.
CHAPITRE 5 : LE SÉLECTEUR DE CANAUX (TUNER)
5.1. Le rôle du sélecteur de canaux
Le tuner est le « front-end » du récepteur. Ses trois rôles sont expliqués : amplifier le signal RF reçu avec un très faible bruit, sélectionner le canal désiré parmi tous ceux qui sont captés par l’antenne, et transposer sa fréquence en fréquence intermédiaire.
5.2. L’amplificateur RF
L’amplificateur RF d’entrée est un étage critique. Il doit fournir un gain suffisant tout en générant un minimum de bruit propre pour garantir une bonne réception des signaux faibles, une condition essentielle dans les zones rurales éloignées des émetteurs, comme dans la province de la Tshopo.
5.3. L’oscillateur local et le mélangeur
L’élève étudiera le fonctionnement de l’oscillateur local, dont la fréquence est commandée pour sélectionner le canal, et du mélangeur, qui effectue la transposition de fréquence vers la FI.
5.4. Les technologies de tuners
Les différentes technologies de tuners sont décrites, depuis les anciens tuners mécaniques à commutateur rotatif jusqu’aux tuners électroniques modernes utilisant des diodes Varicap et des synthétiseurs de fréquence à PLL.
CHAPITRE 6 : L’AMPLIFICATEUR À FRÉQUENCE INTERMÉDIAIRE (FI) VIDÉO
6.1. Le rôle de l’amplificateur FI
La chaîne d’amplification FI est le cœur du récepteur en termes de gain et de sélectivité. Elle fournit l’essentiel de l’amplification du signal (plus de 100 dB) à une fréquence fixe (la FI).
6.2. La courbe de réponse de la chaîne FI
La forme de la courbe de réponse de la chaîne FI est étudiée en détail. Sa forme de « trapèze » est spécifique à la télévision pour accommoder la modulation à bande latérale résiduelle et positionner correctement les porteuses image et son.
6.3. La détermination du nombre d’étages
Pour atteindre le gain très élevé requis, la chaîne FI est constituée de plusieurs étages amplificateurs en cascade. L’élève apprendra les principes qui guident la répartition du gain entre ces différents étages.
6.4. La Commande Automatique de Gain (CAG)
La CAG est un circuit de contre-réaction qui ajuste le gain du tuner et de la chaîne FI pour maintenir un niveau de signal constant à l’entrée du démodulateur, quel que soit le niveau du signal reçu. Son rôle est crucial pour obtenir une image stable.
CHAPITRE 7 : LA DÉTECTION VIDÉO ET LA CHAÎNE SON
7.1. Le principe de la détection vidéo
La détection (ou démodulation) vidéo a pour but d’extraire le signal vidéo composite de la porteuse à fréquence intermédiaire. Le détecteur d’enveloppe à diode est la technique la plus simple et la plus utilisée.
7.2. L’amortissement et les circuits de correction
Les circuits de détection peuvent introduire des distorsions. Les circuits de correction, qui améliorent la réponse en fréquence et la réponse aux signaux transitoires (détails fins de l’image), sont analysés.
7.3. La récupération du son inter-porteuse
Le signal sonore est également présent à la sortie du détecteur vidéo, sous la forme d’un signal modulé en fréquence à la fréquence de l’inter-porteuse (différence entre les porteuses image et son, par exemple 5.5 MHz pour le standard PAL).
7.4. La chaîne de traitement du son
À partir de ce signal inter-porteuse, une chaîne de réception FM complète est nécessaire. L’élève identifiera ses blocs : un amplificateur FI son, un démodulateur FM (discriminateur), un désaccentuateur et un amplificateur audio de puissance qui pilote le haut-parleur.
TROISIÈME PARTIE : LE TRAITEMENT DU SIGNAL VIDÉO ET LA SYNCHRONISATION 🖼️
Une fois le signal vidéo composite extrait de la porteuse, le travail du récepteur est loin d’être terminé. Cette partie se concentre sur les étapes de traitement qui séparent les différentes composantes du signal (luminance, chrominance, synchro) et les utilisent pour reconstruire l’image. L’élève y découvrira les circuits qui amplifient l’image, extraient le « timing » de la synchronisation et génèrent les signaux de balayage qui vont piloter le tube cathodique.
CHAPITRE 8 : L’AMPLIFICATEUR VIDÉO ET LES CIRCUITS DE CORRECTION
8.1. Rôle et contraintes de l’amplificateur vidéo
L’amplificateur vidéo (ou amplificateur de luminance) est le dernier étage avant le tube cathodique. Il doit avoir une très large bande passante (du DC à plusieurs MHz) pour amplifier fidèlement tous les détails de l’image, des zones uniformes aux contours les plus fins.
8.2. Les commandes utilisateur (luminosité, contraste)
Les réglages de luminosité et de contraste agissent sur l’amplificateur vidéo. L’élève apprendra que la luminosité contrôle le niveau de continu (le « noir » de l’image), tandis que le contraste ajuste le gain de l’amplificateur (l’écart entre le noir et le blanc).
8.3. Le décodeur couleur
Dans un récepteur couleur, l’amplificateur vidéo traite la luminance (Y). En parallèle, un décodeur de chrominance extrait les signaux de différence de couleur (R-Y et B-Y) de la sous-porteuse, en utilisant la salve « burst » comme référence.
8.4. La matrice de sortie
La dernière étape avant l’affichage est la re-combinaison des signaux. Une matrice (un réseau de résistances) combine la luminance (Y) et les signaux de différence de couleur (R-Y, B-Y) pour reconstituer les trois signaux primaires Rouge, Vert et Bleu qui vont piloter les canons du tube cathodique.
CHAPITRE 9 : LA SÉPARATION DES IMPULSIONS DE SYNCHRONISATION
9.1. L’utilité de l’étage séparateur
Le circuit séparateur de synchronisation a pour rôle crucial d’extraire les impulsions de synchronisation (ligne et trame) du signal vidéo composite complet. Il fonctionne généralement comme un écrêteur qui ne laisse passer que la partie du signal située en dessous du niveau de noir.
9.2. Le principe de fonctionnement
Le fonctionnement du circuit, souvent basé sur un transistor en commutation, est analysé. Il exploite la différence d’amplitude entre le signal d’image et les tops de synchronisation.
9.3. Le tri des impulsions (intégrateur et dérivateur)
Une fois les impulsions de synchro isolées, il faut les trier pour distinguer les impulsions de ligne des impulsions de trame. L’élève découvrira comment un simple filtre passe-bas (intégrateur) permet d’extraire le signal de synchro trame, et un filtre passe-haut (dérivateur) permet d’isoler le signal de synchro ligne.
9.4. La Commande Automatique de Phase (CAP)
Pour assurer une parfaite stabilité horizontale de l’image, l’oscillateur de balayage horizontal est asservi aux impulsions de synchro ligne reçues via une boucle à verrouillage de phase (PLL), appelée ici Commande Automatique de Phase (CAP ou AFC en anglais).
CHAPITRE 10 : LES BASES DE TEMPS : L’OSCILLATEUR DE BALAYAGE HORIZONTAL
10.1. L’utilité des bases de temps
Les bases de temps sont les circuits qui génèrent les courants en dents de scie nécessaires pour piloter les bobines de déviation du tube cathodique et ainsi réaliser le balayage de l’image.
10.2. L’oscillateur de ligne
L’oscillateur de ligne génère un signal à la fréquence de balayage horizontal (par exemple, 15625 Hz pour le standard PAL). Son principe de fonctionnement est décrit, ainsi que son asservissement par la boucle de commande automatique de phase.
10.3. L’étage de puissance horizontal
Le signal de l’oscillateur pilote un puissant transistor de commutation qui contrôle le courant dans les bobines de déviation horizontale. Ce circuit fonctionne en régime de commutation et doit gérer des tensions et des courants très élevés.
10.4. Identification et description des composants
L’élève apprendra à identifier sur un schéma les composants clés de l’étage de balayage horizontal : l’oscillateur, le transistor de puissance, le transformateur THT (Très Haute Tension) et les bobines de déviation (déflecteur).
CHAPITRE 11 : LES BASES DE TEMPS : L’OSCILLATEUR DE BALAYAGE VERTICAL
11.1. L’oscillateur de trame
L’oscillateur de trame génère un signal à la fréquence de balayage vertical (50 Hz ou 60 Hz). Il est synchronisé directement par les impulsions de synchro trame issues du circuit intégrateur.
11.2. L’étage de puissance vertical
L’amplificateur de puissance vertical est généralement un amplificateur linéaire fonctionnant en classe AB, car la fréquence de balayage est beaucoup plus faible que pour l’horizontal. Son rôle est de fournir le courant en dent de scie aux bobines de déviation verticale.
11.3. Les réglages de géométrie
Les réglages de hauteur, de linéarité verticale et de centrage vertical agissent sur l’oscillateur et l’amplificateur de trame pour ajuster la géométrie de l’image sur l’écran.
11.4. Comparaison des bases de temps horizontale et verticale
Ce sous-chapitre synthétise les différences fondamentales entre les deux chaînes de balayage : la fréquence, le type de fonctionnement de l’étage de puissance (commutation vs linéaire), et l’énergie mise en jeu, beaucoup plus importante pour le balayage horizontal.
QUATRIÈME PARTIE : LA RESTITUTION DE L’IMAGE ET LES SYSTÈMES MODERNES 🖥️
Cette dernière partie se consacre à l’étape finale : la conversion du signal vidéo électrique en une image lumineuse visible. L’étude se concentre sur la technologie du tube à rayons cathodiques, qui a régné sur la télévision pendant des décennies. Les circuits annexes qui assurent son bon fonctionnement, comme la génération de la très haute tension, sont également analysés. Enfin, une ouverture vers les technologies numériques est proposée pour préparer l’élève aux réalités de la télévision contemporaine.
CHAPITRE 12 : LA TRÈS HAUTE TENSION (THT) ET LA RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE
12.1. La nécessité de la Très Haute Tension
Pour accélérer suffisamment le faisceau d’électrons afin qu’il produise un point lumineux sur l’écran, une tension très élevée (de 15 à 30 kilovolts) est nécessaire. Le besoin de cette THT est justifié.
12.2. La production de la THT par le transformateur de ligne
La THT est générée par l’étage de balayage horizontal. L’élève apprendra que le transformateur de sortie de cet étage (« transformateur de ligne » ou « flyback ») possède un enroulement secondaire à très grand nombre de spires qui, associé à une diode et un condensateur, produit la THT.
12.3. Le principe de la récupération d’énergie
Pendant le retour du spot, l’énergie magnétique stockée dans les bobines de déviation doit être évacuée. Le principe de la récupération d’énergie consiste à utiliser cette énergie, via une diode de récupération, pour contribuer à l’alimentation de l’étage de puissance horizontal, améliorant ainsi considérablement son rendement.
12.4. Les tensions annexes
Le transformateur de ligne est une véritable centrale électrique miniature. En plus de la THT, il fournit de nombreuses autres tensions continues et alternatives nécessaires au fonctionnement de divers étages du téléviseur (tensions pour les amplificateurs vidéo, tension de chauffage du filament du tube, etc.).
CHAPITRE 13 : LE TUBE À RAYONS CATHODIQUES (TRC) COULEUR
13.1. Le canon à électrons et la focalisation
La structure du tube cathodique (ou TRC, ou CRT en anglais) est décrite : une ampoule en verre sous vide, contenant un canon à électrons qui génère, accélère et focalise le faisceau.
13.2. Le principe de l’affichage couleur
Le tube cathodique couleur utilise trois canons à électrons (un pour le rouge, un pour le vert, un pour le bleu). L’écran est recouvert de triplets de luminophores des trois couleurs primaires.
13.3. Le masque perforé
Juste derrière l’écran se trouve une fine grille métallique percée de centaines de milliers de trous, appelée masque perforé (ou « shadow mask »). Son rôle crucial est de guider chaque faisceau d’électrons pour qu’il ne frappe que les luminophores de la couleur correspondante.
13.4. Les circuits de convergence
Pour que les trois faisceaux convergent en un seul point sur l’écran et que les couleurs se superposent correctement, des bobines de convergence créent des champs magnétiques de correction. Les réglages de pureté et de convergence sont expliqués.
CHAPITRE 14 : INTRODUCTION À LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE (TNT)
14.1. Les avantages du numérique
Les raisons du passage à la télévision numérique sont expliquées : une qualité d’image et de son parfaite et constante, la possibilité de diffuser plus de chaînes dans le même canal (multiplexage), et l’ajout de services interactifs (guide des programmes).
14.2. La compression numérique (MPEG)
Pour pouvoir diffuser un signal TV numérique, il faut en réduire drastiquement le débit. Le principe de la compression MPEG (Moving Picture Experts Group) est introduit, qui élimine les redondances spatiales et temporelles de l’image.
14.3. La modulation numérique (OFDM)
La modulation utilisée pour la TNT, l’OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing), est présentée. C’est une technique multi-porteuses très robuste face aux échos et aux interférences, particulièrement adaptée à la diffusion terrestre dans des environnements urbains comme celui de Kinshasa.
14.4. Le schéma bloc d’un récepteur TNT
Le schéma synoptique d’un adaptateur TNT est analysé. L’élève identifiera les nouveaux blocs par rapport à un récepteur analogique : le démodulateur OFDM, le démultiplexeur, les décodeurs vidéo (MPEG) et audio, qui remplacent toute la chaîne de traitement analogique.
Annexes
1. Mémento des Signaux Vidéo et TV
Cette section fournirait une synthèse visuelle des formes d’ondes clés étudiées : une ligne de signal vidéo monochrome, une ligne de signal couleur avec le « burst », les signaux de synchronisation ligne et trame, et les signaux en dents de scie des bases de temps.
2. Tableau Comparatif des Standards TV Analogiques
Un tableau synthétique comparerait les caractéristiques principales des standards NTSC, PAL et SECAM : nombre de lignes, fréquence trame, fréquence ligne, fréquence de la sous-porteuse couleur et méthode de modulation de la chrominance.
3. Guide de Dépannage Basé sur l’Image
Un guide pratique illustrerait comment analyser les défauts visibles à l’écran (pas d’image, perte de synchronisation, défaut de géométrie, couleurs anormales) pour les relier à une panne dans un bloc fonctionnel spécifique du récepteur, une compétence essentielle pour le technicien de maintenance.
4. Le Passage à la Télévision Numérique Terrestre (TNT) en RDC
Ce complément (enrichissement) expliquerait les raisons du passage au numérique (meilleure qualité d’image et de son, plus de chaînes) et introduirait les grands principes de la TNT. Le schéma bloc d’un décodeur TNT serait présenté, en mettant en évidence les nouveaux blocs : démodulation numérique (QAM/OFDM) et décompression vidéo (MPEG).