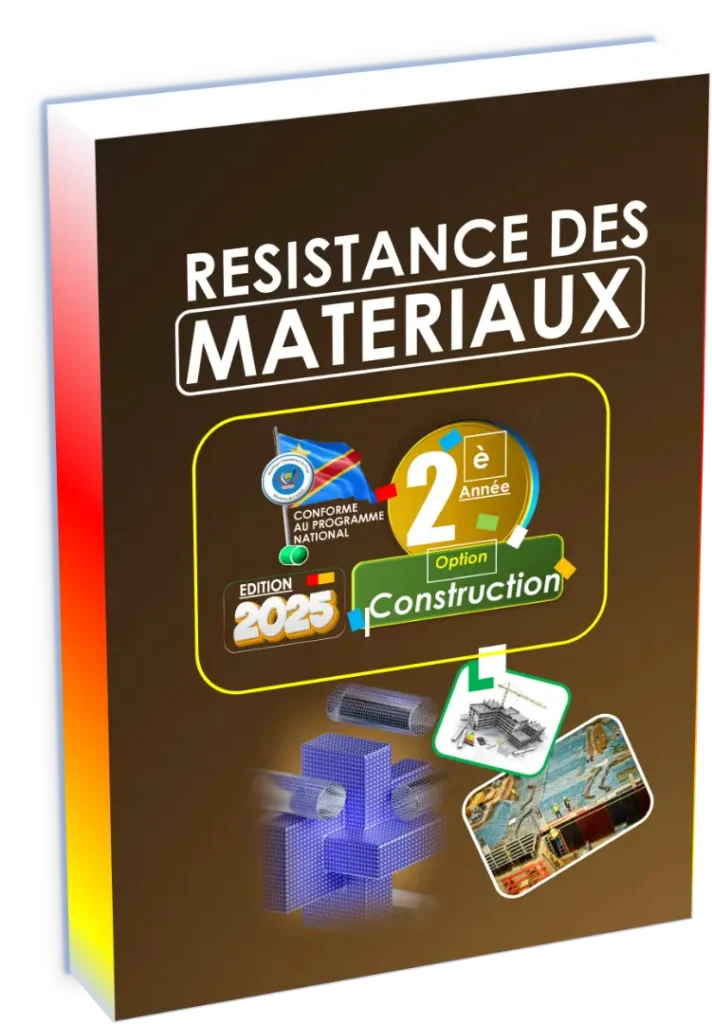
RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX
OPTION CONSTRUCTION – 2ÈME ANNÉE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
Préliminaire
Objectifs du cours
Ce cours fondamental a pour objectif de doter le futur technicien des outils d’analyse et de calcul lui permettant de comprendre comment les matériaux résistent aux forces qui leur sont appliquées. Succédant aux méthodes graphiques, cette approche analytique apporte la précision et la rigueur du calcul à l’étude de l’équilibre (Statique) et au dimensionnement des éléments de structure (Résistance des Matériaux). La finalité est de former un professionnel capable de vérifier la stabilité et de déterminer les dimensions nécessaires des pièces simples d’un ouvrage pour qu’elles assurent leur fonction en toute sécurité. ⚖️
Approche Pédagogique
L’enseignement s’articulera en deux temps forts, conformément à la logique de l’ingénieur. La première partie, la Statique Analytique, sera dédiée à la détermination des efforts externes (réactions d’appui) et internes (normaux, tranchants, moments) par le calcul. La seconde partie, la Résistance des Matériaux, utilisera ces efforts pour calculer les contraintes dans la matière et dimensionner les sections. Une corrélation permanente sera établie avec le cours de Graphostatique, démontrant comment les deux approches, graphique et analytique, se complètent et permettent une vérification mutuelle, forgeant ainsi le jugement critique de l’élève.
Compétences Visées
Au terme de cette année, l’élève détiendra les compétences suivantes :
- Modéliser : Isoler un système mécanique, réaliser le bilan des actions extérieures et le traduire en équations d’équilibre.
- Calculer : Déterminer analytiquement les réactions d’appui et les efforts internes dans les poutres isostatiques simples.
- Analyser : Comprendre le comportement des matériaux sous l’effet des sollicitations de base (traction, compression, cisaillement) à travers la relation contrainte-déformation.
- Dimensionner : Appliquer les formules fondamentales de la résistance des matériaux pour déterminer la section requise d’un élément de structure soumis à une sollicitation simple, en respectant les coefficients de sécurité.
Modalités d’Évaluation
L’évaluation portera sur la capacité de l’élève à modéliser et à résoudre des problèmes de statique et de RDM. Elle comprendra des interrogations écrites et des devoirs à domicile axés sur la résolution d’exercices numériques. Une attention particulière sera accordée à la rigueur de la démarche, à la justification des hypothèses et à la correction des unités. Un examen final de synthèse évaluera la capacité à mener une analyse complète : du calcul des efforts par la statique au dimensionnement de la pièce par la RDM. 📝
Partie I : Statique Analytique – Les Fondements de l’Équilibre
Cette partie se consacre à l’étude des conditions d’équilibre des corps solides par des méthodes purement calculatoires. Elle établit les principes et les outils mathématiques nécessaires pour déterminer les forces inconnues, qu’il s’agisse des réactions exercées par les appuis sur une structure ou des efforts internes qui naissent au sein même de la matière.
Chapitre 1 : Principes et Modélisation des Forces
Avant tout calcul, une modélisation correcte du problème est indispensable. Ce chapitre pose les bases conceptuelles et les conventions qui permettent de traduire un problème physique en un système d’équations mathématiques.
1.1. Le Concept d’Équilibre en Construction
La quasi-totalité des ouvrages de génie civil, des ponts sur le fleuve Congo aux immeubles de Lubumbashi, sont des systèmes en équilibre. Ce principe fondamental, qui veut que toute action entraîne une réaction égale et opposée, est le point de départ de toute l’analyse.
1.2. La Modélisation d’une Action par un Vecteur Force
Toute action mécanique (poids, poussée, contact) est modélisée par un vecteur force. La maîtrise de sa représentation et de ses caractéristiques est la première étape vers la mise en équation.
1.3. Les Principes Fondamentaux de la Statique
Quatre principes de base, incluant celui du parallélogramme des forces et celui de l’action-réaction, forment l’édifice axiomatique sur lequel reposent tous les développements de la statique.
1.4. Les Unités et Conventions de Signes
Une grande rigueur dans l’utilisation des unités du Système International (Newton, mètre) et l’adoption de conventions de signes claires pour les forces et les moments sont des conditions non négociables pour éviter les erreurs de calcul.
Chapitre 2 : L’Analyse des Forces Concourantes
L’étude de l’équilibre d’un point matériel, ou d’un point d’intersection de plusieurs barres, constitue le cas le plus simple de la statique. Il se résout par la condition que la somme vectorielle des forces appliquées soit nulle.
2.1. La Composition des Forces par le Calcul
Dépassant l’approche graphique, ce chapitre enseigne la détermination de la résultante d’un système de forces par le calcul, en utilisant les relations trigonométriques dans les triangles.
2.2. La Résolution Algébrique par Projection (ΣFx=0, ΣFy=0)
La méthode analytique la plus puissante consiste à projeter toutes les forces sur un système d’axes orthogonaux. L’équilibre du point se traduit alors par deux équations algébriques simples.
2.3. La Décomposition d’une Force selon Deux Axes
L’opération de projection, fondamentale pour la résolution, est étudiée en détail. Elle permet de quantifier l’effet d’une force oblique selon les directions horizontale et verticale.
2.4. Application au Calcul d’Efforts dans un Nœud de Treillis
Cette méthode trouve une application directe et très utile dans le calcul des efforts de traction ou de compression dans les barres d’une ferme de toiture simple convergeant en un même nœud.
Chapitre 3 : Le Moment d’une Force et l’Équilibre de Rotation
Pour qu’un corps solide soit en équilibre, il ne suffit pas que la somme des forces soit nulle ; il faut aussi que la somme des moments de ces forces, qui tendent à le faire tourner, soit nulle.
3.1. Le Moment d’une Force par Rapport à un Point
Le moment d’une force quantifie sa capacité à induire une rotation. Son calcul, comme le produit de la force par le bras de levier, est une opération fondamentale de la statique.
3.2. Le Théorème de Varignon
Ce théorème important, qui stipule que le moment de la résultante est égal à la somme des moments des composantes, offre un outil de calcul et de vérification puissant.
3.3. Le Moment d’un Couple et ses Effets
L’étude d’un couple de forces permet de comprendre son effet de rotation pure et de calculer son moment, une notion essentielle pour l’analyse des poutres en torsion ou en flexion.
3.4. Le Second Principe de l’Équilibre Statique (ΣM=0)
L’équilibre d’un corps solide est régi par ce second principe fondamental. Son application correcte, par le choix judicieux du point de rotation, est la clé pour résoudre la majorité des problèmes de statique.
Chapitre 4 : L’Application aux Poutres : Calcul des Réactions
L’application la plus courante de la statique en construction est la détermination des réactions d’appui d’une poutre, c’est-à-dire les forces que les supports exercent sur la poutre pour la maintenir en équilibre.
4.1. La Modélisation des Appuis (Simple, Articulé)
Avant tout calcul, il est crucial de modéliser correctement les liaisons de la poutre avec ses appuis. La distinction entre un appui simple (ou à rouleau) et un appui articulé (ou à rotule) est fondamentale.
4.2. L’Application Simultanée des Deux Principes d’Équilibre
La détermination des réactions d’une poutre isostatique se fait en écrivant que la somme des forces et la somme des moments sont simultanément nulles, ce qui fournit un système d’équations à résoudre.
4.3. Le Calcul des Réactions pour des Charges Concentrées
La méthode est d’abord appliquée au cas de poutres soumises à une ou plusieurs forces ponctuelles, comme une poutre de plancher supportant des solives.
4.4. Le Calcul des Réactions pour des Charges Réparties
Pour les charges réparties (uniformes ou triangulaires), la méthode consiste à les remplacer par une force concentrée équivalente pour le calcul des réactions, avant de les considérer dans leur répartition réelle pour les efforts internes.
Partie II : Résistance des Matériaux – Le Comportement de la Matière
Une fois les efforts déterminés par la statique, la Résistance des Matériaux (RDM) prend le relais. Son but est d’étudier les effets de ces efforts à l’intérieur de la matière, en termes de contraintes et de déformations, afin de pouvoir dimensionner les pièces, c’est-à-dire leur donner des proportions suffisantes pour qu’elles résistent en toute sécurité.
Chapitre 5 : Les Sollicitations Internes : Le Principe de la Coupe
Pour comprendre ce qui se passe à l’intérieur d’une poutre ou d’un tirant, la RDM utilise une méthode intellectuelle fondamentale : le principe de la coupe.
5.1. Le Passage des Forces Extérieures aux Efforts Intérieurs
Par une coupure fictive, on isole une partie de la structure. L’équilibre de cette partie n’est possible que grâce à l’existence de forces de cohésion interne au niveau de la section coupée.
5.2. La Définition de l’Effort Normal (N)
La résultante des forces de cohésion perpendiculaires à la section coupée est appelée effort normal. Il tend à étirer la section (traction) ou à la raccourcir (compression).
5.3. La Définition de l’Effort Tranchant (T)
La résultante des forces de cohésion contenues dans le plan de la section est appelée effort tranchant. Il tend à faire glisser les deux parties de la section l’une par rapport à l’autre.
5.4. La Définition du Moment Fléchissant (M)
Le moment résultant des forces de cohésion par rapport au centre de gravité de la section est appelé moment fléchissant. Il tend à courber la poutre.
Chapitre 6 : La Traction et la Compression Simples
La sollicitation la plus simple est celle où seul l’effort normal (N) est non nul. Ce chapitre étudie le comportement des matériaux sous cette sollicitation et établit les règles de dimensionnement.
6.1. L’Essai de Traction et le Diagramme Contrainte-Déformation
L’essai de traction sur une éprouvette d’acier est fondamental. Il permet de tracer le diagramme contrainte-déformation, véritable carte d’identité mécanique du matériau, montrant son domaine élastique et son domaine plastique.
6.2. La Loi de Hooke et le Module d’Élasticité
Dans le domaine élastique, la contrainte est proportionnelle à la déformation. Cette relation, formalisée par la loi de Hooke, introduit une caractéristique essentielle du matériau : le module d’élasticité (ou module de Young).
6.3. La Notion de Contrainte et le Dimensionnement
La contrainte (σ = N/S) représente la force répartie sur l’unité de surface. Le dimensionnement consiste à donner à la section (S) une aire suffisante pour que cette contrainte reste inférieure à une valeur admissible, définie en fonction de la limite élastique et d’un coefficient de sécurité.
6.4. Application à la Compression des Éléments Courts
Pour les éléments courts et trapus (poteaux courts, semelles de fondation, murs de maçonnerie), les règles de dimensionnement en compression sont directement transposées de celles de la traction. C’est le cas pour la vérification de la pression sur le sol sous les fondations d’un bâtiment à Kananga.
Chapitre 7 : Le Cisaillement Simple
Cette sollicitation est générée par l’effort tranchant (T). Elle est fondamentale pour le calcul des assemblages par boulons, rivets ou goupilles.
7.1. Le Concept de Contrainte de Cisaillement (τ)
De manière analogue à la contrainte normale, la contrainte de cisaillement (τ = T/S) représente l’effort tranchant réparti sur l’aire de la section cisaillée.
7.2. Le Comportement des Matériaux au Cisaillement
La résistance au cisaillement d’un matériau est une caractéristique intrinsèque, généralement liée à sa résistance en traction. Les mécanismes de rupture par cisaillement sont analysés.
7.3. Le Dimensionnement des Boulons et des Rivets
L’application la plus directe du cisaillement est le calcul des assemblages. L’élève apprendra à déterminer le diamètre nécessaire d’un boulon pour qu’il résiste à l’effort tranchant qu’il doit transmettre, en distinguant le simple et le double cisaillement.
7.4. La Notion de Pression Diamétrale
En plus du cisaillement, un assemblage sollicite les pièces par contact localisé. La vérification à la pression diamétrale (ou au matage) est une étape complémentaire indispensable du calcul d’un assemblage.
Chapitre 8 : Les Caractéristiques Géométriques des Sections
La capacité d’une section à résister aux efforts, notamment à la flexion, ne dépend pas seulement de son aire, mais aussi de la manière dont la matière est répartie autour de son centre de gravité.
8.1. Le Centre de Gravité des Sections
La position du centre de gravité, point d’application de la résultante des contraintes normales de flexion, est la première caractéristique géométrique à déterminer pour toute section.
8.2. Le Moment Statique
Le moment statique d’une partie de la section par rapport à un axe est une grandeur qui intervient dans le calcul des contraintes de cisaillement dues à la flexion.
8.3. Le Moment d’Inertie (Moment Quadratique)
Caractéristique géométrique fondamentale, le moment d’inertie (I) quantifie la résistance d’une section à la déformation par flexion. Plus il est grand, plus la section est rigide.
8.4. Le Module de Flexion
Le module de flexion (W = I/v), qui combine le moment d’inertie et la position des fibres les plus éloignées, est le paramètre qui relie directement le moment fléchissant à la contrainte maximale dans la section.
Chapitre 9 : Synthèse et Dimensionnement d’une Structure Simple
Ce chapitre final vise à intégrer l’ensemble des connaissances acquises en Statique et en RDM pour mener à bien l’analyse et le dimensionnement complet d’une petite structure de génie civil.
9.1. L’Analyse Complète d’une Petite Potence de Levage
Une structure simple, comme une potence fixée à un mur et supportant une charge, servira de fil rouge. Elle permet de mettre en jeu toutes les sollicitations étudiées.
9.2. Étape 1 : Calcul Statique des Efforts
La première étape consiste à appliquer les principes de la statique pour calculer les réactions au niveau des appuis muraux, puis à déterminer les efforts de traction/compression dans le tirant et la jambe de force.
9.3. Étape 2 : Dimensionnement des Barres en Traction/Compression
Une fois les efforts normaux connus, la deuxième étape consiste à appliquer les formules de la RDM pour déterminer la section nécessaire du tirant (traction) et de la jambe de force (compression).
9.4. Étape 3 : Dimensionnement de l’Axe d’Articulation en Cisaillement
Enfin, l’axe qui relie les différents éléments de la potence est analysé. L’effort tranchant qu’il subit est calculé, et son diamètre est déterminé pour qu’il résiste au cisaillement.
Annexes
Formulaire de Statique et de RDM
Un recueil des formules essentielles (principes d’équilibre, calcul des moments, contraintes, etc.) sera fourni pour faciliter la résolution des exercices. 🧾
Propriétés des Matériaux Courants
Un tableau synthétique donnera les valeurs usuelles des caractéristiques mécaniques (module d’élasticité, limite élastique) pour les principaux matériaux de construction (acier, bois, aluminium).
Caractéristiques des Profilés Métalliques
Des extraits de catalogues de profilés métalliques (IPE, HEA) seront fournis, donnant pour chaque section son aire, la position de son centre de gravité et ses moments d’inertie.
Guide de Modélisation des Structures
Une fiche méthodologique rappellera les étapes clés pour la modélisation d’un problème de RDM : choix du système à isoler, bilan des actions extérieures, hypothèses simplificatrices et conventions. ✅



