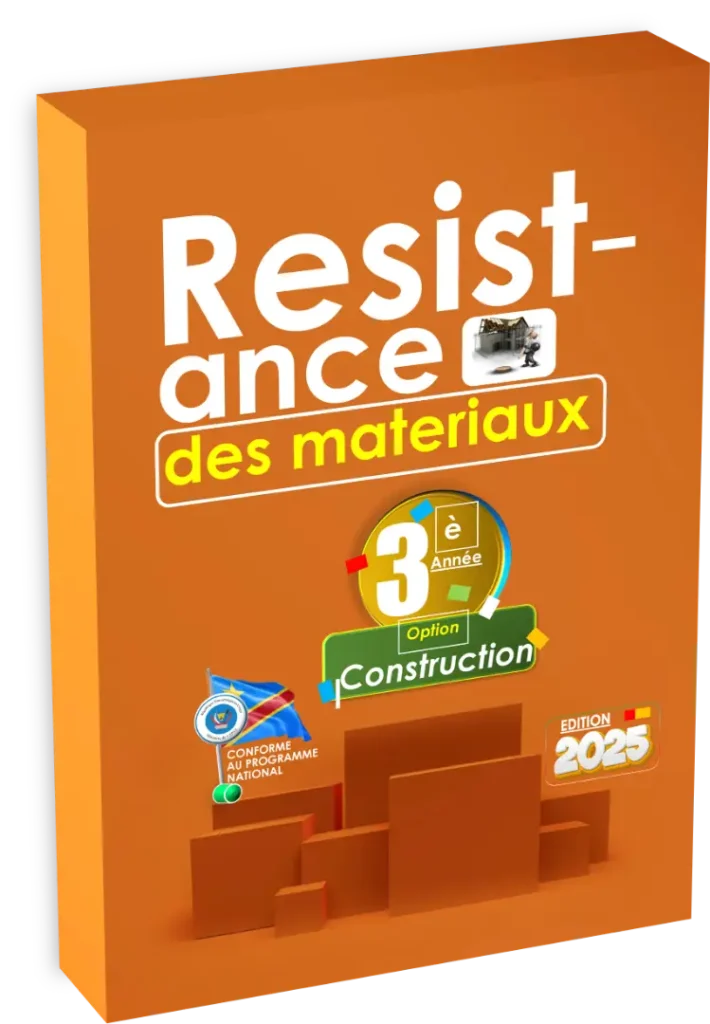
RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX
OPTION CONSTRUCTION – 3ÈME ANNÉE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
Préliminaire
Objectifs du cours
Ce cours de troisième année constitue le cœur de la formation du futur technicien en structures. Son objectif est de le rendre apte à résoudre l’ensemble des systèmes isostatiques par le calcul analytique, en lui fournissant les outils pour analyser les contraintes internes et dimensionner les éléments de construction. L’ambition est de forger une double compétence : la maîtrise des caractéristiques géométriques des sections, qui définissent leur aptitude à résister, et la capacité à appliquer les formules fondamentales de la RDM pour vérifier la sécurité des pièces sous des sollicitations simples et complexes. ⚖️
Approche Pédagogique
Privilégiant la rigueur du calcul et la compréhension physique des phénomènes, l’enseignement s’articulera autour de la résolution de problèmes concrets et motivants. Chaque nouvelle sollicitation (flexion, torsion, flambage) sera introduite par ses principes théoriques, puis immédiatement appliquée à travers de nombreux exercices de dimensionnement et de vérification. Une attention particulière sera portée à la maîtrise des unités et des ordres de grandeur, en encourageant systématiquement la comparaison des résultats analytiques avec ceux obtenus par les méthodes graphiques, afin de développer le sens critique et le jugement de l’ingénieur.
Compétences Visées
Au terme de cette année, l’élève détiendra les compétences suivantes :
- Caractériser : Calculer les propriétés géométriques fondamentales de n’importe quelle section de construction (centre de gravité, moment d’inertie, module de flexion).
- Analyser : Déterminer la nature et l’intensité des contraintes (normales et de cisaillement) dans une section soumise aux sollicitations de flexion, de torsion et d’effort tranchant.
- Dimensionner : Choisir la section appropriée pour une poutre, un poteau ou un arbre de transmission en s’assurant que les contraintes maximales restent inférieures aux limites admissibles du matériau.
- Vérifier : Mener une analyse de la stabilité au flambage pour les éléments comprimés et introduire les notions de calcul pour les sollicitations composées.
Modalités d’Évaluation
L’évaluation sera axée sur la capacité à modéliser et à résoudre des problèmes de RDM. Elle se composera d’interrogations écrites et de devoirs à domicile nécessitant la mise en œuvre des formules de calcul pour le dimensionnement et la vérification de structures. Un projet final de synthèse, portant sur l’analyse complète d’un élément de structure d’un bâtiment réel, comme un plancher à Bukavu ou une charpente à Matadi, permettra de valider l’intégration de l’ensemble des compétences de l’année. 📝
Partie I : Les Caractéristiques Géométriques des Sections
Cette partie se consacre à l’étude de « l’anatomie » des poutres et des poteaux. La capacité d’une pièce à résister aux efforts ne dépend pas seulement de sa surface, mais surtout de la manière dont la matière est répartie dans l’espace. La maîtrise du calcul des caractéristiques géométriques est donc un prérequis indispensable à toute analyse de résistance.
Chapitre 1 : Le Centre de Gravité des Sections Planes
Point d’équilibre géométrique d’une surface, le centre de gravité est la première caractéristique à déterminer, car il constitue l’origine de référence pour tous les autres calculs.
1.1. Le Rôle du Centre de Gravité en RDM
La position du centre de gravité, ou centroïde, est fondamentale car elle coïncide avec la ligne de la fibre neutre en flexion simple, l’axe autour duquel la section pivote.
1.2. La Détermination Analytique pour les Surfaces Usuelles
Le calcul de la position du centre de gravité pour les formes géométriques de base (rectangle, triangle, cercle, demi-cercle) est revu et maîtrisé à l’aide des formules standard.
1.3. La Méthode des Moments Statiques pour les Sections Composées
Pour une section complexe, la méthode consiste à la décomposer en figures simples et à appliquer le théorème de Varignon aux aires, en utilisant la notion de moment statique.
1.4. Application aux Profilés de Construction Courants
La méthode est appliquée au calcul du centre de gravité des profilés métalliques courants (en T, en U, cornières), en comparant les résultats avec les valeurs données dans les catalogues de produits sidérurgiques.
Chapitre 2 : Le Moment d’Inertie
Le moment d’inertie, ou moment quadratique, est la caractéristique géométrique qui quantifie l’opposition d’une section à la flexion. C’est le paramètre clé de la rigidité.
2.1. Définition du Moment d’Inertie (Moment Quadratique)
Le concept de moment d’inertie est introduit comme la somme des produits des aires élémentaires par le carré de leur distance à un axe. Plus la matière est éloignée de l’axe, plus le moment d’inertie est grand.
2.2. Le Théorème de Huygens pour le Transport des Axes
Ce théorème fondamental, dit « des axes parallèles », permet de calculer le moment d’inertie d’une section par rapport à un axe quelconque, connaissant son moment d’inertie par rapport à son axe centroïdal.
2.3. Le Moment d’Inertie des Sections Simples et Composées
Les formules du moment d’inertie pour les sections rectangulaires et circulaires sont établies. Le théorème de Huygens est ensuite appliqué pour calculer le moment d’inertie de sections composées de plusieurs rectangles (profilés en I, en caisson).
2.4. L’Utilisation des Catalogues de Profilés Métalliques
Pour les profilés normalisés (IPE, HEA), les valeurs du moment d’inertie sont directement disponibles dans des tables. L’élève apprend à extraire et à utiliser correctement ces informations.
Chapitre 3 : Les Modules de Résistance et de Stabilité
À partir du moment d’inertie, d’autres grandeurs utiles au dimensionnement peuvent être définies, comme le module de flexion, qui lie directement le moment à la contrainte, et le rayon de giration, qui caractérise l’aptitude au flambage.
3.1. Le Moment d’Inertie Polaire
Utilisé pour les calculs de torsion, le moment d’inertie polaire quantifie la résistance de la section à la rotation autour d’un axe perpendiculaire à son plan.
3.2. Le Module de Flexion (Module d’Inertie)
Le module de flexion (W = I/v) est un paramètre extrêmement pratique qui combine la rigidité géométrique (I) et la dimension de la section (v). Il permet de simplifier la formule de calcul de la contrainte maximale de flexion.
3.3. Le Rayon de Giration
Le rayon de giration est une grandeur qui caractérise l’écartement moyen de la matière par rapport à un axe. Il est fondamental pour l’étude du flambage des pièces comprimées.
3.4. Les Axes et Moments d’Inertie Principaux
Pour les sections non symétriques (cornières), il existe une paire d’axes orthogonaux, dits « axes principaux », pour lesquels les moments d’inertie sont maximal et minimal. Leur détermination est introduite.
Partie II : L’Analyse des Contraintes et le Dimensionnement
Forte de la maîtrise des caractéristiques géométriques, cette partie entre au cœur de la Résistance des Matériaux. Elle a pour but d’analyser les contraintes générées par chaque type de sollicitation (flexion, cisaillement, torsion, flambage) et d’appliquer les formules de dimensionnement pour garantir la sécurité des structures.
Chapitre 4 : La Flexion Plane Simple
La flexion est la sollicitation la plus courante pour les éléments de structure horizontaux comme les poutres et les planchers. Sa maîtrise est donc une compétence centrale pour le technicien.
4.1. La Relation entre Moment Fléchissant et Contraintes Normales
La théorie de la flexion (Navier-Bernoulli) établit une relation de proportionnalité directe entre le moment fléchissant (M) agissant dans une section et les contraintes normales (σ) qui en résultent.
4.2. La Formule Fondamentale de la Flexion
La formule σ = My/I est la pierre angulaire du dimensionnement en flexion. Son application permet de calculer la contrainte en n’importe quel point de la section d’une poutre.
4.3. Le Dimensionnement en Flexion : Vérification des Contraintes
La démarche de vérification consiste, pour une poutre et un chargement donnés, à calculer la contrainte maximale de flexion et à s’assurer qu’elle reste inférieure à la contrainte admissible du matériau.
4.4. Le Dimensionnement en Flexion : Choix d’un Profilé
La démarche de conception consiste, pour un moment fléchissant donné, à calculer le module de flexion nécessaire, puis à choisir dans un catalogue le profilé métallique qui satisfait à cette condition.
Chapitre 5 : L’Effort Tranchant en Flexion
Indissociable du moment fléchissant, l’effort tranchant (T) génère des contraintes de cisaillement qu’il est également nécessaire de vérifier, notamment dans les zones proches des appuis.
5.1. La Répartition des Contraintes de Cisaillement
Contrairement aux contraintes normales, les contraintes de cisaillement ne sont pas réparties de manière linéaire dans la section. Leur distribution est parabolique pour une section rectangulaire.
5.2. Le Calcul de la Contrainte de Cisaillement Maximale
Des formules spécifiques permettent de calculer la contrainte de cisaillement maximale, qui se situe généralement au niveau de la fibre neutre de la section.
5.3. La Comparaison des Contraintes de Flexion et de Cisaillement
Dans la plupart des poutres élancées, les contraintes de flexion sont prépondérantes. Cependant, pour les poutres courtes et fortement chargées, la vérification au cisaillement devient dimensionnante.
5.4. Le Rôle de l’Âme des Poutrelles
L’analyse montre que dans un profilé en I, c’est l’âme (la partie verticale) qui reprend la quasi-totalité de l’effort tranchant, tandis que les semelles (les parties horizontales) travaillent essentiellement en flexion.
Chapitre 6 : Le Flambage des Pièces Comprimées
Lorsqu’une pièce élancée est comprimée, elle peut se rompre non pas par écrasement de la matière, mais par perte de stabilité de sa forme : c’est le phénomène de flambage.
6.1. Le Phénomène d’Instabilité par Flambage
Le flambage est une ruine brutale qui doit être absolument évitée. Ce chapitre explique les mécanismes de ce phénomène et les paramètres qui l’influencent : la longueur de la pièce, ses conditions d’appui et la géométrie de sa section.
6.2. La Notion d’Élancement et la Formule d’Euler
L’élancement est un nombre sans dimension qui caractérise la sveltesse d’une pièce. La formule d’Euler donne la charge critique de flambage pour les pièces très élancées.
6.3. Les Formules Pratiques de Dimensionnement
Pour les élancements courants dans la construction, des formules empiriques comme celles de Rankine ou de Tetmajer sont utilisées pour le dimensionnement pratique des poteaux et des barres comprimées.
6.4. L’Application au Calcul des Barres de Treillis Comprimées
La vérification au flambage est une étape incontournable dans le calcul d’une structure en treillis, comme une ferme de charpente pour un marché à Mbandaka ou un pylône de ligne électrique.
Chapitre 7 : Les Sollicitations Simples et les Assemblages
Ce chapitre a une double vocation : consolider les acquis de l’année précédente sur les sollicitations les plus simples (traction, compression, cisaillement) et les appliquer au cas particulier, mais fondamental, des assemblages.
7.1. La Traction, la Compression et le Cisaillement : Consolidation
Une révision approfondie des formules de calcul et des critères de dimensionnement pour les trois sollicitations simples est menée à travers des exercices de synthèse.
7.2. Le Calcul des Assemblages par Rivets et Boulons
La théorie du cisaillement simple est appliquée au calcul des assemblages boulonnés, en apprenant à déterminer le nombre de boulons nécessaires pour transmettre un effort donné.
7.3. Le Calcul des Assemblages par Cordons de Soudure
Les assemblages soudés sont également étudiés, en montrant comment calculer la longueur d’un cordon de soudure d’angle pour qu’il résiste à l’effort qui le sollicite.
7.4. Études de Cas d’Assemblages de Charpente
Des cas concrets d’assemblages, comme la liaison entre un tirant et un gousset dans une ferme métallique, sont analysés pour mettre en pratique l’ensemble de ces connaissances.
Chapitre 8 : La Torsion Simple
La torsion est la sollicitation qui apparaît lorsqu’on applique un couple à une pièce, tendant à la tordre autour de son axe longitudinal. Elle concerne principalement les arbres de transmission.
8.1. Le Phénomène de Torsion et ses Applications
Le concept de moment de torsion est introduit. Ses applications, bien que moins fréquentes en bâtiment, sont importantes en génie mécanique et pour certains éléments de structure.
8.2. La Formule de la Torsion pour les Sections Circulaires
L’étude se concentre sur le cas des sections circulaires pleines ou creuses, pour lesquelles une formule simple relie le moment de torsion, le moment d’inertie polaire et la contrainte de cisaillement.
8.3. Le Calcul des Contraintes et des Angles de Déformation
La formule de la torsion permet de calculer la contrainte de cisaillement maximale à la périphérie de la section. Le calcul de l’angle de déformation total de la pièce est également abordé.
8.4. Application au Dimensionnement des Arbres de Transmission
Le dimensionnement d’un arbre de transmission, comme celui d’un treuil de chantier, est un exemple d’application directe de la théorie de la torsion.
Partie III : Introduction aux Sollicitations Composées
Dans la réalité, les éléments de structure sont rarement soumis à une seule sollicitation simple. Cette dernière partie, qui ouvre sur le programme de l’année terminale, a pour but d’initier l’élève au calcul des pièces soumises à la combinaison de plusieurs efforts simultanément, comme c’est le cas pour la plupart des poteaux et des pannes de toiture.
Chapitre 9 : La Flexion Composée (Compression et Flexion)
La flexion composée est la combinaison d’un effort normal (souvent de compression) et d’un moment fléchissant. C’est le cas de charge typique de la plupart des poteaux de bâtiment.
9.1. Le Principe de Superposition des Contraintes
Pour les sollicitations combinées, le principe de superposition est appliqué : la contrainte totale en un point est la somme algébrique des contraintes créées par chaque sollicitation simple.
9.2. Le Tracé du Diagramme des Contraintes
La combinaison d’une contrainte uniforme de compression et d’une contrainte variant linéairement de flexion donne un diagramme de contraintes trapézoïdal. Sa construction et son interprétation sont étudiées.
9.3. La Condition de Non-Traction dans les Maçonneries
Pour les matériaux ne résistant pas à la traction, comme la maçonnerie ou le sol, il faut s’assurer que la contrainte reste partout en compression. Cette condition définit une zone de la section où la charge doit être appliquée : le noyau central.
9.4. Application aux Fondations Excentrées
Le calcul d’une semelle de fondation soumise à une charge excentrée est une application directe de la flexion composée. Il est crucial de vérifier que la pression sur le sol reste partout positive pour éviter le soulèvement.
Chapitre 10 : La Flexion Déviée
La flexion déviée se produit lorsque les charges ne sont pas appliquées dans un plan de symétrie de la poutre, ce qui provoque une flexion simultanée autour des deux axes principaux de la section. C’est le cas typique des pannes de toiture.
10.1. La Flexion autour des Deux Axes Principaux d’Inertie
Le principe de la flexion déviée est expliqué comme la superposition de deux flexions simples, chacune se produisant autour d’un des axes principaux d’inertie de la section.
10.2. La Décomposition du Moment Fléchissant
La première étape du calcul consiste à décomposer le vecteur moment fléchissant (ou les charges) selon les deux directions des axes principaux.
10.3. Le Calcul des Contraintes aux Points Extrêmes
La contrainte totale en chaque coin de la section est calculée en additionnant les contraintes dues à chaque flexion. Les valeurs maximales de traction et de compression sont ensuite identifiées.
10.4. Application au Dimensionnement des Pannes de Toiture
Le dimensionnement d’une panne de toiture, soumise au poids de la couverture qui l’incline, est l’exemple d’application par excellence de la théorie de la flexion déviée.
Chapitre 11 : Projet de Synthèse : Vérification d’un Élément de Structure
Ce dernier chapitre est un projet intégrateur qui demande à l’élève de mobiliser toutes les compétences de l’année pour mener l’analyse et la vérification complète d’un élément de structure réel.
11.1. L’Analyse d’un Cas Concret
Le projet partira d’un cas concret, comme une solive du plancher d’un bâtiment administratif à Kinshasa ou un poteau d’un préau d’école à Goma.
11.2. La Détermination des Charges et le Calcul des Sollicitations
La première phase consistera à effectuer une « descente de charges » pour évaluer les actions appliquées à l’élément, puis à calculer les sollicitations maximales (M, T, N) par la statique.
11.3. La Vérification Complète des Contraintes
L’élève devra ensuite mener toutes les vérifications nécessaires en RDM : calcul des caractéristiques géométriques de la section, vérification de la contrainte de flexion, de la contrainte de cisaillement, et, le cas échéant, du flambage.
11.4. L’Introduction à la Vérification de la Déformation (Flèche)
En ouverture sur les États Limites de Service, une introduction à la vérification de la flèche (la déformation en flexion) sera proposée, pour s’assurer que la poutre reste suffisamment rigide pour garantir le confort et éviter les désordres.
Annexes
Formulaire Complet de RDM
Un recueil de toutes les formules de calcul des caractéristiques géométriques et des contraintes pour chaque sollicitation étudiée sera fourni. 🧮
Propriétés des Matériaux et Contraintes Admissibles
Un tableau synthétique donnera les valeurs des caractéristiques mécaniques et des contraintes admissibles usuelles pour l’acier, le bois et l’aluminium.
Extraits de Catalogues de Profilés
Des extraits de catalogues de profilés métalliques seront fournis, donnant pour chaque section l’ensemble de ses caractéristiques géométriques (aire, moments d’inertie, modules de flexion, rayons de giration).
Guide de Résolution de Problèmes en RDM
Une fiche méthodologique rappellera la démarche systématique à suivre pour résoudre un problème de RDM, de la modélisation à la vérification finale des résultats, en passant par le calcul des sollicitations et des contraintes. ✅



