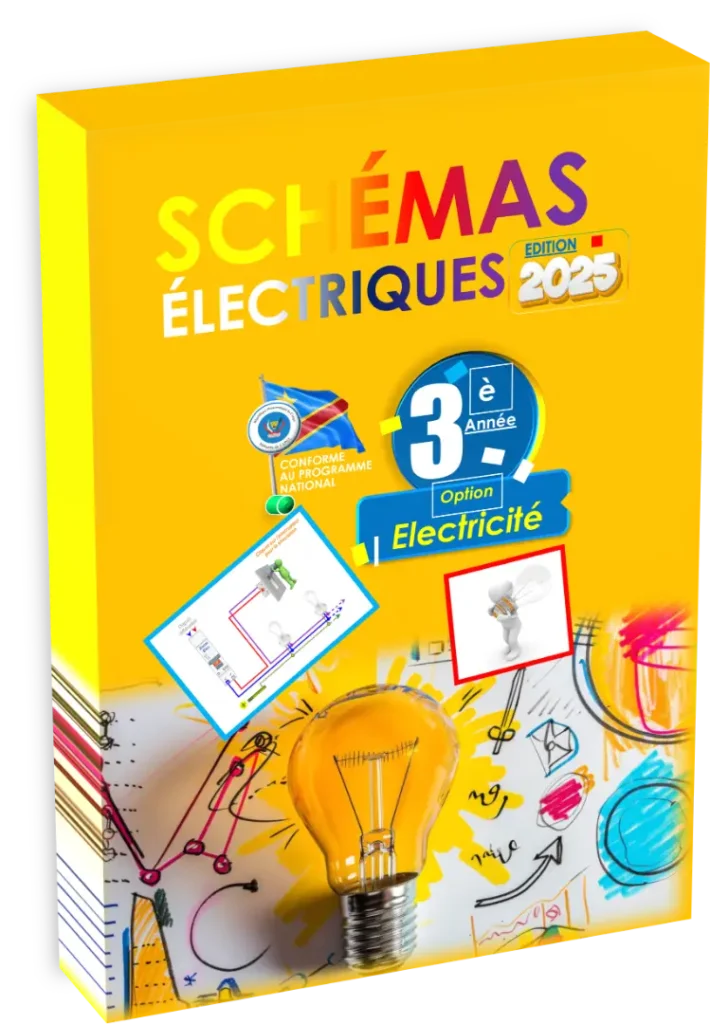
SCHÉMAS ÉLECTRIQUES, 3ÈME ANNÉE, OPTION ÉLECTRICITÉ
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
PRÉLIMINAIRES
1. Objectifs Généraux du Cours 🎯
Ce cours de troisième année a pour objectif de faire du dessin technique un véritable outil d’ingénierie pour l’élève technicien. L’ambition est de le rendre capable de concevoir, de représenter et de documenter des systèmes électrotechniques complexes, incluant la distribution de puissance, la commande de moteurs et les automatismes de base. Au terme de ce module, l’apprenant doit maîtriser la lecture et la création de schémas industriels normalisés, pouvoir extraire d’un plan la liste complète du matériel nécessaire, et être capable de produire un dossier technique cohérent pour un projet d’installation de force motrice.
2. Approche Pédagogique Recommandée 🧑🏫
La pédagogie sera résolument orientée projet. Après avoir consolidé les normes du dessin industriel, les élèves travailleront sur des études de cas de complexité croissante. L’enseignant agira comme un chef de bureau d’études, fournissant un cahier des charges et guidant les élèves dans la conception et la représentation de la solution. La lecture de schémas industriels réels et l’analyse de documentations techniques de constructeurs (Schneider, Siemens, ABB) seront des activités centrales. Un projet de synthèse intégrateur, comme la conception du dossier électrique complet pour un petit atelier de production ou une station de pompage, constituera l’épine dorsale de l’année et servira à l’évaluation des compétences.
3. Prérequis du Cours 📚
Une maîtrise complète des programmes de Schémas Électriques et d’Électricité Générale des années précédentes est un prérequis absolu. L’élève doit connaître parfaitement les symboles, les circuits d’éclairage et les principes du courant alternatif monophasé et triphasé. Une grande rigueur, une capacité d’analyse et une aptitude à organiser l’information sont des qualités essentielles pour réussir dans ce cours.
PARTIE 1 : FONDEMENTS DU DESSIN ÉLECTROTECHNIQUE INDUSTRIEL
Cette partie établit les règles et les méthodes du dessin industriel moderne. Elle introduit les normes de repérage fonctionnel et la structuration des schémas, qui permettent de rendre lisibles des systèmes complexes. C’est le passage du simple dessin à la documentation technique structurée.
Chapitre 1: Normes et Repérage dans les Schémas Industriels
1.1. Les Normes Internationales (CEI 61082, CEI 81346)
Les normes qui régissent la préparation de la documentation électrotechnique sont présentées. L’accent est mis sur la structuration des documents et l’identification des composants pour garantir une clarté et une universalité maximales.
1.2. Le Repérage Fonctionnel des Composants
Le principe du repérage alphanumérique (ou identification fonctionnelle) est enseigné. Chaque composant se voit attribuer un code unique basé sur sa nature et sa fonction (ex: -Q1 pour une protection, -KM1 pour un contacteur de puissance), une méthode indispensable pour la lecture et le dépannage de schémas complexes.
1.3. Les Références Croisées
La technique des références croisées est expliquée. Pour un relais ou un contacteur, elle permet de localiser sur le schéma tous ses contacts (normalement ouverts ou fermés) en indiquant à côté de la bobine les numéros de folio et de colonne où ils se trouvent.
1.4. Repérage des Borniers et des Conducteurs
Les méthodes de repérage des bornes de raccordement et des conducteurs (numérotation) sont standardisées. Un fil qui change de potentiel doit changer de numéro, ce qui facilite grandement le câblage et le dépannage d’une armoire électrique, par exemple dans une usine textile à Kisangani.
Chapitre 2: Schémas de Puissance et Schémas de Commande
2.1. Distinction Fondamentale
La séparation systématique des schémas en une partie « puissance » et une partie « commande » est réaffirmée comme une règle fondamentale du dessin industriel. Le circuit de puissance gère l’énergie, le circuit de commande gère l’information.
2.2. Le Schéma de Puissance
Les conventions de représentation du circuit de puissance sont étudiées : tracé en traits forts, représentation des trois phases et de la terre, et positionnement des organes de sectionnement, de protection et de commutation.
2.3. Le Schéma de Commande
Les conventions du circuit de commande sont détaillées : représentation en schéma développé (chaque circuit logique est dessiné entre deux potentiels), tracé en traits fins, et représentation des bobines et des contacts.
2.4. L’Articulation entre Puissance et Commande
La liaison entre les deux schémas via les références croisées est mise en pratique. L’élève apprend à suivre une séquence logique : une action sur un bouton dans le circuit de commande active une bobine, dont les contacts se ferment dans le circuit de puissance pour alimenter un moteur.
Chapitre 3: Utilisation du DAO pour les Schémas Électrotechniques
3.1. Les Logiciels de DAO Électrique
Les fonctionnalités spécifiques des logiciels de CAO/DAO dédiés à l’électricité (ex: AutoCAD Electrical, SEE Electrical) sont présentées. Ces outils automatisent de nombreuses tâches par rapport à un logiciel de dessin généraliste.
3.2. Création et Gestion de Bibliothèques de Symboles
L’élève apprend à utiliser les bibliothèques de symboles (fournies par les constructeurs) et à créer ses propres blocs pour les composants spécifiques, garantissant ainsi la standardisation et la rapidité de conception.
3.3. Fonctions Automatisées
Les fonctions intelligentes de ces logiciels sont explorées : numérotation automatique des fils, insertion de composants avec repérage automatique, génération de références croisées en temps réel, et détection d’erreurs (contacts en double).
3.4. Génération Automatique de Nomenclatures et de Borniers
La puissance du DAO est démontrée par sa capacité à générer automatiquement, à partir du schéma, la liste complète du matériel (nomenclature), les schémas de raccordement des borniers, et d’autres documents annexes, assurant la cohérence du dossier technique.
PARTIE 2 : SCHÉMAS DE DISTRIBUTION DE PUISSANCE ET DE MOTEURS
Cette section se concentre sur la représentation des équipements qui gèrent la distribution de l’énergie électrique et son utilisation dans les moteurs, depuis le poste de transformation jusqu’à l’actionneur final.
Chapitre 4: Représentation des Équipements de Distribution
4.1. Le Schéma Unifilaire de Distribution
Le schéma unifilaire est présenté comme la représentation macroscopique d’une installation. Il montre, par un seul trait, le cheminement de l’énergie depuis la source jusqu’aux charges finales, en indiquant les caractéristiques des câbles et des protections.
4.2. Représentation d’un Poste de Transformation MT/BT
Le schéma unifilaire d’un petit poste de transformation privé est étudié, en représentant le sectionneur d’arrivée Moyenne Tension, les fusibles MT, le transformateur, et le disjoncteur général Basse Tension.
4.3. Schémas des Tableaux Généraux Basse Tension (TGBT)
La conception du schéma d’un TGBT est abordée. L’élève apprend à dessiner l’arrivée de puissance, le disjoncteur général, et les départs des différents circuits (éclairage, force motrice) avec leurs protections respectives.
4.4. Dessin de l’Implantation d’une Armoire Électrique
L’élève apprend à réaliser le plan d’aménagement (ou « layout ») d’une armoire électrique. Cet exercice consiste à positionner physiquement les composants (disjoncteurs, contacteurs, borniers) sur une platine de montage en respectant les distances d’isolement et les règles de câblage.
Chapitre 5: Schémas de Démarrage des Moteurs Asynchrones
5.1. Le Démarrage Direct
Les schémas complets (puissance, commande) du démarrage direct un sens de marche sont dessinés. La fonction de chaque composant est analysée : sectionneur porte-fusibles, contacteur, relais thermique pour la protection contre les surcharges.
5.2. L’Inversion du Sens de Marche
Le schéma permettant d’inverser le sens de rotation d’un moteur triphasé (par permutation de deux phases) est conçu. Le concept de verrouillage électrique et mécanique entre les deux contacteurs de sens est introduit comme une sécurité indispensable.
5.3. Le Démarrage Étoile-Triangle
Le schéma de puissance, avec ses trois contacteurs (ligne, étoile, triangle), et le schéma de commande, intégrant une temporisation pour le passage du couplage étoile au couplage triangle, sont dessinés et analysés en détail.
5.4. Le Démarrage par Autotransformateur
Pour les moteurs de très forte puissance, le principe du démarrage par autotransformateur, qui permet de choisir plusieurs points de tension réduite, est expliqué et son schéma de commande est esquissé.
PARTIE 3 : SCHÉMAS D’AUTOMATISME ET DE RÉGULATION
Cette partie introduit les logiques de commande qui vont au-delà du simple démarrage, en abordant les séquences automatiques et une ouverture vers la régulation et les automates programmables.
Chapitre 6: Schémas de Logique Câblée
6.1. Les Relais et Contacteurs Auxiliaires
Le rôle des relais comme mémoires logiques et interfaces de commande est approfondi. L’élève apprend à concevoir des logiques séquentielles simples (ex: cycle « marche avant – temporisation – marche arrière »).
6.2. Les Blocs de Temporisation
Les blocs de contacts temporisés (au travail ou au repos) qui s’ajoutent aux contacteurs sont étudiés. Ils permettent de créer des séquences automatiques basées sur le temps, une fonction essentielle dans de nombreux procédés industriels à travers le pays.
6.3. Les Capteurs et Détecteurs
Les symboles et le raccordement des capteurs TOR (Tout Ou Rien) les plus courants sont présentés : fins de course, détecteurs de proximité (inductifs, capacitifs), pressostats, thermostats. Ils sont les « sens » d’un automatisme.
6.4. Conception d’un Cycle Automatique Simple
Un exercice de synthèse est réalisé, comme la conception du schéma de commande d’une porte de garage automatique, incluant les commandes manuelles, les fins de course et les sécurités.
Chapitre 7: Introduction aux Schémas d’Automates Programmables (API)
7.1. Principe de l’Automate Programmable
L’API (ou PLC en anglais) est présenté comme un boîtier électronique qui remplace les logiques à relais câblées par un programme informatique. Ses avantages (flexibilité, complexité, communication) sont soulignés.
7.2. Architecture d’un API
La structure d’un API est décomposée : l’unité centrale (CPU), le module d’alimentation, les modules d’entrées (qui lisent les capteurs) et les modules de sorties (qui commandent les préactionneurs).
7.3. Le Schéma de Raccordement d’un API
L’élève apprend à lire et à dessiner le schéma de câblage d’un API. Ce schéma montre comment les capteurs (boutons, fins de course) sont raccordés aux entrées, et comment les préactionneurs (bobines de contacteurs, voyants) sont raccordés aux sorties.
7.4. Du Schéma à Contacts (Ladder) au Câblage
Le langage de programmation le plus courant, le Ladder (LD), est introduit car il s’inspire directement des schémas de logique câblée. La correspondance entre une ligne de programme Ladder et son équivalent en schéma à relais est montrée.
PARTIE 4 : PROJET DE SYNTHÈSE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE
La partie finale est entièrement consacrée à la réalisation d’un projet complet, permettant à l’élève de mobiliser toutes les compétences acquises pour produire un dossier technique professionnel.
Chapitre 8: Cahier des Charges et Avant-Projet
8.1. Analyse d’un Cahier des Charges Fonctionnel
L’élève apprend à décortiquer un cahier des charges qui décrit le besoin d’une installation (ex: « une pompe doit remplir un réservoir en s’arrêtant automatiquement quand il est plein »).
8.2. Bilan de Puissance et Choix des Technologies
À partir du cahier des charges, l’élève réalise un bilan de puissance prévisionnel pour dimensionner l’arrivée électrique et choisit les technologies appropriées pour la commande (logique câblée ou API).
8.3. Élaboration du Schéma Unifilaire Général
La première étape de la conception est la création du schéma unifilaire général de l’installation, montrant les grands blocs fonctionnels et la distribution de l’énergie.
8.4. Implantation Générale des Équipements
L’élève réalise un plan d’implantation montrant la disposition géographique des machines, des armoires électriques et des chemins de câbles, une étape cruciale pour l’organisation du chantier, par exemple lors de l’électrification d’une ferme agricole dans le Kongo Central.
Chapitre 9: Réalisation du Dossier de Schémas d’Exécution
9.1. Dessin des Schémas de Puissance
L’élève dessine en détail tous les schémas de puissance de l’installation, en appliquant les règles de repérage et de clarté.
9.2. Dessin des Schémas de Commande
Les schémas de commande développés sont ensuite réalisés, en incluant les références croisées et le repérage de tous les composants et conducteurs.
9.3. Dessin des Schémas de Borniers et de Câblage
Les plans de raccordement pour les borniers de l’armoire et des boîtes de jonction sont produits, un document essentiel pour le monteur-câbleur.
9.4. Dessin de l’Aménagement de l’Armoire
Le plan de « layout » final de l’armoire est dessiné, avec la nomenclature et les repères de chaque composant.
Chapitre 10: Finalisation du Dossier Technique
10.1. Le Bordereau de Matériel (Nomenclature)
À partir des schémas, l’élève génère la liste complète et détaillée du matériel nécessaire pour la réalisation du projet.
10.2. Le Devis Quantitatif et Estimatif
En se basant sur la nomenclature, l’élève apprend les bases pour établir un devis, en associant un prix unitaire à chaque composant et en estimant le coût de la main-d’œuvre.
10.3. La Rédaction des Notes de Calcul
Des notes de calcul justifiant le dimensionnement des câbles et des protections sont rédigées, un document important pour la validation technique du projet.
10.4. Constitution et Présentation du Dossier Final
L’ensemble des documents (plans, nomenclatures, notes de calcul, documentations constructeur) est assemblé, paginé et organisé pour former un dossier technique professionnel, prêt à être présenté ou transmis pour exécution.
ANNEXES
Les annexes sont une compilation de ressources pour le bureau d’études. Elles contiennent des catalogues de constructeurs pour l’appareillage industriel, des fiches techniques de moteurs et de capteurs, des exemples de projets complets, et un guide de conformité aux principales normes de dessin et d’installation. Un glossaire des termes de l’automatisme et de l’électrotechnique industrielle est également fourni.



