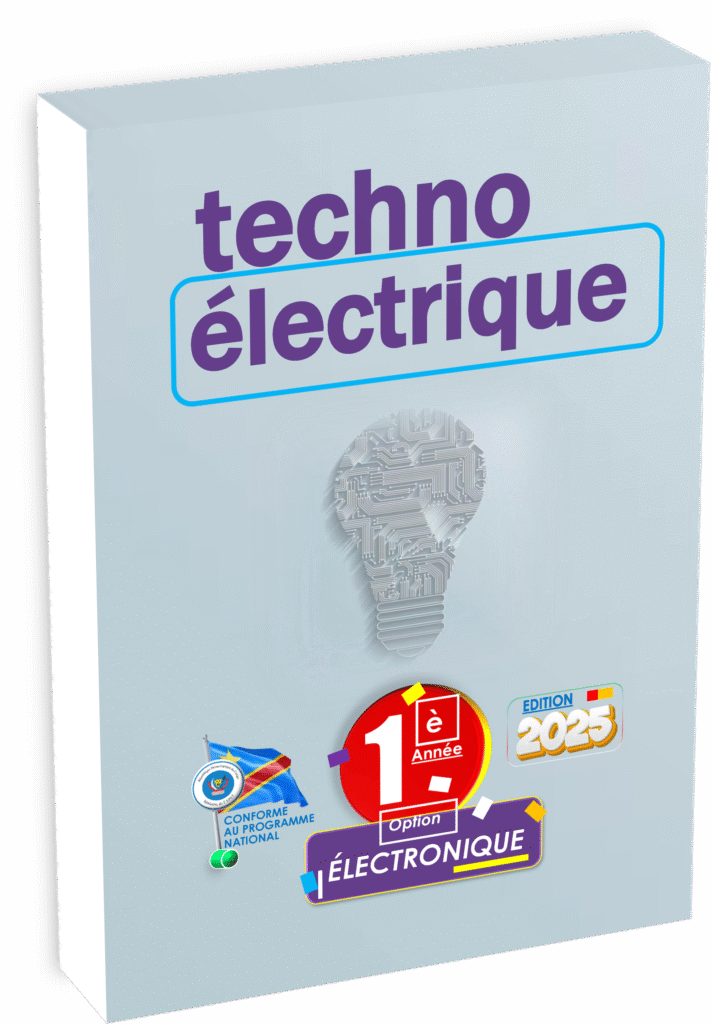
TECHNOLOGIE ELECTRIQUE
1ÈRE ANNÉE – OPTION ÉLECTRONIQUE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
Préliminaires
1. Objectifs Généraux du Cours
Ce manuel a pour objectif de familiariser l’élève avec l’univers matériel de l’électricité. La technologie électrique étudie la constitution, les caractéristiques et l’utilisation des divers composants qui constituent une installation électrique. L’ambition de ce cours est de construire un répertoire de connaissances techniques solides, permettant à l’élève d’identifier, de choisir et de justifier l’emploi de chaque matériel, depuis les conducteurs jusqu’à l’appareillage de commande industriel.
2. Compétences Visées
Au terme de ce programme d’apprentissage, l’élève sera apte à :
- Identifier les principaux matériaux utilisés en électricité et décrire leurs propriétés distinctives.
- Reconnaître les différents types de canalisations électriques et les associer à leur domaine d’application.
- Décrire la structure et le principe de fonctionnement de l’appareillage électrique domestique.
- Différencier les composants de l’appareillage industriel et énoncer leurs fonctions spécifiques dans un circuit de commande ou de puissance.
3. Approche Pédagogique
La démarche pédagogique est essentiellement descriptive et comparative. Elle s’appuie sur l’observation et l’analyse technologique des composants. Chaque chapitre présente une famille de matériels, en détaillant sa constitution, ses variantes, ses caractéristiques nominales et ses critères de choix. Des études de cas pratiques, comme la sélection de l’appareillage pour un petit atelier de menuiserie à Kikwit ou le choix des câbles pour l’extension d’un réseau dans un quartier de Bunia, ancrent les connaissances technologiques dans des contextes d’application concrets.
PREMIÈRE PARTIE : LES MATÉRIAUX DE L’ÉLECTRICITÉ 🔬
Cette partie fondamentale explore la nature intime des matériaux qui rendent possible la maîtrise et l’utilisation de l’énergie électrique. La compréhension de leurs propriétés microscopiques est la clé pour justifier leur emploi macroscopique dans les différents composants. L’élève y découvrira la classification des matériaux en fonction de leur comportement électrique et magnétique, un savoir indispensable pour comprendre la fonction et les limites de chaque élément d’un circuit.
CHAPITRE 1 : LES CONDUCTEURS ÉLECTRIQUES
1.1. Propriétés générales des conducteurs
Ce sous-chapitre définit un conducteur comme un matériau permettant la libre circulation des charges électriques. Sa principale caractéristique, la faible résistivité, est mise en évidence. La notion de conductivité, inverse de la résistivité, est également introduite pour quantifier cette propriété.
1.2. Le cuivre
Le cuivre est présenté comme le conducteur le plus utilisé en électricité pour ses excellentes conductivité et ductilité, ainsi que sa bonne résistance à la corrosion. Ses différentes formes d’utilisation (fils, barres, méplats) et ses nuances (recuit, écroui) sont décrites.
1.3. L’aluminium
L’aluminium est étudié comme une alternative au cuivre, notamment pour les lignes de transport d’énergie, en raison de sa légèreté et de son coût moindre. Les défis liés à son utilisation, comme l’oxydation rapide et le fluage, sont également abordés pour offrir une vision complète.
1.4. Autres matériaux conducteurs
Ce sous-chapitre explore d’autres conducteurs et leurs applications spécifiques. L’argent pour les contacts électriques de haute qualité, l’or pour sa résistance à l’oxydation dans les connecteurs électroniques, et les alliages comme le laiton sont présentés.
CHAPITRE 2 : LES ISOLANTS ÉLECTRIQUES
2.1. Propriétés générales des isolants
Un isolant, ou diélectrique, est défini comme un matériau s’opposant au passage du courant électrique. Ses caractéristiques clés sont détaillées : une très haute résistivité, une rigidité diélectrique élevée (capacité à supporter un champ électrique intense) et une bonne stabilité thermique et chimique.
2.2. Isolants solides
La grande famille des isolants solides est explorée. L’élève découvrira les matières plastiques (PVC, polyéthylène) utilisées pour l’isolation des câbles, les céramiques (porcelaine) pour les isolateurs de lignes à haute tension, ainsi que le verre et le mica.
2.3. Isolants liquides
Certaines applications, comme les transformateurs de puissance, nécessitent des isolants liquides pour assurer à la fois l’isolation et le refroidissement. Les huiles minérales sont présentées comme le principal diélectrique liquide utilisé dans ces équipements.
2.4. Isolants gazeux
L’air ambiant est l’isolant gazeux le plus courant, assurant l’isolement dans les lignes aériennes. Pour des applications plus exigeantes en appareillage sous enveloppe métallique, des gaz spécifiques comme l’hexafluorure de soufre (SF6), aux propriétés diélectriques exceptionnelles, sont introduits.
CHAPITRE 3 : LES MATÉRIAUX SEMI-CONDUCTEURS ET MAGNÉTIQUES
3.1. Les semi-conducteurs
Les semi-conducteurs (silicium, germanium) sont présentés comme des matériaux dont la conductivité peut être contrôlée. Leur position intermédiaire entre conducteurs et isolants est expliquée, soulignant leur rôle fondamental en électronique pour la fabrication de diodes, transistors et circuits intégrés.
3.2. Les matériaux magnétiques doux
Les matériaux magnétiques doux, comme le fer-silicium, sont caractérisés par leur capacité à s’aimanter facilement sous l’effet d’un champ magnétique et à perdre rapidement cette aimantation. L’élève comprendra leur utilisation pour canaliser le flux magnétique dans les transformateurs et les machines électriques.
3.3. Les matériaux magnétiques durs
À l’inverse, les matériaux magnétiques durs (ou permanents), comme les alliages AlNiCo ou les ferrites, sont difficiles à aimanter mais conservent leur aimantation de façon durable. Leur application pour la création d’aimants permanents utilisés dans les petits moteurs, les haut-parleurs ou les capteurs est décrite.
3.4. Les matériaux résistifs
Ce sous-chapitre se concentre sur les alliages spécifiquement conçus pour avoir une résistivité élevée et stable en température, comme le constantan ou le nichrome. Leur usage dans la fabrication de résistances de précision, de shunts de mesure ou d’éléments chauffants est expliqué.
DEUXIÈME PARTIE : LES CANALISATIONS ET LA PROTECTION DES CIRCUITS 🛡️
Cette partie aborde la manière dont l’énergie électrique est acheminée de la source jusqu’aux points d’utilisation. Elle traite des « autoroutes » de l’électricité : les câbles et leurs modes de pose. Une attention toute particulière est portée aux dispositifs qui garantissent la sécurité des installations et des personnes. L’élève y apprendra que transporter l’électricité est indissociable de la capacité à interrompre le courant de manière fiable et rapide en cas d’anomalie.
CHAPITRE 4 : LES CONDUCTEURS ET CÂBLES ÉLECTRIQUES
4.1. Structure d’un câble électrique
La constitution type d’un câble électrique est disséquée : l’âme conductrice (le cœur du câble), l’enveloppe isolante (qui assure l’isolation électrique), et la gaine de protection (qui protège contre les agressions mécaniques et chimiques).
4.2. Âme massive et âme câblée
L’élève apprendra à différencier les conducteurs à âme massive (un seul brin), rigides et utilisés dans les installations fixes, des conducteurs à âme câblée (plusieurs brins fins assemblés), qui sont souples et destinés aux équipements mobiles ou aux liaisons soumises à des vibrations.
4.3. Désignation normalisée des câbles
Un système de désignation normalisé permet d’identifier sans ambiguïté les caractéristiques d’un câble. L’élève sera initié à ce code qui renseigne sur la nature de l’isolant, le nombre de conducteurs, leur section et la présence éventuelle de conducteurs de protection.
4.4. Critères de choix d’un câble
La sélection d’un câble adéquat dépend de multiples facteurs. Les principaux critères sont étudiés : la tension nominale, le courant admissible (qui détermine la section), la nature de l’âme, et les contraintes de l’environnement d’installation (humidité, température, risque de choc).
CHAPITRE 5 : LES MODES DE POSE ET CONDUITS D’INSTALLATION
5.1. Installations fixes et mobiles
Une distinction est faite entre les canalisations fixes, qui font partie intégrante de la structure d’un bâtiment (par exemple, un réseau électrique dans un hôpital à Mbuji-Mayi), et les canalisations mobiles, qui alimentent des appareils portatifs ou déplaçables.
5.2. Montage apparent
Ce mode de pose, où les conduits sont visibles, est souvent utilisé dans les locaux techniques, les garages ou les ateliers. L’élève découvrira les différents types de conduits rigides (en plastique ou métalliques) et les accessoires de fixation (colliers, supports) associés.
5.3. Montage encastré
Le montage encastré, plus esthétique, consiste à dissimuler les conduits dans les murs, les sols ou les plafonds. Les gaines flexibles annelées et les boîtes d’encastrement pour l’appareillage sont présentées comme les composants clés de ce type d’installation.
5.4. Chemins de câbles et goulottes
Pour les installations tertiaires ou industrielles nécessitant un grand nombre de câbles, les chemins de câbles (échelles ou plateaux métalliques) et les goulottes (profilés en PVC) sont utilisés. Ces systèmes permettent un acheminement ordonné et accessible des canalisations.
CHAPITRE 6 : LA PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS : FUSIBLES
6.1. Le phénomène de surintensité
Une surintensité est une augmentation anormale du courant dans un circuit, qui peut être une surcharge (dépassement modéré mais prolongé) ou un court-circuit (augmentation brutale et très intense). Les dangers associés (échauffement, incendie, destruction de matériel) sont soulignés.
6.2. Le coupe-circuit à fusible
Le fusible est décrit comme l’organe de protection le plus simple. Il est constitué d’un fil calibré qui fond et coupe le circuit lorsque le courant dépasse une certaine valeur pendant un temps donné, protégeant ainsi l’installation en se sacrifiant.
6.3. Types de fusibles
L’élève découvrira la diversité des technologies de fusibles : les fusibles à usage domestique (gG), qui protègent contre les surcharges et les courts-circuits, et les fusibles à usage industriel (aM), qui protègent uniquement contre les courts-circuits et sont associés à un autre dispositif pour la protection contre les surcharges.
6.4. Caractéristiques et choix d’un fusible
Les caractéristiques principales d’un fusible sont étudiées : la tension nominale, le courant nominal (calibre) et le pouvoir de coupure (le courant de court-circuit maximal qu’il peut interrompre en toute sécurité). Les règles de sélection d’un fusible en fonction du circuit à protéger sont établies.
CHAPITRE 7 : LA PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS : DISJONCTEURS
7.1. Le disjoncteur : principe et avantages
Le disjoncteur est présenté comme un interrupteur automatique capable de détecter une surintensité et d’ouvrir le circuit. Son avantage majeur par rapport au fusible est qu’il est réarmable après une intervention, ce qui améliore la continuité de service.
7.2. Le déclencheur thermique
Pour la protection contre les surcharges, le disjoncteur utilise un déclencheur thermique. Ce dispositif, généralement un bilame, s’échauffe et se déforme lentement sous l’effet d’une surcharge prolongée, provoquant l’ouverture des contacts du disjoncteur.
7.3. Le déclencheur magnétique
La protection contre les courts-circuits est assurée par un déclencheur magnétique. Une bobine parcourue par le courant du circuit actionne instantanément un mécanisme d’ouverture lorsque le courant atteint un seuil très élevé, caractéristique d’un court-circuit.
7.4. Courbes de déclenchement et choix d’un disjoncteur
Les disjoncteurs sont classés selon leur courbe de déclenchement (B, C, D), qui définit le seuil de déclenchement magnétique. L’élève apprendra à choisir la courbe appropriée en fonction du type de récepteur à protéger (résistif, inductif, à fort courant d’appel).
TROISIÈME PARTIE : L’APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE D’USAGE DOMESTIQUE ET TERTIAIRE 🏠
Cette section se concentre sur les composants que l’on manipule au quotidien dans les habitations, les bureaux ou les commerces. L’élève y étudiera en détail la technologie des interrupteurs, des sources lumineuses et des prises de courant. L’objectif est de comprendre le fonctionnement interne de cet appareillage, ses différentes variantes et les normes qui garantissent sa sécurité et sa fiabilité.
CHAPITRE 8 : L’APPAREILLAGE DE COMMANDE MANUELLE
8.1. L’interrupteur simple allumage
Le mécanisme interne d’un interrupteur est analysé : des contacts mobiles qui établissent ou coupent la continuité d’un circuit sous l’action d’une bascule. Sa fonction de commande d’un point d’utilisation unique est rappelée.
8.2. L’interrupteur va-et-vient
La structure d’un va-et-vient, qui est en réalité un commutateur, est étudiée. L’élève comprendra comment son contact mobile bascule entre deux positions pour permettre la commande d’un même circuit d’éclairage depuis deux endroits différents.
8.3. Le bouton-poussoir
Le bouton-poussoir est décrit comme un appareil de commande à retour automatique. Son contact n’est fermé (ou ouvert) que pendant la durée de l’appui. Son utilisation en association avec des télérupteurs ou des minuteries est mise en évidence.
8.4. Les interrupteurs spécialisés
Ce sous-chapitre présente d’autres types d’interrupteurs : le double allumage (deux interrupteurs dans un même mécanisme), le permutateur (pour réaliser une commande depuis trois points ou plus) et les variateurs de lumière, qui permettent de moduler l’intensité lumineuse.
CHAPITRE 9 : LES SOURCES D’ÉCLAIRAGE ET LEURS TECHNOLOGIES
9.1. Les lampes à incandescence et halogènes
Le principe de l’incandescence (un filament de tungstène porté à haute température) est expliqué. La technologie halogène est présentée comme une amélioration qui augmente la durée de vie et l’efficacité lumineuse.
9.2. Les tubes fluorescents
Le fonctionnement d’un tube fluorescent est détaillé : une décharge électrique dans un gaz à basse pression produit un rayonnement ultraviolet qui est converti en lumière visible par une poudre fluorescente. Le rôle du ballast et du starter est expliqué.
9.3. Les lampes à décharge
Cette famille de lampes, utilisée pour l’éclairage public ou industriel, est introduite. Le principe des lampes à vapeur de mercure et à vapeur de sodium est décrit, en soulignant leur grande efficacité lumineuse et leur temps d’amorçage. L’éclairage d’une avenue à Kananga peut servir d’exemple.
9.4. Les diodes électroluminescentes (LED)
La technologie LED est présentée comme la source d’éclairage la plus moderne et la plus efficace. Le principe de l’électroluminescence au sein d’une jonction de semi-conducteur est brièvement expliqué, en insistant sur les avantages : très basse consommation, très longue durée de vie et compacité.
CHAPITRE 10 : LES PRISES DE COURANT ET LES FICHES
10.1. Structure d’une prise de courant
Une prise de courant est analysée : le socle, les bornes de raccordement pour les conducteurs (phase, neutre, terre) et les puits qui accueillent les broches de la fiche. L’importance de la broche de terre pour la sécurité des personnes est fortement soulignée.
10.2. Les différents standards de prises
L’élève sera sensibilisé à l’existence de multiples standards de prises de courant dans le monde. Les caractéristiques des standards les plus courants (européen, américain, britannique) sont présentées pour illustrer la nécessité d’utiliser des adaptateurs lors de voyages.
10.3. Les fiches mâles
La fiche est le connecteur mobile qui s’insère dans la prise. Les différents types de fiches sont décrits : fiches plates sans terre, fiches rondes avec contact de terre, et leur adéquation avec le type d’appareil à alimenter (classe d’isolation).
10.4. Prises spécialisées
Ce sous-chapitre aborde les prises destinées à des usages spécifiques : les prises étanches pour l’extérieur, les prises à détrompage pour l’informatique, et les prises de courant fort (triphasées) utilisées pour l’alimentation de machines dans les ateliers.
CHAPITRE 11 : LE TABLEAU DE DISTRIBUTION DOMESTIQUE
11.1. Rôle du tableau électrique
Le tableau de distribution est présenté comme le « centre de contrôle » et le « cœur » de la sécurité de l’installation électrique d’un logement. Il centralise le départ de tous les circuits et regroupe leurs dispositifs de protection.
11.2. Le coffret de distribution
Le coffret lui-même est décrit : une enveloppe isolante (généralement en plastique) équipée de rails DIN normalisés sur lesquels viennent se clipser les différents appareils de protection et de commande.
11.3. L’appareillage modulaire
L’élève découvrira le concept d’appareillage modulaire, où tous les dispositifs (disjoncteurs, interrupteurs différentiels, etc.) ont des dimensions standardisées (en nombre de modules de 17,5 mm) pour s’intégrer parfaitement sur les rails du tableau.
11.4. Le peigne de raccordement
Pour simplifier et fiabiliser le câblage à l’intérieur du tableau, l’utilisation de peignes de raccordement est expliquée. Ces barres conductrices isolées permettent d’alimenter une rangée de disjoncteurs de manière propre et sécurisée, en remplacement des ponts de fils volants.
QUATRIÈME PARTIE : L’APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE D’USAGE INDUSTRIEL 🏭
Cette dernière partie fait entrer l’élève dans le monde de l’automatisme et de la commande des machines industrielles. L’appareillage étudié ici est conçu pour supporter des puissances plus élevées, des manœuvres plus fréquentes et pour permettre la création de logiques de commande complexes. La compréhension de la technologie de ces composants est la première étape vers la maîtrise des automatismes industriels.
CHAPITRE 12 : LE CONTACTEUR ET LE RELAIS THERMIQUE
12.1. Le contacteur
Le contacteur est défini comme un appareil de commande à distance, capable d’établir ou d’interrompre le passage du courant dans un circuit de puissance sous l’impulsion d’un circuit de commande. Sa constitution (électroaimant, contacts de puissance, contacts auxiliaires) est détaillée.
12.2. Le relais thermique
Le relais thermique est l’organe de protection contre les surcharges spécifiquement conçu pour les moteurs. Son fonctionnement, basé sur des bilames qui réagissent à l’échauffement provoqué par le courant moteur, est expliqué. Il est presque toujours associé directement à un contacteur.
12.3. Le contacteur-disjoncteur (disjoncteur-moteur)
Ce composant intègre dans un seul boîtier les fonctions de coupure, de commande (similaire à un contacteur) et de protection (magnétique et thermique). Il constitue une solution compacte pour la commande et la protection d’un moteur de petite puissance, comme ceux que l’on trouve sur les machines-outils dans un centre de formation technique à Mbandaka.
12.4. Le télérupteur
Le télérupteur est un contacteur à fonctionnement par impulsion, utilisé principalement en éclairage pour commander un circuit depuis un nombre illimité de boutons-poussoirs. Son mécanisme bistable (une impulsion pour fermer, une autre pour ouvrir) est décrit.
CHAPITRE 13 : L’APPAREILLAGE DE COMMANDE TEMPORISÉE
13.1. Les minuteries
La minuterie est un appareil qui maintient un contact fermé pendant une durée réglable après avoir reçu une impulsion de commande. Son utilisation typique pour l’éclairage des cages d’escalier ou des couloirs est présentée.
13.2. Les relais temporisés (timers)
Les relais temporisés sont des composants essentiels des automatismes industriels. L’élève apprendra à distinguer les relais temporisés « au travail » (qui retardent la fermeture d’un contact) des relais temporisés « au repos » (qui retardent l’ouverture d’un contact).
13.3. Les interrupteurs horaires
L’interrupteur horaire (ou horloge programmable) est un appareil qui ouvre et ferme un circuit selon un programme temporel défini (horaires, jours de la semaine). Ses applications pour la gestion de l’éclairage public, du chauffage ou de la signalisation sont illustrées.
13.4. Blocs de temporisation pour contacteurs
Ce sous-chapitre explique que la fonction de temporisation peut aussi être ajoutée à un contacteur standard via des blocs additionnels (pneumatiques ou électroniques) qui se montent directement sur le contacteur. Cette modularité est très courante en industrie.
CHAPITRE 14 : LES DISPOSITIFS DE COUPURE ET DE SECTIONNEMENT INDUSTRIELS
14.1. Le sectionneur
Le sectionneur est un appareil de coupure visible, destiné à isoler une partie d’une installation électrique pour permettre une intervention en toute sécurité. L’élève apprendra qu’il ne doit jamais être manœuvré en charge (c’est-à-dire quand le courant passe).
14.2. L’interrupteur-sectionneur
Ce composant combine la fonction de commande (interrupteur) et la fonction de sectionnement. Contrairement au sectionneur simple, il est conçu pour être manœuvré en charge, ce qui en fait un appareil de coupure de proximité très utilisé sur les machines.
14.3. Les auto-rupteurs
Le terme « auto-rupteur » est souvent utilisé pour désigner des dispositifs de coupure et de protection compacts, comme les disjoncteurs-moteurs ou certains interrupteurs-sectionneurs équipés de fusibles.
14.4. La coupure d’urgence
La fonction d’arrêt d’urgence, obligatoire sur la plupart des machines, est présentée. Elle est réalisée par un bouton-poussoir « coup de poing » à verrouillage mécanique, qui doit couper l’alimentation du circuit de commande de manière fiable et directe.
Annexes
1. Mémento des Symboles d’Appareillage
Cette section contiendrait des tableaux récapitulatifs des symboles graphiques normalisés pour tout l’appareillage étudié : interrupteurs, lampes, fusibles, disjoncteurs, contacteurs, moteurs, etc. Ce mémento visuel serait un outil de référence constant pour les travaux de schématisation.
2. Guide de Lecture de Plaques Signalétiques
Les appareils électriques comportent une plaque signalétique qui résume leurs caractéristiques essentielles. Ce guide expliquerait comment lire et interpréter les informations trouvées sur la plaque d’un moteur, d’un transformateur ou d’un disjoncteur (tension, courant, puissance, classe d’isolation, etc.).
3. Tableaux de Choix de Protections
Des tableaux simplifiés aideraient l’élève à choisir le calibre d’un fusible ou d’un disjoncteur en fonction de la section du conducteur à protéger, conformément aux normes d’installation. Un tableau pour le choix de la protection d’un moteur en fonction de sa puissance serait également fourni.
4. Technologie des Bornes de Raccordement
Un aperçu des différentes technologies de bornes de raccordement serait proposé. Les bornes à vis classiques, les bornes à cage sans vis (à ressort) et les bornes automatiques seraient comparées en termes de fiabilité, de rapidité de mise en œuvre et de domaine d’application.