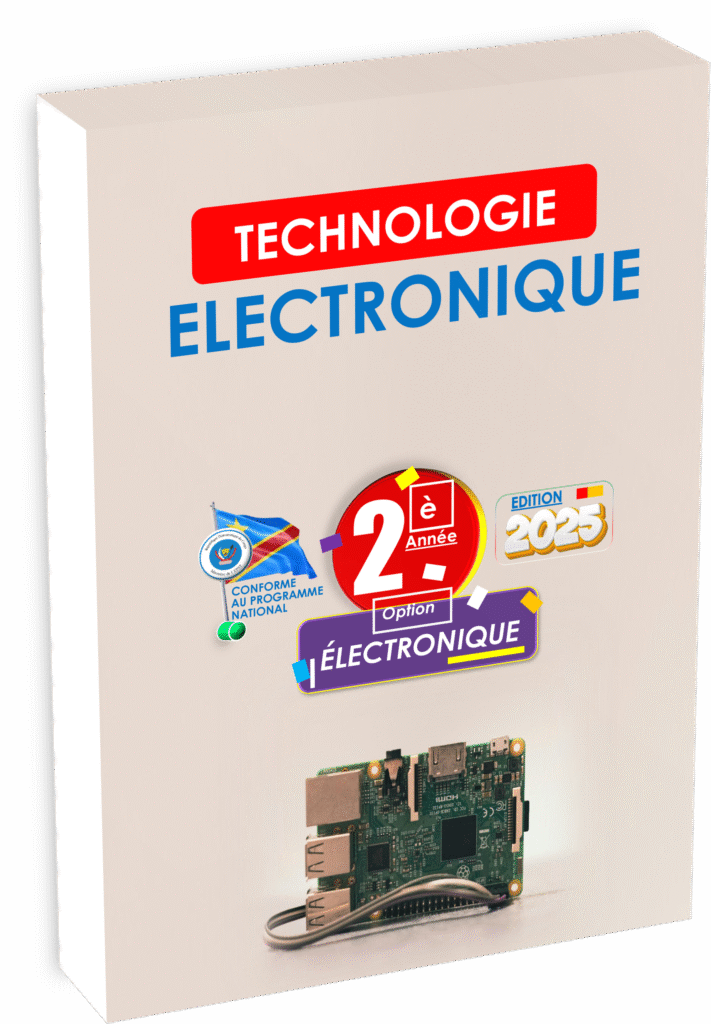
TECHNOLOGIE ELECTRONIQUE
2ÈME ANNÉE – OPTION ÉLECTRONIQUE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
Préliminaires
1. Objectifs Généraux du Cours
Ce manuel a pour finalité de construire chez l’élève une connaissance approfondie des composants électroniques, en allant au-delà de leur simple fonction pour en explorer la technologie de fabrication, les caractéristiques physiques et les critères de sélection. Ce cours établit un lien indispensable entre la théorie des circuits et la réalité matérielle des composants. L’objectif est de former un technicien capable non seulement de lire un schéma, mais aussi d’identifier physiquement les composants, de comprendre leurs limitations et de choisir le plus adéquat pour une application donnée.
2. Compétences Visées
Au terme de cette année d’apprentissage, l’élève détiendra la capacité de :
- Identifier les différentes technologies de fabrication des résistances, condensateurs et bobinages.
- Décoder les marquages (codes couleurs, codes alphanumériques) pour déterminer la valeur et les tolérances des composants passifs.
- Expliquer le principe de la piézoélectricité et justifier l’utilisation des résonateurs à quartz.
- Décrire les procédés de fabrication des diodes et des transistors et interpréter les informations techniques de leurs boîtiers.
- Justifier l’utilisation d’un composant spécifique en se basant sur ses caractéristiques technologiques et son domaine d’application.
3. Approche Pédagogique
La démarche pédagogique est centrée sur l’objet technique. Chaque chapitre est consacré à une famille de composants, en analysant sa structure interne, les matériaux qui le composent, son procédé de fabrication, ses différentes variantes et son conditionnement. L’observation et la manipulation de composants réels sont au cœur de la méthode. Des études de cas, comme la sélection de condensateurs pour un filtre d’alimentation destiné à un équipement médical à l’hôpital de Panzi à Bukavu ou l’analyse des technologies de transistors pour un amplificateur de signal radio à Mbuji-Mayi, permettent d’ancrer les savoirs dans une perspective d’application pratique.
PREMIÈRE PARTIE : TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS PASSIFS RÉSISTIFS 🔩
Cette partie se consacre à l’étude exhaustive du composant le plus fondamental et le plus répandu en électronique : la résistance. L’élève y découvrira que derrière ce simple dipôle se cache une grande diversité de technologies, chacune étant optimisée pour une fonction spécifique. De la simple limitation de courant à la détection de température, la maîtrise de la technologie des résistances est une étape incontournable pour la conception et le dépannage de tout circuit électronique.
CHAPITRE 1 : LES RÉSISTANCES FIXES
1.1. Technologie des résistances à couche de carbone
Ce sous-chapitre décrit le procédé de fabrication des résistances les plus courantes et économiques, où un film de carbone est déposé sur un support en céramique. Leurs caractéristiques (précision moyenne, sensibilité à la température) et leurs domaines d’application privilégiés sont analysés.
1.2. Technologie des résistances à couche métallique
Les résistances à film métallique, qui offrent une bien meilleure précision et stabilité, sont étudiées. Leur procédé de fabrication par dépôt d’un alliage métallique est expliqué, justifiant leur emploi dans les circuits de mesure ou de filtrage de précision.
1.3. Les résistances bobinées
Pour dissiper des puissances importantes, la technologie des résistances bobinées est utilisée. L’élève découvrira leur constitution, basée sur un fil résistif enroulé sur un support en céramique. Leurs avantages (haute puissance) et inconvénients (inductance parasite) sont discutés.
1.4. Le code de marquage des résistances
La lecture de la valeur et de la tolérance d’une résistance à partir de ses anneaux de couleur est une compétence fondamentale. L’élève apprendra à maîtriser le code à 4 et 5 anneaux. Le marquage alphanumérique utilisé sur les résistances à montage en surface (CMS) est également introduit.
CHAPITRE 2 : LES RÉSISTANCES VARIABLES ET AJUSTABLES
2.1. Le potentiomètre : principe et constitution
Le potentiomètre est présenté comme une résistance variable à trois bornes, permettant de recueillir une tension ajustable. Sa constitution (piste résistive et curseur mobile) est détaillée. La différence entre les pistes à variation linéaire et logarithmique est expliquée.
2.2. Technologies des potentiomètres
L’élève étudiera les différentes technologies de pistes résistives : carbone (usage courant), cermet (meilleure stabilité et puissance) et plastique conducteur (très longue durée de vie). Les potentiomètres bobinés pour les applications de puissance sont également décrits.
2.3. Les résistances ajustables (trimmers)
Les résistances ajustables sont des potentiomètres miniatures conçus pour être réglés occasionnellement, souvent pour l’étalonnage d’un circuit. Leurs différents modèles (multitours, monotour) et leurs méthodes de réglage sont présentés.
2.4. Utilisation en résistance variable et en diviseur de tension
Ce sous-chapitre explique les deux modes de branchement d’un potentiomètre : en résistance variable (en utilisant le curseur et une extrémité) pour contrôler un courant, ou en diviseur de tension (en utilisant les trois bornes) pour générer une tension de consigne.
CHAPITRE 3 : LES RÉSISTANCES NON-LINÉAIRES (THERMISTANCES ET VARISTANCES)
3.1. Les thermistances à coefficient de température négatif (CTN)
Les CTN (NTC en anglais) sont des résistances dont la valeur diminue fortement lorsque la température augmente. Leur principe physique et leurs applications pour la mesure de température ou la limitation du courant d’appel sont étudiés.
3.2. Les thermistances à coefficient de température positif (CTP)
Les CTP (PTC en anglais) voient leur résistance augmenter brutalement au-delà d’une certaine température de seuil. Cette propriété est exploitée pour réaliser des fusibles réarmables ou des éléments chauffants autorégulés, par exemple pour maintenir en température un équipement de télécommunication à Kananga.
3.3. Les varistances (VDR)
Les varistances, ou VDR (Voltage Dependent Resistor), sont des résistances dont la valeur chute drastiquement lorsque la tension à leurs bornes dépasse un certain seuil. L’élève comprendra leur rôle crucial dans la protection des circuits contre les surtensions transitoires (foudre, commutation de charges inductives).
3.4. Les photorésistances (LDR)
Les photorésistances (LDR – Light Dependent Resistor) sont des composants dont la résistance diminue en présence de lumière. Leur utilisation comme capteur de luminosité simple dans des applications comme les interrupteurs crépusculaires est expliquée.
DEUXIÈME PARTIE : TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS PASSIFS RÉACTIFS ⚡
Cette partie s’intéresse aux composants capables de stocker et de restituer de l’énergie, soit dans un champ électrique (condensateurs), soit dans un champ magnétique (bobines). Contrairement aux résistances qui dissipent l’énergie, ces composants réactifs ont un comportement qui dépend de la fréquence du signal. L’élève y découvrira la grande diversité technologique de ces dipôles, qui sont au cœur des circuits de filtrage, d’oscillation et d’adaptation d’impédance.
CHAPITRE 4 : LES CONDENSATEURS FIXES
4.1. Constitution et caractéristiques générales
La structure de base d’un condensateur (deux armatures conductrices séparées par un diélectrique isolant) est rappelée. Ses caractéristiques principales (capacité, tension de service, tolérance, coefficient de température) sont définies comme étant les critères de son choix.
4.2. Les condensateurs non-polarisés
Cette famille de condensateurs, qui peut être branchée sans contrainte de polarité, est étudiée. Les technologies des condensateurs céramiques (très courants pour le découplage) et des condensateurs à film plastique (polypropylène, polystyrène, pour l’audio et le filtrage de précision) sont décrites.
4.3. Les condensateurs polarisés
Les condensateurs électrolytiques (chimiques) à l’aluminium et au tantale sont présentés. Leur principal avantage est d’offrir de très fortes capacités dans un volume réduit, ce qui les rend indispensables pour le filtrage des alimentations. Leur inconvénient majeur, la nécessité de respecter une polarité de branchement, est fortement souligné.
4.4. Le marquage des condensateurs
L’élève apprendra à décoder le marquage alphanumérique des condensateurs, qui indique leur capacité (souvent via un code à trois chiffres), leur tolérance et leur tension de service. Les conventions de marquage de la polarité sur les condensateurs électrolytiques sont également étudiées.
CHAPITRE 5 : LES CONDENSATEURS VARIABLES ET AJUSTABLES
5.1. Le condensateur variable à air
Ce type de condensateur, historiquement utilisé pour l’accord des postes de radio, est décrit. Son principe repose sur la modification de la surface de recouvrement entre un jeu d’armatures fixes et un jeu d’armatures mobiles, le diélectrique étant l’air.
5.2. Le condensateur ajustable (trimmer)
Similaire à une résistance ajustable, le condensateur trimmer est un composant miniature destiné à des réglages fins et occasionnels, par exemple pour ajuster la fréquence d’un oscillateur. Ses différentes technologies (céramique, à film) sont présentées.
5.3. La diode Varicap comme condensateur variable
Ce sous-chapitre (enrichissement) fait le lien avec l’électronique générale en rappelant que la diode Varicap, une jonction P-N polarisée en inverse, se comporte comme un condensateur dont la capacité est commandée par une tension. Son avantage est de permettre un réglage électronique sans pièce mobile.
5.4. Applications typiques
L’utilisation des condensateurs variables et ajustables dans les circuits d’accord de fréquence (filtres passe-bande réglables) et les oscillateurs est illustrée par des schémas de principe, montrant comment ils permettent de sélectionner une fréquence de travail précise.
CHAPITRE 6 : LES BOBINAGES ET INDUCTANCES BASSE FRÉQUENCE (BF)
6.1. Constitution d’une inductance
Une inductance, ou bobine, est constituée d’un enroulement de fil conducteur. Ses caractéristiques principales sont définies : l’inductance (L), qui mesure sa capacité à s’opposer aux variations du courant, et la résistance ohmique de son enroulement.
6.2. Bobinages à noyau d’air
Pour les faibles valeurs d’inductance ou les applications en haute fréquence, les bobines peuvent être enroulées « en l’air » ou sur un support isolant. Leur avantage est l’absence de saturation et de pertes dans le noyau.
6.3. Bobinages à noyau de fer
Pour obtenir de fortes inductances en basse fréquence (par exemple pour les filtres d’alimentation), on utilise un noyau en matériau ferromagnétique. L’élève apprendra que ce noyau est feuilleté (constitué de tôles isolées) pour limiter les pertes par courants de Foucault.
6.4. Pertes dans les bobinages
Les sources de pertes dans une bobine sont analysées. Les pertes « cuivre » par effet Joule dans l’enroulement et les pertes « fer » dans le noyau (par hystérésis et par courants de Foucault) sont décrites. L’optimisation d’une bobine consiste à minimiser ces pertes.
CHAPITRE 7 : LES BOBINAGES ET INDUCTANCES HAUTE FRÉQUENCE (HF)
7.1. Contraintes spécifiques à la haute fréquence
En haute fréquence, de nouveaux phénomènes apparaissent. L’effet de peau (le courant ne circule qu’à la surface du conducteur) et l’effet de proximité (interaction entre spires voisines) sont expliqués comme étant des sources de pertes supplémentaires.
7.2. Les noyaux en ferrite
Les ferrites sont des matériaux céramiques magnétiques qui sont de très bons isolants électriques. L’élève comprendra que cette propriété les rend idéaux pour la fabrication de noyaux de bobines HF, car ils canalisent efficacement le flux magnétique tout en supprimant les pertes par courants de Foucault.
7.3. Types d’inductances HF
Différentes technologies d’inductances HF sont présentées : les bobines sur mandrin, les tores de ferrite, et les inductances CMS (à montage en surface) qui peuvent être de technologie bobinée ou multicouche.
7.4. Le blindage des bobinages
Les bobines étant une source de rayonnement électromagnétique, il est souvent nécessaire de les blinder pour éviter qu’elles ne perturbent les circuits voisins. L’utilisation de capots métalliques ou de pots en ferrite pour confiner le champ magnétique est expliquée.
TROISIÈME PARTIE : TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS ÉLECTROMÉCANIQUES ET MAGNÉTIQUES ⚙️
Cette partie se situe à l’interface entre le monde électrique, magnétique et mécanique. Elle étudie des composants qui réalisent une conversion d’énergie ou exploitent des phénomènes physiques couplés. Du transformateur, qui manipule l’énergie via des champs magnétiques, au quartz qui vibre sous l’effet d’une tension, en passant par le relais qui commande un circuit de puissance via un mouvement mécanique, ces composants sont essentiels dans de très nombreux appareils.
CHAPITRE 8 : LES TRANSFORMATEURS D’ALIMENTATION ET BASSE FRÉQUENCE
8.1. Constitution d’un transformateur
La structure d’un transformateur est détaillée : un circuit magnétique fermé (noyau), un enroulement primaire (qui reçoit l’énergie) et un ou plusieurs enroulements secondaires (qui la délivrent). Les différents types de noyaux (en C, en E/I) sont décrits.
8.2. Les tôles magnétiques
Le noyau des transformateurs BF est constitué d’un empilement de tôles minces en fer-silicium. L’élève apprendra que l’orientation des grains du matériau et l’isolation entre les tôles sont optimisées pour minimiser les pertes fer et le bruit magnétique.
8.3. Les fils et isolants
Le choix du fil de bobinage (cuivre émaillé) et des isolants inter-couches (papier, film plastique) est crucial pour garantir la fiabilité et la sécurité du transformateur. La notion de classe d’isolation thermique est introduite.
8.4. Procédés de montage
Les étapes de fabrication d’un transformateur sont décrites : le bobinage des enroulements sur un mandrin, l’assemblage du circuit magnétique, l’imprégnation sous vide avec un vernis pour assurer la cohésion mécanique et l’isolation, et enfin les tests de sécurité électrique.
CHAPITRE 9 : LE PHÉNOMÈNE DE PIÉZOÉLECTRICITÉ ET LES RÉSONATEURS À QUARTZ
9.1. Le phénomène piézoélectrique
La piézoélectricité est la propriété de certains matériaux cristallins (comme le quartz) de générer une tension lorsqu’ils sont soumis à une contrainte mécanique, et inversement, de se déformer lorsqu’on leur applique une tension. Ce double effet est expliqué.
9.2. Le résonateur à quartz
Un résonateur à quartz est une fine lamelle de quartz taillée avec une très grande précision, sur laquelle sont déposées des électrodes. L’élève découvrira que cette structure possède une fréquence de résonance mécanique extrêmement stable et précise.
9.3. Modèle électrique équivalent
Près de sa fréquence de résonance, un quartz se comporte comme un circuit RLC série de très haute qualité, en parallèle avec la capacité de ses électrodes. Ce modèle électrique équivalent est présenté pour justifier son comportement en circuit.
9.4. Utilisation comme base de temps
Grâce à leur stabilité en fréquence exceptionnelle, les quartz sont utilisés dans tous les oscillateurs de précision qui génèrent les signaux d’horloge pour les microprocesseurs, les montres, ou les fréquences de référence pour les émetteurs radio, comme ceux utilisés par la MONUSCO pour ses communications.
CHAPITRE 10 : LES COMMUTATEURS ET RELAIS ÉLECTROMÉCANIQUES
10.1. Les commutateurs mécaniques
Les commutateurs sont des dispositifs à commande manuelle permettant d’orienter un signal vers différentes voies. Les technologies des commutateurs rotatifs, à glissière ou à levier sont décrites, en insistant sur la nature de leurs contacts (argent, or) qui détermine leur fiabilité.
10.2. Le relais électromécanique : principe et constitution
Le relais est un interrupteur commandé électriquement. Sa constitution est analysée : une bobine qui, lorsqu’elle est alimentée, crée un champ magnétique qui attire une palette mobile, provoquant le basculement d’un ou plusieurs contacts.
10.3. Caractéristiques d’un relais
Les paramètres clés d’un relais sont étudiés : la tension et le courant de commande de la bobine d’une part, et le pouvoir de coupure (tension et courant maximaux) des contacts d’autre part. La distinction entre le circuit de commande et le circuit de puissance est fondamentale.
10.4. Applications et diode de roue libre
L’utilisation principale du relais est l’interfaçage : il permet à un circuit de commande de faible puissance (ex: sortie d’un microcontrôleur) de piloter une charge de forte puissance (moteur, résistance). L’élève apprendra la nécessité d’ajouter une diode de roue libre en parallèle sur la bobine pour protéger le circuit de commande des surtensions.
QUATRIÈME PARTIE : TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS ACTIFS À SEMI-CONDUCTEURS 🖥️
Cette dernière partie est consacrée à la technologie des composants qui sont au fondement de toute l’électronique moderne : les diodes et les transistors. L’élève y découvrira les procédés industriels sophistiqués qui permettent, à partir d’un matériau aussi simple que le sable (silicium), de fabriquer en masse des composants aux propriétés extraordinaires. La connaissance de ces technologies est essentielle pour comprendre les performances et les limites des circuits intégrés contemporains.
CHAPITRE 11 : PROCÉDÉS DE FABRICATION DES DIODES
11.1. La purification du silicium
Le point de départ est le silicium de grade métallurgique, qui est purifié à un niveau extrême (grade électronique) par des procédés comme la méthode de la zone fondue. L’obtention d’un monocristal parfait par le procédé Czochralski est également décrite.
11.2. La création de la jonction P-N
Les deux principales techniques pour créer une jonction sont expliquées. La diffusion consiste à exposer une pastille de silicium à un gaz contenant des impuretés à haute température. L’implantation ionique utilise un accélérateur de particules pour bombarder la surface avec des ions d’impuretés.
11.3. La technologie « Mesa »
Dans cette technique plus ancienne, la jonction est créée sur toute la surface de la pastille, puis les diodes individuelles sont isolées en gravant chimiquement des « mésas » (plateaux), laissant la jonction exposée sur les flancs.
11.4. La technologie « Planaire »
La technologie planaire, universellement utilisée aujourd’hui, est décrite. La jonction est formée sous une couche protectrice de dioxyde de silicium (SiO2), ce qui la rend beaucoup plus fiable et stable. Ce procédé est la base de toute la fabrication des circuits intégrés.
CHAPITRE 12 : CARACTÉRISTIQUES ET MARQUAGE DES DIODES
12.1. Les boîtiers des diodes
Les diodes sont encapsulées dans des boîtiers qui assurent la connexion électrique et la protection mécanique. L’élève découvrira les boîtiers traversants (axiaux, comme les 1N400x) et les boîtiers à montage en surface (CMS), ainsi que les boîtiers de puissance avec semelle métallique pour la dissipation thermique.
12.2. Le marquage des diodes de signal
Le système de marquage des diodes de faible puissance est présenté, notamment la nomenclature JEDEC (commençant par 1N…) et la nomenclature Pro Electron (commençant par B…). Le repérage de la cathode par une bague de couleur est rappelé.
12.3. Lecture d’une fiche technique (Datasheet)
L’élève apprendra à naviguer dans la fiche technique d’une diode pour y trouver les paramètres essentiels : les « Absolute Maximum Ratings » (valeurs à ne jamais dépasser) et les caractéristiques électriques typiques (tension de seuil, courant de fuite, temps de recouvrement inverse).
12.4. Justification des utilisations
En se basant sur les caractéristiques technologiques, l’élève apprendra à justifier le choix d’une diode pour une application. Par exemple, une diode de redressement pour une alimentation 50 Hz à Boma sera choisie pour son fort courant admissible, tandis qu’une diode pour un circuit haute fréquence sera choisie pour son faible temps de commutation.
CHAPITRE 13 : PROCÉDÉS DE FABRICATION DES TRANSISTORS
13.1. Le transistor bipolaire planaire
La fabrication d’un transistor NPN en technologie planaire est décrite comme une succession d’étapes de masquage, de diffusion ou d’implantation pour créer les régions de base, d’émetteur et de collecteur de manière localisée et contrôlée sous une couche d’oxyde.
13.2. Le transistor à effet de champ (MOSFET)
La structure du transistor MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor), le composant le plus fabriqué au monde, est présentée. Son fonctionnement basé sur la création d’un canal de conduction par un champ électrique à travers un isolant de grille très fin est expliqué.
13.3. La photolithographie
La technique de la photolithographie, qui permet de transférer des motifs géométriques microscopiques d’un masque vers la surface de la pastille de silicium, est décrite comme le procédé clé qui a rendu possible la miniaturisation et la fabrication en masse des transistors et des circuits intégrés.
13.4. Vers le circuit intégré
L’élève comprendra que le circuit intégré n’est que la suite logique de la technologie planaire : au lieu de fabriquer un seul transistor, on fabrique simultanément sur la même pastille de silicium des millions de transistors, de diodes, de résistances et de condensateurs, tous interconnectés.
CHAPITRE 14 : CARACTÉRISTIQUES ET MARQUAGE DES TRANSISTORS
14.1. Les boîtiers des transistors
La diversité des boîtiers de transistors est présentée : les boîtiers plastiques pour les faibles puissances (TO-92), les boîtiers de puissance avec une semelle métallique pour le montage sur dissipateur (TO-220, TO-3), et les innombrables boîtiers CMS pour les applications modernes.
14.2. Identification des broches
Une compétence essentielle est l’identification des broches (Émetteur, Base, Collecteur pour un BJT ; Source, Grille, Drain pour un FET). Les conventions de brochage pour les boîtiers les plus courants sont présentées.
14.3. Le marquage des transistors
Le marquage alphanumérique imprimé sur le boîtier est la clé de l’identification. L’élève apprendra à reconnaître les références des constructeurs (ex: 2N2222, BC547, IRF540) pour pouvoir retrouver leur fiche technique.
14.4. Dissipation thermique et refroidisseurs
La puissance maximale qu’un transistor peut dissiper est limitée par sa température de jonction. La nécessité d’utiliser un dissipateur thermique (radiateur) pour évacuer la chaleur des transistors de puissance est expliquée, et les principes de base de son dimensionnement sont introduits.
Annexes
1. Mémento des Familles de Composants
Cette section fournirait une synthèse visuelle sous forme de tableau, classant les composants étudiés par famille (résistances, condensateurs, etc.). Pour chaque composant, son symbole, une photo ou un dessin de son apparence physique et son domaine d’application typique seraient indiqués.
2. Guide de Lecture des Codes de Marquage
Un guide pratique et complet récapitulerait les différents codes de marquage vus dans le cours : le code des couleurs à 4 et 5 bandes pour les résistances, le code alphanumérique pour les condensateurs, et des exemples de décodage pour les semi-conducteurs.
3. Introduction à la Technologie de Montage en Surface (CMS/SMT)
La technologie CMS (Composants Montés en Surface), qui a remplacé la technologie traversante dans la quasi-totalité de l’électronique grand public, serait introduite. Les avantages (miniaturisation, automatisation) et les défis (soudure, réparation) de cette technologie seraient discutés.
4. Glossaire Technologique
Un glossaire définirait de manière claire et concise tous les termes techniques et les acronymes spécifiques à la technologie des composants (par exemple, Diélectrique, Cermet, Ferrite, Piézoélectricité, Photolithographie, etc.), assurant une maîtrise parfaite du vocabulaire professionnel.