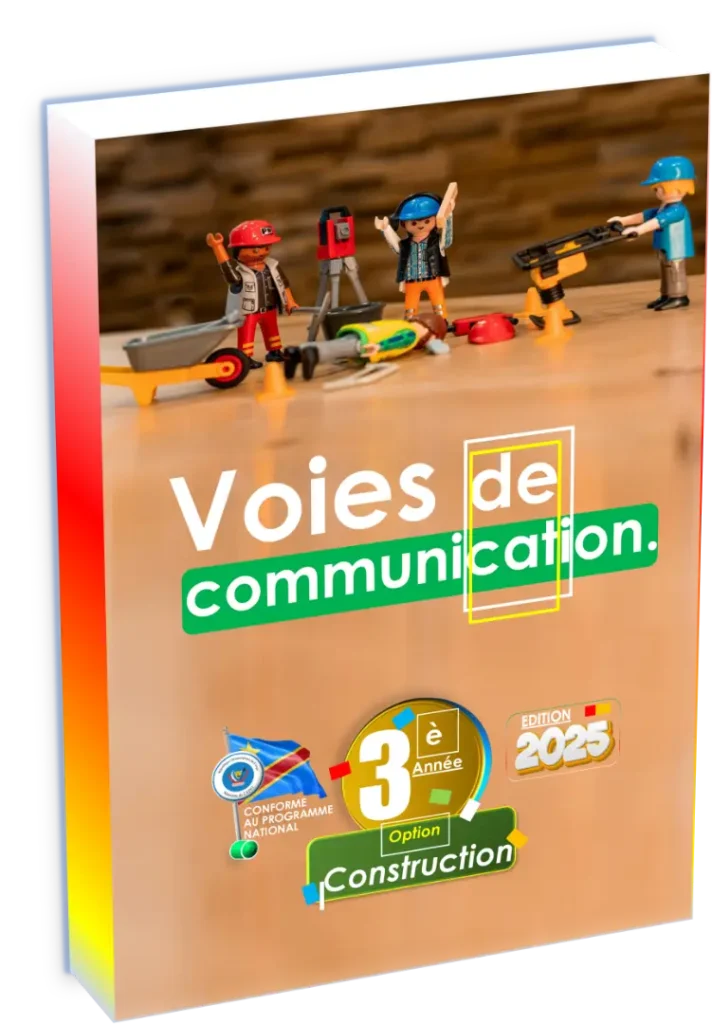
VOIES DE COMMUNICATION
OPTION CONSTRUCTION – 3ÈME ANNÉE
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
Préliminaire
Objectifs du cours
Ce cours de troisième année a pour objectif de rendre l’élève apte à concevoir la géométrie d’un projet routier simple et à en quantifier les terrassements. Dépassant la simple connaissance des éléments, l’ambition est ici de maîtriser les outils de calcul et de dessin du tracé en plan et du profil en long, et surtout, d’appliquer les méthodes de calcul des volumes de déblais et de remblais. La finalité est de former un technicien capable de produire les documents graphiques et les tableaux quantitatifs qui constituent le cœur d’un avant-projet routier. 🛣️
Approche Pédagogique
Centré sur la résolution de problèmes concrets, l’enseignement s’organisera autour de la conception progressive d’un projet routier. Une attention particulière sera portée à la maîtrise des raccordements (circulaires en plan, paraboliques en profil) et à la manipulation des méthodes de calcul de cubatures. L’apogée du cours sera un projet de synthèse individuel, où chaque élève, à partir de données de terrain brutes, devra concevoir son propre tracé, justifier ses choix et produire un dossier complet de mouvement des terres. Cette démarche vise à développer l’autonomie, la rigueur et le sens de l’optimisation économique et technique.
Compétences Visées
Au terme de cette année, l’élève détiendra les compétences suivantes :
- Concevoir : Définir et calculer les éléments géométriques des raccordements en plan (courbes circulaires) et en profil (courbes verticales).
- Calculer : Maîtriser les différentes méthodes de calcul des surfaces de profils en travers et des volumes de terrassement (cubatures).
- Optimiser : Construire et interpréter une épure de mouvement des terres (diagramme de Lalanne) pour organiser et optimiser le transport des déblais et remblais.
- Synthétiser : Mener à bien un projet routier simple, depuis l’analyse des données de nivellement jusqu’à la production des plans et des tableaux de terrassement.
Modalités d’Évaluation
L’évaluation sera principalement axée sur les compétences pratiques de conception et de calcul. Elle comprendra des épreuves de calcul sur les raccordements et les cubatures, ainsi que des exercices de construction et d’interprétation de diagrammes de mouvement des terres. La note finale sera majoritairement basée sur la qualité du projet de synthèse personnel, qui permettra d’évaluer de manière intégrée l’ensemble des compétences acquises durant l’année. 🏗️
Partie I : La Maîtrise du Tracé Géométrique
Cette première partie est consacrée à l’approfondissement de la conception géométrique du tracé en trois dimensions. Elle vise une maîtrise parfaite des techniques de raccordement, tant en plan (virages) qu’en profil (sommets de côte et points bas), qui garantissent la sécurité et le confort de la circulation.
Chapitre 1 : Le Tracé en Plan : Les Raccordements Circulaires
Après une révision des notions de base, ce chapitre explore en détail le calcul et l’implantation des courbes circulaires, qui forment l’essentiel des virages sur les routes conventionnelles.
1.1. Consolidation des Acquis sur le Calcul des Courbes
Une révision approfondie des formules de calcul des éléments géométriques d’une courbe circulaire (tangente, développement, flèche, etc.) est menée pour assurer une maîtrise parfaite des fondamentaux.
1.2. Le Tracé des Courbes et l’Utilisation des Tables
La précision du dessin sur papier est essentielle. L’élève apprend à utiliser les instruments de dessin et les tables de raccordement (type tables de Gaunin) pour une représentation parfaite des courbes.
1.3. Les Méthodes d’Implantation sur le Terrain
La matérialisation de la courbe sur le terrain est abordée, en comparant les méthodes simples (au cordeau) avec les méthodes plus précises (par coordonnées rectangulaires à partir de la tangente).
1.4. Le Cas Particulier de l’Intersection Inaccessible
Lorsque le point de sommet des alignements droits est inaccessible (dans un bâtiment, une rivière), une méthode de calcul spécifique est nécessaire pour déterminer et implanter la courbe. Cette technique est ici étudiée.
Chapitre 2 : Le Tracé du Profil en Long : Les Raccordements Verticaux
Pour assurer une transition douce entre les différentes pentes du projet, des raccordements par des courbes verticales sont indispensables. Ce chapitre se consacre à leur conception.
2.1. La Prise en Compte des Distances de Visibilité et de Freinage
La géométrie des courbes verticales est directement liée à la sécurité. Les notions de distance de visibilité en sommet de côte et de confort en point bas sont introduites, car elles conditionnent le choix du rayon.
2.2. Le Raccordement Circulaire des Pentes
Dans un premier temps, le raccordement est modélisé par un arc de cercle. L’élève apprend à calculer le rayon minimal à adopter en sommet et en creux en fonction de la vitesse de projet.
2.3. L’Implantation du Raccordement Vertical sur le Terrain
Une fois la courbe calculée, ses points doivent être implantés sur le chantier pour guider les engins de terrassement. La méthode de piquetage des points de la courbe est détaillée.
2.4. Introduction aux Raccordements Paraboliques
Pour des raisons de confort et de simplicité de calcul, les raccordements verticaux sont en réalité des paraboles. Le principe de la courbe parabolique et ses avantages sont présentés.
Chapitre 3 : L’Optimisation et la Coordination des Tracés
Un bon projet routier n’est pas une simple succession de lignes et de courbes. C’est le résultat d’une conception tridimensionnelle qui vise à optimiser l’ouvrage sur de multiples critères.
3.1. Le Principe de la Coordination du Tracé
Un tracé en plan et un profil en long doivent être conçus de manière coordonnée pour éviter les configurations défavorables (par exemple, un virage serré en bas d’une forte pente), un enjeu majeur pour les routes sinueuses comme celle reliant Bukavu à Uvira.
3.2. L’Impact du Tracé sur le Drainage et l’Environnement
Le positionnement de la route dans le paysage a des conséquences directes sur l’écoulement des eaux et sur l’écosystème. La recherche du moindre impact est un objectif central de la conception durable.
3.3. L’Optimisation du Tracé pour Minimiser les Terrassements
Un des objectifs principaux du projeteur est de « coller » au mieux au terrain naturel pour minimiser les volumes de déblais et de remblais, qui représentent un coût économique et écologique majeur.
3.4. La Notion de Vitesse de Projet et de Confort de l’Usager
La cohérence du tracé doit garantir à l’usager des conditions de conduite homogènes et confortables. La notion de vitesse de projet (ou vitesse de base) est le fil conducteur de cette recherche de cohérence.
Partie II : L’Analyse et la Gestion des Terrassements
Cette partie constitue le cœur technique de l’année. Elle est entièrement dédiée au calcul des mouvements de terre, depuis la détermination des surfaces de profils jusqu’à la construction de l’épure de Lalanne, l’outil graphique qui permet de visualiser et d’optimiser le transport des matériaux sur le chantier.
Chapitre 4 : Le Calcul des Surfaces de Terrassement
La première étape du calcul des volumes consiste à déterminer, pour chaque profil en travers, la surface de terrain à déblayer et/ou à remblayer.
4.1. Le Calcul de la Surface d’Emprise de la Route
L’emprise, qui est la surface de terrain occupée par l’ensemble de l’ouvrage (chaussée, accotements, fossés, talus), doit être calculée avec précision, notamment pour les procédures d’acquisition foncière.
4.2. La Méthode Graphique de Calcul des Surfaces de Profils
La méthode la plus intuitive pour mesurer la surface d’un profil en travers dessiné sur un plan est l’utilisation d’un planimètre, un instrument de mesure mécanique ou électronique.
4.3. La Méthode Analytique pour les Profils
Une méthode plus rigoureuse consiste à décomposer le profil en figures géométriques simples (triangles, trapèzes) et à en calculer la surface par des formules analytiques, que le profil soit en déblai, en remblai ou mixte.
4.4. La Précision et le Choix de la Méthode de Calcul
La précision requise et les outils disponibles guident le choix entre la méthode graphique, rapide mais moins précise, et la méthode analytique, plus laborieuse mais exacte.
Chapitre 5 : Le Calcul des Volumes (Cubatures)
Une fois les surfaces des profils successifs connues, le calcul du volume de terre entre ces profils, ou cubature, peut être entrepris.
5.1. La Méthode du Prismatoïde pour le Calcul Exact des Volumes
La formule du prismatoïde (ou de Simpson), qui prend en compte la surface à mi-distance entre deux profils, est considérée comme la méthode la plus exacte pour le calcul des volumes.
5.2. La Méthode de l’Aire Moyenne
Une méthode approchée, simple et rapide, consiste à calculer le volume en multipliant la moyenne des surfaces des deux profils extrêmes par la distance qui les sépare.
5.3. La Comparaison Critique des Différentes Méthodes
Les résultats obtenus par les différentes méthodes sont comparés. L’élève apprend à évaluer l’erreur commise par les méthodes approchées et à choisir la méthode la plus pertinente en fonction du stade du projet.
5.4. Le Facteur de Foisonnement des Sols
Lorsqu’un sol est excavé, son volume augmente. Ce phénomène, appelé foisonnement, est quantifié par un coefficient qui doit être pris en compte dans tous les calculs de mouvement des terres.
Chapitre 6 : L’Épure de Mouvement des Terres (Diagramme de Lalanne)
Le diagramme de Lalanne est un outil graphique puissant qui représente le cumul des volumes de déblais et de remblais le long du projet. Son interprétation permet d’optimiser la gestion des terrassements.
6.1. La Construction du Diagramme de Lalanne
L’épure se construit point par point, en reportant en ordonnée le volume cumulé (affecté d’un signe positif pour les remblais et négatif pour les déblais) à chaque abscisse du projet.
6.2. L’Interprétation du Diagramme
La lecture de la forme du diagramme est riche d’enseignements : les zones croissantes correspondent à des remblais, les zones décroissantes à des déblais. Les maxima et minima représentent les points d’inversion.
6.3. La Détermination de la Ligne de Répartition des Transports
Le tracé de lignes horizontales sur le diagramme permet de définir des zones où les déblais et les remblais s’équilibrent. Ces lignes définissent les mouvements de terre à effectuer et leur sens.
6.4. L’Optimisation des Transports à l’Aide du Diagramme
En faisant varier la position de ses lignes de répartition, le projeteur peut utiliser le diagramme pour rechercher la solution de transport qui minimise la distance totale à parcourir, et donc le coût du chantier.
Chapitre 7 : La Gestion Pratique des Transports
À partir des résultats de l’épure, ce chapitre aborde les aspects concrets de l’organisation du transport des terres sur le chantier.
7.1. La Détermination de la Distance Moyenne de Transport
Pour chaque mouvement de terre identifié sur le diagramme, il est possible de calculer la distance moyenne de transport, une donnée essentielle pour l’estimation des coûts.
7.2. Le Choix des Modes de Transport des Terres
En fonction des volumes à déplacer et des distances de transport, le choix des engins sera différent : brouette pour les petits volumes sur de courtes distances, tombereaux pour les grands chantiers routiers comme la route nationale 1.
7.3. Le Tableau Complet du Mouvement des Terres
Toutes les informations issues du diagramme (volumes, distances, sens) sont synthétisées dans un tableau complet du mouvement des terres, qui servira de base à l’organisation du chantier.
7.4. L’Impact Économique d’une Bonne Gestion
Une bonne conception en amont, visant à équilibrer les déblais et remblais et à minimiser les distances de transport, a un impact économique considérable sur le coût final d’un projet routier.
Partie III : Le Projet d’Application Routière
Cette dernière partie est entièrement consacrée à la mise en œuvre de l’ensemble des compétences acquises, à travers un projet de synthèse complet et personnalisé qui simulera une situation professionnelle réelle.
Chapitre 8 : Préparation et Analyse des Données du Projet
La première phase du projet consiste à s’approprier les données d’entrée et à réaliser les documents graphiques de base qui décrivent l’état initial du terrain.
8.1. L’Interprétation d’un Carnet de Nivellement
Le projet démarre avec un carnet de levé topographique brut, contenant les abscisses et les altitudes du terrain naturel le long d’un axe. L’élève doit être capable d’interpréter ces données.
8.2. Le Dessin du Profil en Long du Terrain Naturel
À partir du carnet de nivellement, la première tâche consiste à dessiner à l’échelle le profil en long du terrain naturel, qui servira de base à toute la conception.
8.3. Le Report et le Dessin des Profils en Travers
De la même manière, les profils en travers du terrain naturel sont dessinés pour chaque point du levé, en respectant les échelles et les conventions de représentation.
8.4. L’Analyse des Contraintes Topographiques du Site
Fort de ces documents, l’élève mène une première analyse critique du site, en identifiant les zones à forte pente, les points bas critiques pour le drainage et les contraintes particulières qui guideront sa conception.
Chapitre 9 : Conception et Justification du Projet
La phase de conception est le cœur créatif du projet. Chaque élève devra proposer sa propre « ligne rouge » et la justifier, rendant chaque projet unique.
9.1. Le Choix et le Dessin de la Ligne Rouge
Sur le profil en long du terrain naturel, l’élève doit concevoir et dessiner la ligne de son projet, en respectant les contraintes de pente et en cherchant un équilibre des terrassements.
9.2. La Personnalisation et la Justification des Choix
Chaque élève devra rédiger une note expliquant les raisons de ses choix de conception (pente maximale adoptée, altitude de passage en des points clés, etc.).
9.3. Le Dessin des Profils en Travers « Projet »
Une fois la ligne rouge définie, la géométrie de la route (largeur, dévers, fossés) est superposée sur les profils en travers du terrain naturel pour obtenir les profils « projet ».
9.4. La Conception des Raccordements
Le projet doit intégrer la conception complète des raccordements en plan et en profil, avec le calcul des éléments des courbes et leur représentation sur les plans.
Chapitre 10 : L’Établissement du Dossier de Terrassement
Cette phase du projet est dédiée à la quantification précise des mouvements de terre générés par la conception proposée par l’élève.
10.1. Le Calcul Systématique des Surfaces
À partir des profils en travers projet, l’élève doit calculer, pour chaque profil, la surface de déblai et la surface de remblai, en utilisant la méthode analytique.
10.2. Le Calcul des Volumes entre Profils
En appliquant la méthode de l’aire moyenne ou celle du prismatoïde, les volumes de déblais et de remblais sont calculés entre chaque profil successif.
10.3. L’Établissement du Tableau Complet des Cubatures
Les résultats de ces calculs sont synthétisés dans un tableau complet des cubatures, qui fait apparaître, profil par profil, les surfaces et les volumes de terrassement.
10.4. La Construction du Diagramme de Mouvement des Terres
Point d’orgue du projet, la construction et l’exploitation du diagramme de Lalanne permettront à l’élève d’optimiser le transport des terres et de finaliser son étude.
Annexes
Mémento des Formules de Terrassement
Un recueil des formules essentielles pour le calcul des surfaces de profils (méthode analytique) et des volumes de cubatures (méthode de l’aire moyenne, méthode du prismatoïde) sera fourni. 📈
Exemple de Diagramme de Lalanne Commenté
Un exemple complet de construction et d’interprétation d’une épure de mouvement des terres sera détaillé pas à pas, pour servir de guide méthodologique.
Guide de Présentation d’un Projet Routier
Une fiche rappellera les règles de présentation et les informations à faire figurer sur chaque document du dossier final (plan, profil en long, profils en travers, tableaux).
Lexique Illustré des Terrassements
Un glossaire visuel définira les termes techniques spécifiques aux terrassements (déblai, remblai, foisonnement, cubature, emprunt, dépôt, etc.), pour une parfaite maîtrise du vocabulaire professionnel.



