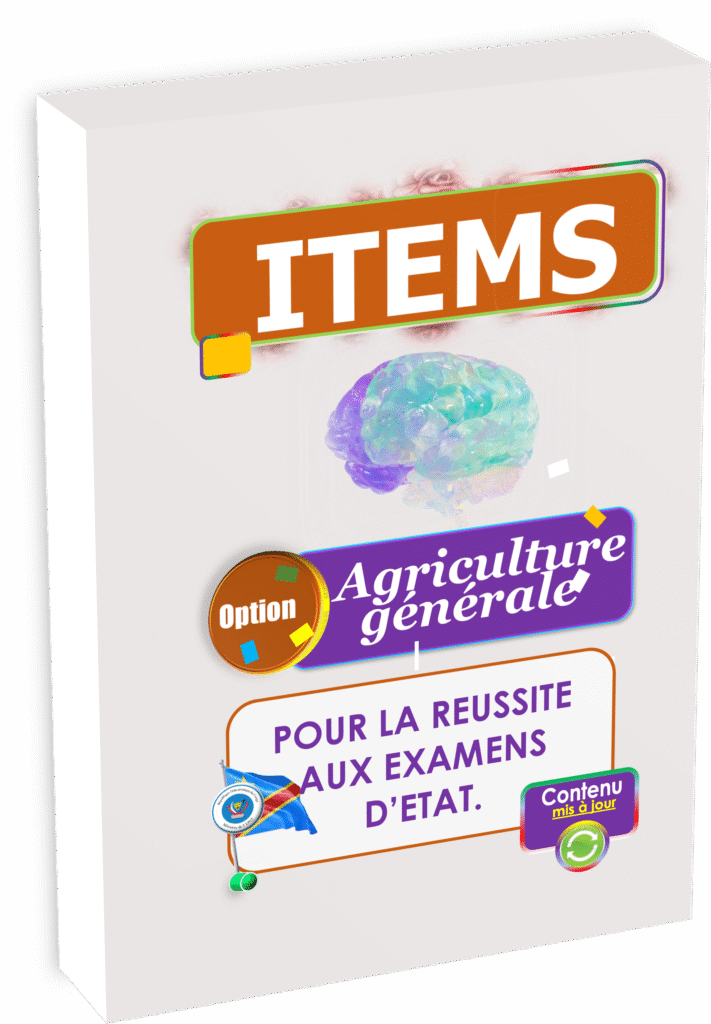
Préliminaire
Présentation du recueil et méthodologie d’utilisation 🎯
Ce recueil est un instrument stratégique de préparation. Sa conception repose sur une analyse approfondie des épreuves de l’examen d’État des dix dernières années, couplée à une expertise agronomique adaptée aux réalités congolaises. L’objectif est de doter chaque finaliste des compétences techniques, des méthodes de raisonnement et de la confiance nécessaires pour exceller. La méthodologie proposée est progressive. Elle se décline en quatre phases distinctes : l’assimilation des savoirs fondamentaux, l’application technique systématique, la résolution de problèmes complexes de synthèse et la simulation en conditions réelles d’examen. Chaque chapitre est structuré pour suivre cette logique, assurant une montée en compétence graduelle et solide. L’élève est encouragé à utiliser la grille d’auto-évaluation initiale pour identifier ses lacunes et à suivre le planning de révision pour organiser son travail sur la durée. Cet outil n’est pas une simple compilation d’exercices ; il s’agit d’un véritable programme d’entraînement, où chaque activité a été pensée pour renforcer une compétence spécifique évaluée à l’examen. L’utilisation rigoureuse de ce guide transformera la préparation en une démarche structurée et assurera une maîtrise complète du programme.
Structure de l’examen d’État en Agriculture Générale 📝
La maîtrise de la structure de l’examen d’État est une condition fondamentale de la réussite. Cette section décortique avec une précision chirurgicale la composition des épreuves, tant théoriques que pratiques. L’analyse porte sur la répartition des points entre les grandes disciplines : l’agronomie générale (pédologie, climatologie), la phytotechnie, la zootechnie et l’économie rurale. Une attention particulière est accordée à la typologie des questions : les questionnaires à choix multiples (QCM) qui testent la connaissance factuelle, les questions à réponse courte qui évaluent la compréhension des concepts, et les problèmes de synthèse qui mesurent la capacité à intégrer des savoirs multiples pour résoudre un cas pratique complexe. Des statistiques issues des sessions précédentes sont présentées pour illustrer la pondération récurrente de chaque matière. Par exemple, il est démontré que les calculs de ration alimentaire en zootechnie et les plans de fertilisation en pédologie représentent un pourcentage significatif et stable de la note finale. Cette section explique également les attentes du jury national concernant la clarté de la rédaction, la justification des calculs et la structuration des réponses. Comprendre ces règles du jeu permet de concentrer les efforts de révision sur les domaines les plus stratégiques et de répondre précisément aux exigences des correcteurs.
Conseils stratégiques pour la préparation 🧠
La préparation à l’examen d’État est un marathon qui exige endurance et stratégie. Cette section fournit des conseils pragmatiques pour optimiser le temps et l’efficacité des révisions. Le premier conseil est de pratiquer activement plutôt que de relire passivement. Il s’agit de consacrer la majorité du temps à la résolution d’exercices et de problèmes. Le deuxième axe stratégique concerne la gestion du temps pendant l’épreuve. Des techniques sont proposées pour allouer un temps précis à chaque partie de l’examen en fonction du barème, commencer par les questions où l’on se sent le plus à l’aise pour construire sa confiance, et ne jamais laisser une question sans réponse, même partielle. Un troisième point crucial est l’importance de la précision technique. Dans les disciplines agricoles, l’exactitude des unités de mesure (kg/ha, UFL, PDI), la maîtrise des formules de calcul (densité de semis, besoin en chaux, etc.) et l’utilisation du vocabulaire agronomique adéquat sont des critères d’évaluation déterminants. Des fiches méthodologiques sont intégrées pour systématiser la résolution de problèmes récurrents, comme l’établissement d’un compte d’exploitation prévisionnel ou la conception d’un calendrier agricole. Enfin, des recommandations sont données sur la manière de surmonter le stress et de maintenir une concentration optimale le jour de l’épreuve.
Grille d’auto-évaluation et planning de révision 📅
L’efficacité de la préparation dépend d’un diagnostic initial précis et d’une planification rigoureuse. Cet outil de départ permet à chaque élève de réaliser un bilan de ses compétences. La grille d’auto-évaluation est structurée selon les grands chapitres du programme national. Pour chaque compétence clé, comme « Calculer une dose de fertilisation NPK » ou « Identifier les symptômes d’une carence en azote sur le maïs », l’élève s’évalue sur une échelle de maîtrise (non acquis, en cours d’acquisition, acquis, maîtrisé). Ce processus d’introspection objective permet de personnaliser le parcours de révision. Une fois les points faibles et les points forts identifiés, le planning de révision type, fourni dans cette section, peut être adapté. Ce planning est un calendrier de travail détaillé sur plusieurs mois, qui répartit la charge de travail de manière équilibrée entre les différentes matières. Il propose une alternance entre l’étude des rappels essentiels, la pratique d’exercices d’application et la résolution de problèmes de synthèse. Le planning intègre également des sessions de révision régulières des chapitres déjà étudiés pour ancrer les connaissances sur le long terme et des simulations d’examen périodiques pour mesurer les progrès. Cet outil transforme l’élève en acteur de sa propre réussite, lui donnant les moyens de piloter sa préparation de manière autonome et stratégique.
PARTIE I : AGRONOMIE GÉNÉRALE
Cette première partie établit le socle fondamental de toutes les sciences agricoles. Elle explore les interactions complexes entre le sol, le climat et la plante. La maîtrise de ces concepts est indispensable, car elle conditionne la réussite de toute intervention agronomique, qu’il s’agisse de productions végétales ou animales. L’aperçu de cette section démontrera comment la connaissance approfondie des sols congolais, des régimes climatiques spécifiques et des bases de la physiologie végétale permet de raisonner avec justesse et de prendre des décisions techniques éclairées, une compétence systématiquement évaluée lors de l’examen d’État.
CHAPITRE 1 : PÉDOLOGIE ET SCIENCES DU SOL 🌍
A. Rappels Essentiels
1.1 Classification des sols de la RDC
La compréhension des grands types de sols présents en République Démocratique du Congo est un prérequis essentiel pour tout futur technicien agronome. Cette section présente une classification pragmatique et directement exploitable des principales unités pédologiques du pays, en insistant sur leurs potentialités et leurs contraintes agronomiques.
- Sols volcaniques jeunes du Kivu (Andosols) : L’étude de ces sols, spécifiquement ceux des territoires de Nyiragongo, Rutshuru, et Masisi, est cruciale en raison de leur exceptionnelle fertilité naturelle. Leur richesse en minéraux et leur excellente structure en font des terroirs de choix pour des cultures à haute valeur ajoutée comme la pomme de terre, le café Arabica ou les cultures maraîchères. La pertinence de ce contexte est que la gestion de ces sols impose des défis uniques : leur forte capacité de rétention du phosphore (fixation phosphorique) nécessite des stratégies de fertilisation spécifiques, un savoir-faire technique directement évaluable.
- Sols ferrallitiques anciens (Ferralsols) : Ces sols couvrent la majeure partie de la cuvette centrale et des plateaux. Un exemple concret est étudié dans la région de Kikwit (province du Kwilu), caractérisée par une agriculture itinérante sur brûlis. Ces sols sont profonds, bien drainés mais chimiquement très pauvres et acides. La contextualisation est ici indispensable : la gestion durable de ces sols passe par des techniques de restauration de la fertilité comme l’agroforesterie (association avec l’Acacia auriculiformis) ou l’apport massif de matière organique, des compétences clés pour assurer la sécurité alimentaire dans ces régions.
- Sols hydromorphes des bas-fonds (Gleysols) : La mise en valeur des bas-fonds est un enjeu stratégique national pour la riziculture. Le cas du périmètre rizicole de Bumba (province de la Mongala), irrigué par les affluents du fleuve Congo, illustre parfaitement les défis techniques. La gestion de l’eau (drainage, irrigation) et la maîtrise de la toxicité ferreuse, un problème chimique spécifique à ces sols saturés en eau, sont des compétences fondamentales abordées ici.
- Sols de savane et forestiers : La distinction entre ces deux types de sols est également abordée, avec des exemples tirés du Haut-Katanga pour les sols de savane, où l’élevage extensif est une activité majeure, et de la province de la Tshopo pour les sols forestiers, où la gestion de la matière organique issue de la litière forestière est un facteur clé de la fertilité.
1.2 Propriétés physico-chimiques
Cette section détaille les propriétés intrinsèques du sol qui déterminent son comportement et sa fertilité. Chaque propriété est expliquée à travers son impact direct sur la production agricole.
- Texture, structure, porosité : La distinction entre ces trois notions est clarifiée. Des exemples concrets sont utilisés : la texture sableuse des sols du littoral près de Moanda (Kongo-Central) explique leur faible rétention en eau et en nutriments, tandis que la structure grumeleuse des sols volcaniques du Kivu favorise l’enracinement et la circulation de l’air et de l’eau.
- pH, capacité d’échange cationique (CEC) : Le pH est présenté comme le « chef d’orchestre » de la chimie du sol. L’acidité élevée des sols ferrallitiques du Kasaï est directement liée à la toxicité aluminique qui bloque la croissance des racines du maïs. La CEC est expliquée comme étant le « garde-manger » du sol. Les sols argileux du Sud-Kivu ont une CEC élevée, leur permettant de stocker des nutriments, contrairement aux sols sableux.
- Matière organique et activité biologique : La matière organique est le moteur de la fertilité du sol. Son rôle triple (chimique, physique, biologique) est illustré. L’importance du maintien d’un taux élevé de matière organique est mise en évidence dans le contexte de l’agriculture biologique maraîchère qui se développe autour des grands centres urbains comme Lubumbashi.
- Facteurs limitants spécifiques à la RDC : Cette partie synthétise les contraintes majeures des sols congolais, telles que la carence généralisée en phosphore, l’acidité, et la faible teneur en matière organique, en liant ces problèmes à des solutions agronomiques concrètes et adaptées.
1.3 Fertilité et nutrition des plantes
La nutrition végétale est au cœur de l’agronomie. Cette section explique comment le sol nourrit la plante et comment l’agriculteur peut gérer cette nutrition pour optimiser les rendements.
- Cycles des éléments nutritifs (N, P, K) : Les cycles de l’azote, du phosphore et du potassium sont présentés de manière schématique et simplifiée, en insistant sur les étapes clés où l’agriculteur peut intervenir. Par exemple, le cycle de l’azote est lié à la pratique de l’association culturale maïs-légumineuse (comme le niébé) dans la région de Kananga, où la légumineuse fixe l’azote atmosphérique et l’enrichit pour le sol.
- Oligo-éléments et carences courantes : Les carences en oligo-éléments comme le zinc ou le bore sont souvent négligées mais peuvent limiter drastiquement les rendements. Les symptômes visuels de ces carences sur des cultures clés (maïs, manioc) sont décrits et illustrés.
- Interactions sol-plante-climat : La fertilité n’est pas qu’une question de chimie. L’interaction entre les propriétés du sol, les besoins de la plante à différents stades de son développement et les conditions climatiques (pluviométrie, température) est expliquée à travers des exemples concrets.
- Indicateurs de fertilité : Des indicateurs simples, observables sur le terrain (couleur du sol, présence de vers de terre, vigueur de la végétation spontanée), sont présentés comme des outils de diagnostic rapide pour l’agriculteur.
1.4 Analyse et diagnostic
Le diagnostic de la fertilité est la première étape de tout plan de gestion agricole raisonné. Cette section fournit les outils méthodologiques pour évaluer un sol.
- Prélèvement et interprétation d’analyses : La méthode correcte pour réaliser un prélèvement d’échantillon de sol en vue d’une analyse en laboratoire est détaillée pas à pas. Plus important encore, cette section apprend à lire et à interpréter un bulletin d’analyse de sol. Un exemple de bulletin d’analyse d’un sol du groupement de Kabare au Sud-Kivu est utilisé pour formuler une recommandation de fumure pour une culture de haricot.
- Méthodes d’évaluation simplifiées : En l’absence de laboratoire, des méthodes de terrain simples sont indispensables. Le test à la bouteille pour déterminer la texture, l’utilisation de papier pH, et l’observation des plantes indicatrices sont expliquées.
- Fiches de terrain et observations : Un modèle de fiche de diagnostic de parcelle est proposé. Il guide l’élève dans la collecte systématique d’informations sur le terrain : historique de la parcelle, topographie, signes d’érosion, symptômes sur les cultures, etc.
B. Exercices d’Application
Série 1 : Calculs de pH et acidité
Cette série d’exercices ancre les concepts théoriques sur l’acidité des sols dans des compétences pratiques et quantifiables. Les 15 exercices proposés sont conçus pour développer une maîtrise parfaite des calculs de correction de l’acidité, une intervention agronomique fondamentale dans de nombreuses régions de la RDC. Les problèmes sont contextualisés pour refléter des scénarios réalistes. Par exemple, un exercice demandera de calculer la quantité de chaux agricole (carbonate de calcium) nécessaire pour remonter le pH de 4,5 à 6,0 sur une parcelle d’un hectare destinée à la culture du maïs dans la province de la Tshopo, où les sols sont notoirement acides. L’énoncé fournira les résultats d’une analyse de sol fictive mais réaliste (pH-eau, acidité d’échange) et la richesse de la chaux disponible sur le marché local de Kisangani. D’autres exercices porteront sur la comparaison de l’efficacité de différents amendements basiques (chaux, dolomie, cendre de bois) et sur le calcul du coût de l’opération de chaulage, intégrant ainsi une dimension économique. Une attention particulière est portée aux sols volcaniques du Kivu. Un exercice spécifique démontrera pourquoi, malgré un pH parfois acceptable, l’application de chaux peut être nécessaire pour contrer la toxicité aluminique élevée, un cas de figure technique qui exige un raisonnement agronomique pointu.
Série 2 : Fertilisation NPK
La maîtrise du calcul des doses d’engrais est une compétence absolument critique pour un technicien agronome et constitue un point central de l’examen d’État. Les 20 exercices de cette série sont progressifs et couvrent toutes les situations possibles. On commence par des calculs simples : déterminer la quantité d’urée (46% N), de superphosphate triple (45% P₂O₅) et de chlorure de potassium (60% K₂O) à apporter pour satisfaire une recommandation de fumure de 120-80-100 pour la culture de la pomme de terre sur les flancs du volcan Nyiragongo. Puis, la complexité augmente en introduisant l’utilisation d’engrais composés (ex: 17-17-17) et en demandant de calculer les compléments nécessaires en engrais simples. Les exercices sont fortement contextualisés. Un cas pratique portera sur la fertilisation du manioc dans le territoire de Mweka (Kasaï), en tenant compte des exportations en nutriments de la culture et des faibles moyens financiers de l’agriculteur, orientant ainsi vers des solutions de fertilisation intégrée (combinaison d’engrais minéraux et de matière organique). Un autre exercice portera sur la conception d’un plan de fumure pour un caféier dans la province de l’Ituri, en distinguant la fumure de fond à la plantation et la fumure d’entretien annuelle. La justification du raisonnement est aussi importante que le résultat final.
Série 3 : Matière organique
Cette série d’exercices se concentre sur la gestion de la fertilité organique des sols, un enjeu majeur pour la durabilité de l’agriculture congolaise. Les exercices ne sont pas de simples calculs, mais des mises en situation pratiques. L’élève devra par exemple calculer la quantité de compost, dont la composition (teneur en N, P, K et matière sèche) est fournie, nécessaire pour couvrir les besoins en phosphore d’une culture de choux sur une planche de 100 m² dans la ceinture maraîchère de Kinshasa. Un autre exercice portera sur l’établissement d’un bilan humique simplifié pour une exploitation de polyculture-élevage dans le Kwango. L’élève devra estimer les pertes en humus dues à la minéralisation et aux exportations des cultures, et calculer les apports nécessaires via le fumier produit par le bétail de la ferme, les résidus de culture laissés sur la parcelle et les apports extérieurs. Des exercices spécifiques sur les techniques de compostage seront également proposés, demandant de calculer le bon ratio Carbone/Azote en mélangeant différentes sources de matière organique disponibles localement (paille de riz, fanes de haricot, déjections de volaille). Ces exercices visent à développer une approche raisonnée et quantitative de la gestion de la matière organique.
Série 4 : Diagnostic terrain
Le but de cette série est de développer le sens de l’observation et la capacité à interpréter les signes visibles sur le terrain pour poser un diagnostic agronomique. Les exercices sont basés sur des descriptions détaillées de parcelles, des photos de profils de sol et des symptômes sur les plantes. L’élève sera mis face à une situation concrète : « Vous visitez une parcelle de maïs dans la plaine de la Ruzizi (Sud-Kivu). Les plantes sont chétives, les feuilles les plus anciennes présentent un jaunissement partant de la pointe et progressant le long de la nervure centrale. Le sol est limono-sableux, de couleur claire. Quel est votre diagnostic le plus probable concernant la nutrition de la plante ? Quelles observations complémentaires feriez-vous pour confirmer votre hypothèse ? Quelles recommandations immédiates donneriez-vous à l’agriculteur ? ». D’autres exercices demanderont de décrire un profil pédologique type d’un sol ferrallitique à partir d’une image, en identifiant les différents horizons et en interprétant leur couleur, leur texture et la présence de concrétions ferrugineuses. Ces exercices forment l’œil du futur technicien à reconnaître les situations sur le terrain et à lier les observations visuelles à des concepts pédologiques précis.
C. Problèmes de Synthèse
Problème 1 : Plan de fertilisation intégré pour une exploitation de 5 ha au Sud-Kivu
Ce problème de synthèse est un cas complexe et réaliste qui demande à l’élève de mobiliser l’ensemble des connaissances et compétences acquises dans le chapitre. Le scénario est le suivant : un agriculteur du territoire de Walungu (Sud-Kivu) exploite 5 hectares sur un sol ferrallitique acide et dégradé. Il cultive du manioc, du haricot, du maïs et possède un petit élevage de 3 vaches laitières. L’énoncé fournit le plan de l’exploitation, les résultats d’une analyse de sol, les rendements actuels des cultures, et les objectifs de l’agriculteur (augmenter ses rendements de 50% en 3 ans). La tâche de l’élève est d’élaborer un plan de fertilisation intégré et durable pour l’ensemble de l’exploitation. Cela inclut :
- Le calcul des besoins en chaux pour corriger l’acidité du sol sur les différentes parcelles.
- L’élaboration d’un plan de production et de gestion du fumier des vaches (compostage) pour maximiser son utilisation comme amendement organique.
- Le calcul des doses de fertilisation minérale (NPK) complémentaires pour chaque culture, en tenant compte des apports du fumier et des besoins spécifiques des plantes.
- La proposition d’un plan de rotation des cultures sur 3 ans qui intègre des légumineuses pour améliorer la fertilité azotée du sol.
- L’établissement d’un budget prévisionnel pour l’achat des intrants (chaux, engrais) et l’estimation du retour sur investissement attendu. Ce problème force l’élève à raisonner à l’échelle de l’exploitation, en intégrant les aspects pédologiques, agronomiques et économiques.
Problème 2 : Restauration de la fertilité après érosion au Nord-Kivu
Ce cas pratique aborde le problème crucial de la dégradation des sols en zone de montagne. Le contexte est celui d’une parcelle de 2 hectares sur une pente de 15% dans le territoire de Masisi (Nord-Kivu), qui a été fortement érodée suite à des cultures successives de pomme de terre sans mesures de conservation. Le sol a perdu son horizon de surface fertile. L’élève doit proposer un plan d’action technique et chiffré pour restaurer la fertilité de cette parcelle. Le travail se décompose en plusieurs étapes :
- Diagnostic de la dégradation : Analyser les signes d’érosion (ravines, sol décapé) et évaluer la perte de fertilité (à partir de données fournies).
- Proposition de mesures anti-érosives : Concevoir un système de lutte contre l’érosion adapté à la situation, par exemple, la mise en place de haies vives de Leucaena ou de Calliandra suivant les courbes de niveau, combinée à une culture en terrasse progressive.
- Plan de réhabilitation de la fertilité du sol : Élaborer un programme intensif d’apports de matière organique (compost, fumier importé) et de culture d’engrais verts (ex: Crotalaria) pour reconstituer l’horizon de surface.
- Choix d’un système de culture de reconversion : Proposer un nouveau système de culture plus durable pour la parcelle une fois restaurée, par exemple, un système agroforestier associant des cultures vivrières et des arbres fruitiers. Ce problème met l’accent sur les techniques de conservation et de restauration des sols, des compétences vitales pour l’agriculture dans les régions montagneuses de l’Est de la RDC.
Problème 3 : Aménagement anti-érosif d’un versant montagneux
Ce problème est une étude de cas à une échelle plus large que la simple parcelle. Il s’agit de proposer un plan d’aménagement pour un petit versant de 10 hectares, occupé par plusieurs exploitations familiales, dans une zone à forte pente près de Bukavu. Le versant souffre d’une érosion hydrique intense qui provoque non seulement une baisse de la productivité agricole mais aussi des risques de glissements de terrain. La mission de l’élève est d’agir en tant que conseiller technique pour la communauté locale. La résolution du problème implique :
- La réalisation d’un zonage du versant en fonction de la pente : identification des zones à très forte pente à reboiser, des zones à pente moyenne pour des cultures en terrasses ou avec des dispositifs anti-érosifs, et des zones de bas de pente pour des cultures plus intensives.
- La conception technique des aménagements : Proposer des schémas précis pour la construction de terrasses progressives, le creusement de fossés anti-érosifs, et l’implantation de bandes enherbées.
- Le choix des espèces végétales à utiliser pour les haies vives, les bandes enherbées et le reboisement, en privilégiant des espèces à la fois efficaces pour la conservation du sol et utiles pour les agriculteurs (fourrage, bois de chauffage, fruits).
- L’élaboration d’un plan de travail communautaire pour la réalisation des aménagements, en estimant les besoins en main-d’œuvre et en proposant un phasage des travaux sur plusieurs saisons. Ce problème teste la capacité de l’élève à penser l’aménagement du territoire de manière intégrée, en combinant des compétences en pédologie, en agronomie et en génie rural.
D. Items Type Examen
30 QCM corrigés sur la pédologie appliquée
Cette section a pour but de familiariser l’élève avec le format des questions à choix multiples, souvent utilisées en examen pour tester rapidement un large éventail de connaissances. Les 30 questions sont soigneusement calibrées pour couvrir tous les points clés du chapitre, de la classification des sols aux calculs de fertilisation. Chaque question est conçue pour être précise et non ambiguë. Par exemple : « Quel est l’effet principal de l’application de chaux sur un sol acide ? (a) Augmenter la teneur en matière organique, (b) Réduire la capacité d’échange cationique, (c) Augmenter la disponibilité du phosphore, (d) Augmenter la compacité du sol ». Chaque QCM est suivi d’une correction détaillée qui non seulement donne la bonne réponse (c), mais explique aussi pourquoi les autres options sont incorrectes. Cette approche renforce l’apprentissage et aide l’élève à comprendre les liens de cause à effet. Les questions sont variées et portent sur des connaissances factuelles, des compréhensions de concepts et des interprétations de données simples.
10 questions de calculs avec barèmes détaillés
Cette partie prépare spécifiquement à la résolution de problèmes quantitatifs, qui représentent une part importante de l’évaluation en pédologie. Les 10 questions sont des exercices courts, similaires à ceux qui peuvent être posés dans une partie « calculs » de l’examen. Elles portent sur des thèmes récurrents : calcul de la quantité d’engrais à appliquer, calcul du besoin en chaux, estimation de la quantité de matière organique à apporter, calcul d’un bilan humique simplifié. Chaque question est accompagnée d’un barème de correction détaillé, identique à celui utilisé par les correcteurs de l’examen d’État. Par exemple, pour un calcul de dose d’engrais, le barème pourrait être : 1 point pour la pose correcte de la formule, 2 points pour l’application numérique sans erreur, 1 point pour l’exactitude du résultat final, et 1 point pour la présence de la bonne unité. Cette transparence sur les critères de notation permet à l’élève de comprendre précisément ce qui est attendu de lui et de développer la rigueur nécessaire dans la présentation de ses calculs.
5 cas d’interprétation d’analyses de sol
Cette dernière section vise à développer une compétence de haut niveau : la capacité à traduire des données de laboratoire en un diagnostic agronomique et des recommandations pratiques. Cinq bulletins d’analyse de sol, provenant de différentes régions agro-écologiques de la RDC (un sol volcanique du Kivu, un sol ferrallitique du Kasaï, un sol sablonneux du Kongo-Central, etc.), sont présentés à l’élève. Pour chaque cas, une série de questions guide l’interprétation :
- Décrivez les principales caractéristiques de ce sol (texture, pH, niveau de matière organique, richesse en N, P, K).
- Quels sont les principaux facteurs limitants et les principaux atouts de ce sol pour l’agriculture ?
- Pour une culture de maïs sur ce sol, quelles seraient vos recommandations en matière de chaulage et de fertilisation NPK ? Justifiez vos propositions par des calculs.
- Quelles autres pratiques culturales recommanderiez-vous pour améliorer durablement la fertilité de ce sol ? Les corrigés sont très détaillés et montrent l’ensemble du raisonnement, depuis la lecture des chiffres bruts de l’analyse jusqu’à la formulation de conseils concrets et chiffrés pour l’agriculteur. Cette compétence de synthèse est particulièrement valorisée lors de l’examen d’État.
CHAPITRE 2 : CLIMATOLOGIE ET BOTANIQUE APPLIQUÉES 🌦️🌿
A. Rappels Essentiels
2.1 Zones agro-climatiques de la RDC
La compréhension des nuances climatiques du territoire national est une compétence fondamentale pour adapter les pratiques agricoles. Cette section va au-delà d’une simple description des climats et présente une classification en grandes zones agro-climatiques, directement utile pour le choix des cultures et des calendriers agricoles.
- La zone équatoriale (type Af) : Caractérisée par une forte pluviométrie (plus de 2000 mm/an) et une faible amplitude thermique, cette zone, qui englobe des villes comme Mbandaka (Équateur), est propice aux cultures pérennes comme le cacaoyer, le palmier à huile ou l’hévéa. La contrainte majeure est l’humidité constante qui favorise le développement des maladies fongiques.
- La zone tropicale humide (type Aw) : Avec une alternance claire entre une saison des pluies et une saison sèche bien marquée, cette zone couvre une grande partie du pays, incluant des régions comme le Kasaï et le Kwango. La pertinence de ce découpage est qu’il conditionne le calendrier agricole des cultures annuelles (maïs, manioc, arachide) et impose le choix de variétés adaptées à la durée de la saison des pluies. Le cas de la double saison agricole dans le Bas-Uele est également étudié.
- La zone de montagne (climat d’altitude) : Les régions de l’Est, comme les environs de Bukavu (Sud-Kivu) et les hauts plateaux de l’Ituri, présentent des conditions climatiques spécifiques dues à l’altitude. Les températures plus fraîches permettent des cultures de zones tempérées (pomme de terre, blé, carotte) et un café Arabica de haute qualité. La contrainte principale est le risque de gel à très haute altitude et la nécessité d’aménagements pour cultiver sur des pentes fortes. Cette classification est illustrée par des diagrammes ombrothermiques de stations météorologiques représentatives (ex: Kinshasa, Lubumbashi, Goma) pour visualiser concrètement les régimes de pluies et de températures.
2.2 Facteurs climatiques limitants
Cette section analyse l’impact de chaque paramètre climatique sur la croissance des plantes et la production agricole.
- La pluviométrie : L’accent est mis sur la répartition des pluies au cours de l’année, qui est plus importante que la quantité totale. Le concept de « poche de sécheresse » en pleine saison des pluies et son impact sur les stades critiques des cultures (ex: floraison du maïs) est expliqué. Des exemples de techniques de gestion de l’eau, comme le paillage pour conserver l’humidité du sol dans la région de Kimpese (Kongo-Central), sont présentés.
- La température : Les notions de températures minimales, optimales et maximales pour la croissance des principales cultures de la RDC sont définies. L’impact des températures élevées sur la fertilité du pollen du haricot est utilisé comme exemple concret.
- Le rayonnement solaire et la photopériode : L’importance de l’ensoleillement pour la photosynthèse est rappelée. La sensibilité de certaines variétés de soja à la photopériode (la durée du jour) est expliquée, ce qui conditionne leur zone d’adaptation en latitude.
- Le vent : Son double rôle, potentiellement bénéfique (pollinisation) ou néfaste (verse des céréales, dissémination de maladies), est analysé.
2.3 Morphologie et physiologie végétale
Il est impossible de cultiver une plante sans comprendre son fonctionnement. Cette section présente les bases de la botanique appliquée, en se concentrant sur les aspects directement utiles pour l’agronome.
- La structure de la plante : Une description morphologique des différentes parties de la plante (racine, tige, feuille, fleur, fruit, graine) est faite, en illustrant chaque organe par des exemples pris sur des plantes d’importance économique en RDC (ex: le système racinaire fasciculé du maïs, la tubérisation du manioc, la floraison du caféier).
- Les grandes fonctions physiologiques : Les processus vitaux de la plante sont expliqués de manière simple et visuelle.
- La photosynthèse : Présentée comme « l’usine » de la plante qui produit du sucre (énergie) à partir de la lumière, de l’eau et du gaz carbonique.
- La respiration : Le processus par lequel la plante consomme cette énergie pour sa croissance et son entretien.
- La transpiration : La « climatisation » de la plante, qui lui permet de réguler sa température et d’absorber l’eau et les nutriments du sol. Le lien entre ces fonctions et les pratiques culturales est constamment souligné. Par exemple, une bonne fertilisation en azote favorise la production de feuilles, qui sont le siège de la photosynthèse, et donc la production globale.
2.4 Cycles de développement
Chaque culture a son propre cycle de vie, et le rôle de l’agriculteur est d’accompagner la plante à chaque étape pour qu’elle exprime son potentiel de rendement.
- Les stades phénologiques : Les différentes étapes du développement d’une plante annuelle type (levée, croissance végétative, floraison, fructification, maturation) sont décrites précisément. L’importance de connaître les besoins spécifiques de la plante à chaque stade (en eau, en nutriments) est mise en avant. Par exemple, un stress hydrique au moment de la floraison du maïs peut avoir des conséquences catastrophiques sur le rendement final.
- Classification des plantes : Les plantes sont classées selon leur cycle de vie (annuelles, bisannuelles, pérennes) et leur famille botanique. Cette classification est importante car les plantes d’une même famille ont souvent des besoins similaires et sont sensibles aux mêmes maladies (ex: les Solanacées comme la tomate, la pomme de terre, l’aubergine). Des exemples locaux sont utilisés pour chaque catégorie.
- La dormance et la germination : Les conditions nécessaires pour une bonne germination (eau, température, oxygène) et les phénomènes de dormance des semences sont expliqués, avec des applications pratiques pour le stockage et la préparation des semences.
B. Exercices d’Application
Calculs de l’Évapotranspiration (ETP) et des besoins en eau des cultures
Cette série d’exercices vise à quantifier les besoins en eau des plantes, une étape essentielle pour la planification de l’irrigation ou l’adaptation des calendriers culturaux. Les exercices initiaux introduisent des formules simplifiées de calcul de l’évapotranspiration potentielle (ETP), comme la formule de Thornthwaite, en utilisant des données climatiques mensuelles (température, pluviométrie) d’une station météorologique, par exemple celle de l’aéroport de Nd’jili à Kinshasa. L’élève apprendra à calculer l’ETP mois par mois. Les exercices suivants montent en complexité. L’élève devra calculer les besoins en eau d’une culture spécifique (ex: une culture de tomate) en multipliant l’ETP par un coefficient cultural (Kc) qui varie en fonction du stade de développement de la plante. Le cœur de la série est le calcul du bilan hydrique. En comparant les besoins en eau de la culture et les apports par la pluie (pluviométrie efficace), l’élève devra identifier les périodes de déficit hydrique et calculer les quantités d’eau d’irrigation à apporter. Un cas pratique portera sur la planification de l’irrigation d’une parcelle maraîchère d’un hectare près de Lubumbashi pendant la saison sèche, en déterminant la fréquence et la dose d’arrosage.
Détermination des cycles culturaux
La réussite d’une culture dépend de sa bonne adéquation avec la durée de la saison favorable. Ces exercices entraînent l’élève à déterminer la durée du cycle de développement d’une culture (du semis à la récolte) en utilisant la notion de « degrés-jours de croissance ». La méthode est la suivante : pour chaque jour, on calcule la température moyenne et on soustrait une température de base (seuil en dessous duquel la plante ne se développe pas). On cumule ces valeurs jour après jour. La culture atteint la maturité quand une somme de degrés-jours spécifique à la variété est atteinte. Un exercice type demandera de calculer la date de récolte probable d’une nouvelle variété de maïs précoce (nécessitant 1200 degrés-jours avec une température de base de 10°C) semée le 15 novembre dans la région de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental), en fournissant les données de températures moyennes mensuelles. D’autres exercices demanderont de comparer la durée du cycle de la même variété si elle était cultivée à différentes altitudes (et donc à différentes températures) dans l’Est de la RDC, démontrant ainsi l’influence directe du climat sur la phénologie des plantes.
Élaboration de calendriers agricoles régionaux
Cette série d’exercices de synthèse demande à l’élève d’intégrer toutes les connaissances acquises sur le climat et la biologie végétale pour construire un outil pratique et essentiel : le calendrier agricole. L’élève se verra attribuer une région spécifique de la RDC, par exemple la province du Lualaba, avec ses données climatiques (diagramme ombrothermique). Il devra ensuite, pour une série de cultures importantes localement (maïs, arachide, manioc), proposer un calendrier agricole détaillé. Ce calendrier devra préciser, mois par mois, les dates optimales pour les différentes opérations culturales : préparation du sol, semis, sarclages, fertilisation d’appoint, et récolte. Le choix de chaque date devra être justifié en se basant sur le régime des pluies (ex: semer juste après les premières pluies significatives pour assurer une bonne levée), les risques climatiques (ex: s’assurer que la floraison n’ait pas lieu pendant la période la plus sèche) et le cycle de développement de la plante. Un exercice plus complexe demandera d’élaborer un calendrier pour un système d’association de cultures (ex: maïs-haricot), en optimisant les dates de semis des deux espèces pour minimiser la compétition et maximiser les bénéfices de l’association.
C. Problèmes de Synthèse
Adaptation variétale aux différentes zones climatiques de la RDC
Ce problème de synthèse met l’élève dans la peau d’un ingénieur agronome travaillant pour un service de recherche et de vulgarisation. La mission est de proposer une stratégie de déploiement de trois nouvelles variétés de manioc, récemment développées par l’INERA (Institut National pour l’Étude et la Recherche Agronomiques). L’énoncé fournit les caractéristiques de chaque variété :
- Variété A : Cycle court (9 mois), très productive mais sensible à la sécheresse.
- Variété B : Cycle long (15 mois), très résistante à la sécheresse et aux maladies, mais moins productive.
- Variété C : Cycle intermédiaire (12 mois), adaptée aux conditions d’altitude, résistante aux basses températures nocturnes. L’élève doit produire une note technique argumentée qui :
- Identifie les zones agro-climatiques de la RDC les plus appropriées pour chaque variété. Par exemple, la variété A serait recommandée pour les zones à double saison des pluies courtes comme le Bas-Uele, la variété B pour les zones à longue et sévère saison sèche comme le Tanganyika, et la variété C pour les hauts plateaux du Sud-Kivu.
- Justifie ces choix en se basant sur les caractéristiques des variétés (cycle, résistance à la sécheresse) et les contraintes climatiques de chaque zone (durée de la saison des pluies, températures).
- Propose un calendrier cultural (période de plantation et de récolte) pour chaque variété dans sa zone de recommandation. Ce problème teste la capacité de l’élève à faire le lien entre le matériel végétal (la variété) et son environnement (le climat) pour prendre une décision stratégique.
Gestion des risques climatiques dans une exploitation
Ce cas pratique place l’élève en situation de conseiller un agriculteur qui souhaite sécuriser sa production face aux aléas climatiques de plus en plus fréquents. Le contexte est une exploitation de polyculture-élevage de 10 hectares dans la province du Haut-Lomami, une région soumise à des pluies de plus en plus irrégulières et à des épisodes de sécheresse. L’élève doit élaborer un plan de gestion des risques climatiques pour cette ferme. Le plan devra comporter plusieurs volets :
- Analyse des risques : Identifier les principaux risques climatiques pour l’exploitation (démarrage tardif de la saison des pluies, « poches de sécheresse », pluies violentes provoquant l’érosion) et évaluer leur impact potentiel sur les cultures (maïs, sorgho) et l’élevage.
- Stratégies d’adaptation agronomique : Proposer un ensemble de techniques pour réduire la vulnérabilité de l’exploitation. Cela pourrait inclure :
- La diversification des cultures en introduisant des espèces plus résistantes à la sécheresse comme le sorgho ou le niébé.
- Le choix de variétés de maïs à cycle plus court pour « échapper » à la sécheresse de fin de saison.
- L’adoption de pratiques de conservation de l’eau et des sols (CES) comme le zaï (une technique de plantation en poquets qui concentre l’eau et la fertilité) ou l’agroforesterie (plantation d’arbres dans les parcelles).
- La mise en place d’un petit système de collecte des eaux de ruissellement pour une irrigation d’appoint.
- Stratégies économiques : Suggérer des mesures pour lisser les revenus de l’agriculteur, comme le développement d’une activité de transformation post-récolte ou la souscription à une assurance agricole si elle est disponible. Ce problème exige une vision intégrée et créative pour construire des systèmes agricoles plus résilients.
D. Items Type Examen
QCM sur la climatologie et la botanique
Cette série de questions à choix multiples est conçue pour vérifier la maîtrise des concepts et du vocabulaire technique du chapitre. Les questions portent sur des points précis mais fondamentaux. Exemples de questions : « Lequel de ces processus physiologiques est principalement responsable de l’absorption de l’eau et des minéraux par les racines ? (a) Photosynthèse, (b) Respiration, (c) Transpiration, (d) Germination ». Ou encore : « Dans une zone climatique de type Aw selon la classification de Köppen, la principale caractéristique est : (a) Des pluies abondantes toute l’année, (b) Une saison sèche et une saison des pluies distinctes, (c) Des températures basses dues à l’altitude, (d) Une forte humidité et un faible ensoleillement ». Chaque question est accompagnée d’un corrigé qui explique la bonne réponse (respectivement (c) et (b)) et clarifie les concepts associés, assurant ainsi une révision efficace et ciblée des connaissances essentielles requises pour l’examen.
Cas pratiques sur l’adaptation des cultures
Cette section propose des mini-problèmes qui simulent le type de questions de synthèse courtes que l’on retrouve à l’examen. Ces cas pratiques exigent l’application des connaissances à une situation concrète. Par exemple : « Un agriculteur de la région de Gemena (Sud-Ubangi) souhaite introduire la culture du soja. Le climat local est de type tropical humide avec une saison des pluies de 8 mois. On lui propose deux variétés : une variété sensible à la photopériode (fleurit quand les jours raccourcissent) et une variété insensible. Laquelle lui conseilleriez-vous de semer en début de saison des pluies ? Justifiez votre réponse. » Le corrigé détaillé expliquerait que la variété insensible est préférable, car la variété sensible semée en début de saison des pluies (jours longs) aurait une croissance végétative excessive au détriment de la production de gousses. Un autre cas pourrait demander de justifier le choix d’une date de semis pour le haricot dans la région de Goma en fonction des risques de pluies excessives au moment de la floraison et des risques de sécheresse en fin de cycle. Ces exercices développent la capacité de raisonnement agro-climatique, une compétence clé pour le futur technicien.
PARTIE II : PHYTOTECHNIE – PRODUCTIONS VÉGÉTALES
Cette deuxième partie est le cœur du métier d’agronome. Elle aborde de manière concrète et technique la conduite des principales productions végétales de la RDC. L’objectif est de fournir aux élèves les savoir-faire pratiques, ou « itinéraires techniques », pour chaque grande culture. De la préparation du sol à la récolte, chaque étape est détaillée. L’aperçu de cette section montrera comment le recueil transforme les connaissances théoriques en compétences directement applicables, en se basant sur des calculs précis, des choix techniques justifiés et une adaptation constante aux contextes agro-écologiques variés du pays, préparant ainsi les élèves aux questions pratiques et quantitatives de l’examen.
CHAPITRE 3 : CULTURES VIVRIÈRES 🌱
A. Rappels Essentiels
3.1 Manioc
Le manioc est la culture vivrière la plus importante en RDC, la base de l’alimentation de millions de personnes. Cette section synthétise les connaissances indispensables pour sa production.
- Variétés recommandées en RDC : Une présentation des variétés améliorées et vulgarisées par l’INERA est faite, en insistant sur leurs caractéristiques agronomiques. Par exemple, la variété Zizila est mise en avant pour sa haute teneur en matière sèche, idéale pour la production de « fufu », tandis que la variété M’vuazi est reconnue pour sa résistance à la redoutable maladie de la mosaïque. Le choix variétal est contextualisé : dans une zone à forte pression de la striure brune comme la province du Bas-Uele, le choix d’une variété tolérante est une décision stratégique qui conditionne la réussite de la culture.
- Techniques culturales adaptées : L’itinéraire technique complet est décrit, depuis le choix et la préparation des boutures jusqu’à la récolte. Des points techniques précis sont abordés, comme l’importance de planter sur billons ou buttes dans les zones à fort risque d’excès d’eau, une pratique courante dans la Cuvette centrale. Les densités de plantation optimales (généralement 10 000 plants/ha, soit un écartement de 1m x 1m) sont justifiées.
- Lutte contre la mosaïque et autres maladies : Un focus particulier est mis sur la reconnaissance des symptômes des principales maladies (mosaïque, striure brune, bactériose) et des ravageurs (cochenille farineuse). La méthode de lutte intégrée est privilégiée, combinant le choix de variétés résistantes, l’utilisation de boutures saines (issues de champs « propres ») et le contrôle biologique lorsque cela est possible. L’importance de la surveillance des parcelles pour une détection précoce est soulignée.
3.2 Maïs
Le maïs est la principale céréale cultivée en RDC, essentielle pour la sécurité alimentaire et l’alimentation du bétail.
- Variétés précoces et tardives : La distinction entre les variétés à cycle court (90-100 jours) et les variétés à cycle long (120-130 jours) est fondamentale. Ce choix dépend de la durée de la saison des pluies. Dans la région de Kaniama (Haut-Lomami), où la saison des pluies est relativement courte, une variété précoce est indispensable pour sécuriser la récolte. À l’inverse, dans des zones à pluviométrie plus longue, une variété tardive peut exprimer un potentiel de rendement supérieur.
- Itinéraires techniques par zone : La conduite du maïs varie selon les régions. La section détaille les spécificités, par exemple, la nécessité d’une fertilisation azotée plus importante dans le « triangle du maïs » du Grand Katanga pour atteindre des rendements élevés, par rapport à une culture plus extensive dans d’autres provinces.
- Densités optimales et écartements : Le calcul de la densité de semis est une compétence de base. La section explique comment atteindre une densité de 40 000 à 50 000 plants/ha, en jouant sur l’écartement entre les lignes (ex: 80 cm) et l’écartement entre les poquets sur la ligne (ex: 50 cm avec 2 graines par poquet, puis démariage à 1 plant). L’impact de la densité sur la taille des épis et le rendement final est discuté.
3.3 Riz
La culture du riz, en particulier le riz irrigué de bas-fond, représente un potentiel immense pour réduire la dépendance de la RDC aux importations.
- Systèmes pluvial et irrigué : Les deux principaux modes de culture sont décrits. Le riz pluvial, cultivé sur les pentes comme une culture sèche, est courant mais peu productif. Le focus est mis sur le riz irrigué, qui offre des rendements bien supérieurs. La gestion de l’eau dans une rizière (mise en eau, maintien d’une lame d’eau, assèchement avant la récolte) est expliquée en détail.
- Aménagement des bas-fonds : La transformation d’un bas-fond marécageux en rizière aménagée est une opération technique complexe. Les étapes clés sont présentées : défrichage, dessouchage, confection des diguettes, et surtout, le planage de la parcelle pour assurer une répartition uniforme de l’eau, une condition indispensable pour la maîtrise des adventices et la croissance homogène du riz. L’exemple des périmètres rizicoles de la plaine de la Ruzizi est utilisé pour illustrer ces techniques.
- Variétés adaptées : Le choix des variétés (ex: variétés de l’IRRI – Institut International de Recherche sur le Riz) dépend du système de culture et des préférences locales. Des variétés à paille courte sont recommandées pour le système intensif irrigué afin d’éviter la verse (la tige qui se couche).
3.4 Légumineuses alimentaires
Les légumineuses jouent un rôle crucial dans l’alimentation pour leur richesse en protéines et dans l’agriculture pour leur capacité à améliorer la fertilité du sol.
- Haricot, arachide, niébé : Les itinéraires techniques de ces trois légumineuses majeures sont présentés. Pour le haricot, l’accent est mis sur la distinction entre les variétés naines et les variétés volubiles (grimpantes), ces dernières nécessitant un tuteurage mais étant souvent plus productives en altitude dans le Kivu. Pour l’arachide, la technique du buttage, qui favorise la pénétration des gynophores dans le sol pour former les gousses, est expliquée.
- Associations culturales : C’est une pratique centrale de l’agriculture africaine. L’association maïs-haricot ou manioc-arachide est analysée sous l’angle agronomique. Les avantages sont multiples : optimisation de l’utilisation de l’espace, réduction des risques, et surtout, bénéfice de la fixation d’azote par la légumineuse pour la culture associée.
- Fixation d’azote et rotations : Le processus symbiotique de fixation de l’azote atmosphérique par les bactéries (Rhizobium) présentes dans les nodosités des racines des légumineuses est expliqué. L’importance d’intégrer une légumineuse dans une rotation culturale est démontrée : une culture de maïs qui suit une culture d’arachide bénéficiera de l’azote laissé dans le sol, ce qui permet de réduire les besoins en engrais azotés.
B. Exercices d’Application
Série 1 : Calculs de densités et d’écartements
Cette série de 25 exercices est entièrement dédiée à la maîtrise des calculs de peuplement, une compétence quantitative fondamentale et systématiquement évaluée. Les exercices sont variés et progressifs.
- Calculs de base : « Pour une culture de maïs, vous visez une densité de 50 000 plants/ha. Si l’écartement entre les lignes est de 80 cm, quel doit être l’écartement entre les plants sur la ligne ? ».
- Calculs inverses : « Un agriculteur a semé du haricot avec un écartement de 50 cm x 20 cm. Quelle est la densité de plantation à l’hectare ? ».
- Calculs intégrant des paramètres réels : Les exercices suivants ajoutent des contraintes pratiques. L’élève devra calculer la quantité de semences (en kg) nécessaire pour emblaver une parcelle de 2,5 hectares, en tenant compte de la densité visée, du poids de mille grains (PMG) de la variété utilisée, et d’un taux de germination de 90%. Ce type de calcul est indispensable pour la planification d’une campagne agricole.
- Contextualisation et optimisation : Des cas spécifiques sont proposés. Par exemple, calculer la densité de plantation optimale pour des boutures de manioc dans le territoire de Gandajika (Lomami), en justifiant pourquoi une densité plus faible pourrait être préférable sur des sols pauvres pour limiter la compétition entre les plants. Un autre exercice portera sur l’optimisation de l’arrangement spatial dans une association maïs-légumineuse, en calculant les densités respectives de chaque culture.
Série 2 : Planification culturale
La réussite en agriculture est une question d’anticipation. Cette série d’exercices entraîne à la planification des opérations au cours d’une campagne agricole.
- Rotations et associations : L’élève sera mis face à une situation de départ (ex: une exploitation de 4 hectares avec 4 parcelles) et devra proposer un plan de rotation des cultures sur 4 ans, en justifiant ses choix. Les principes de la rotation devront être appliqués : ne pas faire succéder deux cultures de la même famille botanique, alterner les cultures exigeantes (maïs) et les cultures améliorantes (légumineuses), etc. Un autre exercice demandera de dessiner le schéma d’une association culturale (ex: manioc-niébé) et d’expliquer son intérêt agronomique.
- Calendriers de travaux : Pour une culture donnée (ex: l’arachide) dans une région précise (ex: le Kwango), l’élève devra établir un calendrier cultural détaillé, listant toutes les opérations du labour à la récolte, en précisant les dates ou périodes d’intervention et les ressources nécessaires (main d’œuvre, intrants).
- Gestion de la main-d’œuvre : Un exercice plus complexe demandera d’estimer les besoins en main-d’œuvre (en journées-homme) pour la conduite d’un hectare de riz irrigué, en se basant sur des temps de travaux unitaires fournis (ex: repiquage = 30 JH/ha, sarclage = 20 JH/ha). L’élève devra identifier les « pics de travail » et proposer des solutions pour gérer ces périodes de forte demande en main-d’œuvre.
Série 3 : Calculs de rendements et de production
Cette série est axée sur l’évaluation de la performance d’une culture. Elle apprend à l’élève à manipuler les chiffres de production, une compétence clé pour le diagnostic et le conseil agricole.
- Calculs de rendement : Les exercices de base consistent à calculer le rendement d’une parcelle en tonnes par hectare. « Sur une parcelle de 0,5 ha de manioc, un agriculteur a récolté 8 tonnes de racines tubéreuses. Quel est le rendement ? ».
- Estimation pré-récolte : Des exercices plus techniques apprennent à estimer le rendement avant la récolte. Pour le maïs, par exemple, l’élève devra estimer le rendement final en se basant sur un comptage réalisé sur une placette de 10 m² : nombre de pieds, nombre d’épis par pied, nombre moyen de grains par épi, et poids de mille grains (PMG). Cette méthode est utilisée par les experts pour les prévisions de récolte.
- Analyse des facteurs limitants : Un exercice comparera le rendement réel obtenu par un agriculteur et le rendement potentiel de la variété dans la région. L’élève devra ensuite analyser un ensemble d’informations sur l’itinéraire technique appliqué par l’agriculteur (date de semis, fertilisation, désherbage) pour identifier les facteurs qui expliquent l’écart de rendement et proposer des pistes d’amélioration. Par exemple, un semis tardif dans la région de Kikwit peut entraîner une baisse de rendement de 30% à cause du stress hydrique en fin de cycle.
C. Problèmes de Synthèse
Problème 1 : Gestion d’une exploitation familiale de 3 ha à Bandundu
Ce problème de synthèse est un cas d’étude complet qui plonge l’élève dans la réalité d’une petite exploitation agricole dans la province du Kwilu. Le scénario est le suivant : une famille dispose de 3 hectares de terres sur un sol sablonneux et acide. Elle souhaite organiser sa production pour assurer son autosuffisance alimentaire (manioc, maïs, niébé) et dégager un surplus commercialisable. L’élève, en tant que conseiller agricole, doit élaborer un plan de gestion pour cette exploitation. Sa réponse doit être structurée et inclure :
- Un plan d’assolement : Proposer une répartition des 3 hectares entre les différentes cultures et une jachère améliorée (ex: avec Mucuna), en justifiant les surfaces allouées en fonction des besoins alimentaires de la famille et des potentiels de marché.
- Un plan de rotation sur 5 ans : Concevoir une succession logique des cultures sur chaque parcelle pour gérer durablement la fertilité du sol.
- Un itinéraire technique détaillé pour la culture principale (le manioc) : Préciser le choix de la variété, la préparation du sol, la méthode de plantation, la densité, le plan de fertilisation (en combinant organique et minéral), le calendrier de sarclage et la période de récolte.
- Un calendrier agricole global pour l’ensemble des activités de l’exploitation sur une année.
- Une estimation simplifiée du rendement attendu et du revenu potentiel généré par la vente des surplus.
Problème 2 : Intensification de la riziculture dans un bas-fond de l’Équateur
Ce problème se concentre sur un enjeu technique spécifique : la mise en valeur des bas-fonds pour la production de riz. Le contexte est celui d’un groupement de paysans près de Mbandaka qui souhaite aménager un bas-fond de 5 hectares pour y pratiquer une riziculture irriguée intensive. La tâche de l’élève est de rédiger un dossier technique pour ce projet. Le dossier doit comprendre :
- Un plan d’aménagement du bas-fond : Proposer un schéma simple d’aménagement avec des diguettes, des canaux d’irrigation et de drainage, et expliquer les étapes techniques pour la réalisation de ces aménagements, en particulier le planage.
- Un itinéraire technique complet pour la production de riz :
- Choix d’une variété améliorée à haut rendement.
- Conduite de la pépinière (calcul de la surface, préparation du sol, densité de semis).
- Préparation des casiers rizicoles (labour, hersage).
- Repiquage (âge des plants, écartement).
- Gestion de l’eau (calendrier d’irrigation).
- Plan de fertilisation NPK raisonné.
- Stratégie de désherbage.
- Un calcul du rendement prévisionnel et une comparaison avec le rendement actuel du riz pluvial dans la région pour démontrer l’intérêt de l’intensification.
Problème 3 : Conception d’un système de rotation manioc-légumineuses au Kasaï
Ce problème est axé sur la gestion de la fertilité des sols dans une des régions les plus critiques de la RDC en matière de sécurité alimentaire. Le contexte est celui de la province du Kasaï-Oriental, où les sols sont très pauvres et l’agriculture est dominée par la monoculture de manioc. L’élève doit proposer à un agriculteur un système de culture alternatif, plus durable, basé sur une rotation entre le manioc et des légumineuses. Sa proposition doit être techniquement détaillée :
- Choix des légumineuses : Justifier le choix de deux légumineuses adaptées au contexte local, par exemple le niébé (pour l’alimentation) et le pois d’Angole (pour sa résistance à la sécheresse et sa capacité à produire de la biomasse).
- Description du cycle de rotation sur 3 ans : Proposer une séquence culturale, par exemple : Année 1 = Pois d’Angole (pour restaurer la fertilité), Année 2 = Manioc, Année 3 = Niébé en association avec quelques pieds de manioc.
- Explication des bénéfices agronomiques : Détailler les avantages attendus de cette rotation : l’enrichissement du sol en azote grâce aux légumineuses, la rupture du cycle des maladies et ravageurs du manioc, l’amélioration de la structure du sol grâce à la biomasse du pois d’Angole.
- Itinéraire technique spécifique pour l’année 1 (culture du pois d’Angole) : Expliquer comment semer, gérer et enfouir cette culture pour en maximiser les bénéfices en tant qu’engrais vert.
D. Items Type Examen
Itinéraires techniques complets à rédiger
Cette section simule une question d’examen très courante qui demande à l’élève de restituer de manière structurée l’ensemble des opérations pour la conduite d’une culture. L’énoncé est direct : « Décrivez de manière détaillée l’itinéraire technique complet de la culture du maïs dans la région de Lubumbashi, du choix de la parcelle à la récolte. Vous préciserez pour chaque étape les normes techniques à respecter (dates, densités, doses, etc.). » Pour répondre, l’élève devra rédiger un texte organisé en paragraphes, chacun correspondant à une étape clé :
- Choix et préparation de la parcelle (labour, hersage).
- Choix de la variété et traitement des semences.
- Semis (date, écartement, profondeur).
- Fertilisation (fumure de fond, fumure de couverture).
- Entretien (démariage, sarclage, buttage).
- Lutte contre les principaux ravageurs (ex: la chenille légionnaire d’automne).
- Récolte (stade optimal, méthode). Le corrigé propose un modèle de rédaction, montrant comment articuler les différentes étapes de manière logique et précise, en utilisant le vocabulaire technique approprié.
Calculs technico-économiques
L’examen d’État inclut souvent des questions qui mêlent des aspects techniques et économiques. Cette section prépare à ce type d’évaluation. Un cas typique serait : « Un agriculteur souhaite cultiver 1 hectare de haricot. Les semences coûtent X le sac de 50 kg. Il faut 80 kg de semences et 150 kg d’engrais NPK par hectare. La main d’œuvre pour le semis et l’entretien est estimée à 50 journées-homme, payées Z le kg. » L’élève devra :
- Calculer le coût total de production en additionnant les charges (semences, engrais, main d’œuvre).
- Calculer le chiffre d’affaires (la production totale en kg multipliée par le prix de vente).
- Calculer la marge brute (chiffre d’affaires – coût de production). Ce type d’exercice teste à la fois la capacité à réaliser des calculs agronomiques de base (besoins en intrants) et des calculs de gestion simples, reflétant la double compétence attendue d’un technicien.
CHAPITRE 4 : CULTURES DE RENTE ET MARAÎCHAGE 💰🥕
A. Rappels Essentiels
4.1 Café arabica et robusta
Le café est l’une des principales cultures d’exportation de la RDC, avec un potentiel de qualité reconnu mondialement. Cette section couvre les aspects essentiels de sa culture.
- Différenciation Arabica/Robusta : Les deux espèces sont clairement distinguées. Le Robusta, cultivé en basse altitude dans des zones comme la province de l’Équateur, est plus rustique et riche en caféine. L’Arabica, plus fin et aromatique, est une culture de haute altitude (plus de 1200 m), ce qui explique sa concentration dans les montagnes du Kivu et de l’Ituri. Cette contextualisation géographique est fondamentale, car les exigences écologiques et les itinéraires techniques des deux espèces sont radicalement différents.
- Installation d’une plantation : Les étapes clés sont décrites : production de plants en pépinière, piquetage de la parcelle, trouaison, et plantation. L’importance des arbres d’ombrage dans le système de culture est soulignée, non seulement pour protéger les caféiers d’un ensoleillement excessif mais aussi pour améliorer la fertilité du sol et la biodiversité.
- Entretien et taille : La conduite d’une caféière est un travail de long terme. Les différentes opérations d’entretien sont expliquées : désherbage, fertilisation, et surtout la taille. Les objectifs de la taille (formation de la charpente, régénération des rameaux productifs, limitation de la hauteur) et les différentes techniques (taille en « candelabre », recepage) sont détaillés.
- Récolte et traitement post-récolte : La qualité du café se joue aussi après la cueillette. La distinction entre la « voie sèche » (séchage direct des cerises) et la « voie humide » (dépulpage, fermentation, lavage, séchage), cette dernière permettant d’obtenir des cafés « lavés » de meilleure qualité, est expliquée.
4.2 Cacao
Le cacao est une autre culture de rente importante, particulièrement dans la cuvette centrale.
- Exigences écologiques : Le cacaoyer est une plante de sous-bois de la forêt équatoriale. Ses besoins en climat chaud et humide et en ombrage sont précisés, ce qui justifie sa localisation dans des provinces comme la Tshopo ou la Mongala.
- Conduite de la cacaoyère : L’itinéraire technique est présenté, de la pépinière à la plantation, avec un accent sur la gestion de l’ombrage (ombrage temporaire les premières années, puis ombrage définitif).
- Récolte et traitement : Les étapes post-récolte sont cruciales pour le développement des précurseurs d’arômes du chocolat. L’écabossage (ouverture des cabosses), la fermentation en caisses (une étape biochimique complexe) et le séchage des fèves sont décrits en détail. La lutte contre les maladies, notamment la pourriture brune des cabosses, est également abordée.
4.3 Palmier à huile
Le palmier à huile est vital pour l’économie locale et l’industrie agroalimentaire, produisant l’huile de palme et l’huile de palmiste.
- Variétés : La distinction est faite entre le matériel végétal traditionnel (palmiers dura, peu productifs) et les semences améliorées (hybrides tenera), qui ont un rendement en huile bien supérieur. L’importance d’utiliser du matériel sélectionné pour la création de nouvelles plantations est soulignée.
- Itinéraire technique : De la germination des graines (une opération technique qui demande une chaleur contrôlée) à la plantation et à l’entretien (fertilisation, élagage des palmes sèches), les étapes sont décrites.
- Récolte et transformation : La récolte des régimes, une opération physique, et les méthodes de transformation (de l’extraction artisanale à l’extraction industrielle) sont présentées. La gestion de la plantation pour maintenir une production élevée sur 25-30 ans est un point clé.
4.4 Cultures maraîchères
Le maraîchage, souvent pratiqué en zones périurbaines pour approvisionner les villes comme Kinshasa, Lubumbashi ou Goma, est une activité économique intensive et très importante.
- Principales spéculations : Un aperçu des cultures les plus courantes est donné : légumes-feuilles (amarante, oseille), légumes-fruits (tomate, aubergine, piment) et légumes-racines (carotte).
- Techniques de production intensives : Le maraîchage se caractérise par des cycles courts et une forte intensification. Les techniques spécifiques sont mises en avant :
- La production de plants en pépinière : Indispensable pour la plupart des espèces.
- La préparation des planches de culture : Un travail du sol soigné et un apport important de matière organique (compost, fumier) sont nécessaires pour obtenir des rendements élevés.
- L’irrigation : La maîtrise de l’eau est la clé du succès en maraîchage, surtout en saison sèche.
- La lutte intégrée contre les ravageurs : Les cultures maraîchères sont très sensibles aux attaques. La section promeut une approche qui combine des méthodes préventives (rotations, choix de variétés résistantes) et des traitements raisonnés.
B. Exercices d’Application
Calculs de plants/ha pour les plantations
Cette série d’exercices est l’équivalent des calculs de densité pour les cultures pérennes. La maîtrise de ces calculs est essentielle pour la planification et le budget d’installation d’une plantation.
- Calculs en plantation monoculturale : « Vous devez installer une plantation de cacaoyers de 5 hectares. L’écartement recommandé est de 4m x 4m. Calculez le nombre total de plants de cacaoyers nécessaires, en prévoyant 10% de plants supplémentaires pour les remplacements. »
- Calculs en système agroforestier : Un exercice plus complexe demandera de calculer le nombre de plants pour un système associant des caféiers et des arbres d’ombrage. « Sur une parcelle d’un hectare, vous plantez des caféiers Arabica à un écartement de 2,5m x 2m. Vous introduisez également des arbres d’ombrage (ex: Albizia) à une densité de 100 arbres par hectare. Calculez le nombre de plants de caféiers et le nombre de plants d’ombrage nécessaires. »
- Calculs inverses et piquetage : « Un agriculteur a 800 jeunes palmiers à huile en pépinière. Il souhaite les planter à un écartement de 9m en triangle équilatéral. Quelle superficie de terrain peut-il planter ? ». Des schémas expliquant la différence entre la plantation en carré et la plantation en triangle (qui permet une densité légèrement supérieure) accompagnent les exercices.
Programmation des récoltes et de la production
La gestion de la production dans le temps est cruciale, en particulier pour le maraîchage qui vise un approvisionnement régulier du marché.
- Échelonnement des semis : « Un maraîcher de Kikwit veut produire de l’amarante pour le marché local pendant toute la saison sèche (4 mois). Sachant que le cycle de l’amarante de la pépinière à la récolte est de 6 semaines et qu’il dispose de 10 planches de culture, proposez un calendrier de mise en pépinière et de repiquage pour assurer une récolte chaque semaine. »
- Prévision de production pour les cultures pérennes : « Une plantation de caféiers Arabica de 3 hectares entre dans sa cinquième année. Le rendement moyen attendu à cet âge est de 800 g de café marchand par arbre. La densité est de 2000 arbres/ha. Calculez la production totale de café marchand attendue pour la plantation. »
- Calculs de main-d’œuvre pour la récolte : « La récolte des cerises de café nécessite une main d’œuvre importante. On estime qu’un ouvrier peut cueillir 50 kg de cerises par jour. La production totale de cerises de la plantation est estimée à 12 tonnes. Calculez le nombre total de journées-homme nécessaires pour la récolte. »
Analyses économiques simplifiées
Ces exercices introduisent les outils de base pour évaluer la rentabilité d’une culture de rente ou maraîchère.
- Calcul du coût d’installation : Pour un projet de création d’un hectare de cacaoyers, l’élève devra calculer le coût total d’installation. L’énoncé fournira tous les coûts unitaires : prix des plants, coût de la main d’œuvre pour le piquetage, la trouaison, la plantation, coût des engrais de fond, etc.
- Calcul du seuil de rentabilité : « Pour une culture de tomates, le coût de production par hectare est de 1500 $. Le prix de vente moyen est de 0,5 $ le kg. Quel est le rendement minimum (en tonnes/ha) que l’agriculteur doit atteindre pour commencer à faire des bénéfices ? ».
- Comparaison de la rentabilité de deux cultures : Un exercice demandera de comparer la marge brute générée par un hectare de maïs et un hectare de choux dans la ceinture maraîchère de Lubumbashi, en utilisant les données de coûts de production et de prix de vente pour les deux cultures. Cet exercice démontre la haute rentabilité potentielle du maraîchage, mais aussi son niveau de risque et d’investissement plus élevé.
C. Problèmes de Synthèse
Problème 1 : Projet d’installation d’une plantation de café Arabica de 20 ha au Sud-Kivu
Ce problème est une étude de cas complète qui met l’élève en situation de chef de projet. Un investisseur souhaite créer une plantation moderne de café Arabica « de spécialité » dans les hauts plateaux du territoire de Kabare (Sud-Kivu). L’élève doit préparer le dossier technique et financier du projet. Sa réponse devra être un document structuré comprenant :
- Le choix justifié de la variété (ex: une variété comme le Blue Mountain, adaptée à l’altitude) et de la densité de plantation.
- La conception du système agroforestier, avec le choix des espèces d’arbres d’ombrage et leur densité.
- L’itinéraire technique détaillé pour les 3 premières années (non productives) : pépinière, plantation, entretien (désherbage, taille de formation, fertilisation).
- Le plan des infrastructures nécessaires : local de dépulpage, bacs de fermentation, aire de séchage.
- Un plan de lutte intégrée contre les principaux ravageurs et maladies du caféier dans la région (scolyte du grain, anthracnose).
- Un budget d’investissement détaillé pour l’installation des 20 hectares.
- Un compte d’exploitation prévisionnel pour la 5ème année (première année de pleine production), estimant les charges et les produits pour calculer la rentabilité.
Problème 2 : Conception d’une exploitation maraîchère périurbaine à Goma
Ce cas pratique est ancré dans la réalité économique d’approvisionnement d’une grande ville. Le scénario est la création d’une ferme maraîchère de 1 hectare dans la périphérie de Goma, sur un sol volcanique fertile, pour approvisionner les restaurants et les supermarchés de la ville. L’élève doit concevoir l’ensemble du système de production.
- Le plan d’aménagement de la parcelle : Division en blocs de culture, emplacement de la source d’eau (puits ou forage), de la pépinière, et de l’aire de compostage.
- Le choix de l’assolement : Proposer une gamme de 5 à 6 cultures maraîchères diversifiées (ex: tomate, carotte, laitue, poivron, chou) pour répondre à la demande du marché et permettre des rotations.
- Le plan de production annuel : Élaborer un calendrier de production pour l’ensemble de la ferme, en planifiant les successions de cultures sur les planches pour maximiser l’occupation du sol et assurer une production continue tout au long de l’année.
- La description des techniques de production en agriculture biologique : L’énoncé précise que la ferme vise ce marché. L’élève devra donc détailler les méthodes de fertilisation (compost, fumier) et de protection des cultures (utilisation de purins de plantes, lutte biologique) conformes à ce mode de production.
- Une analyse du marché : Identifier les débouchés potentiels et proposer une stratégie de commercialisation (vente directe, contrats avec les restaurants).
Problème 3 : Plan de réhabilitation d’une cacaoyère abandonnée à l’Équateur
Ce problème aborde un enjeu très concret en RDC : la remise en production de vieilles plantations. Le contexte est celui d’une ancienne cacaoyère de 10 hectares près de la ville de Basankusu (province de l’Équateur), qui a été laissée à l’abandon pendant plusieurs années. Les arbres sont vieux, envahis par les lianes et l’ombrage est devenu trop dense. L’élève doit proposer un plan de réhabilitation technique et économique.
- Diagnostic de la plantation : Décrire les opérations à mener pour évaluer l’état de la plantation (comptage de la densité d’arbres survivants, évaluation de l’état sanitaire).
- Opérations de réhabilitation : Détailler le programme des travaux à réaliser :
- Nettoyage et débroussaillage.
- Élagage et régulation de l’ombrage.
- Taille de régénération des cacaoyers existants (recepage ou taille progressive).
- Regarnissage des manquants avec de nouveaux plants de variétés améliorées.
- Mise en place d’un programme de fertilisation pour relancer la vigueur des arbres.
- Calendrier des opérations : Proposer un phasage des travaux sur 2 ans.
- Budget de la réhabilitation et estimation du potentiel de production après 3 ans pour justifier l’investissement.
D. Items Type Examen
Études de cas de plantations
Cette section prépare aux questions d’examen qui présentent une situation-problème dans une plantation et demandent un diagnostic et des recommandations. L’énoncé typique est une description : « Dans une jeune plantation de palmiers à huile de 4 ans dans la province de la Tshopo, on observe un jaunissement généralisé des feuilles, une croissance ralentie et une faible production de régimes. L’agriculteur n’a apporté aucune fertilisation depuis la plantation.
- Quel est votre diagnostic le plus probable ?
- Quelle carence nutritionnelle suspectez-vous en priorité ?
- Proposez un programme de fertilisation corrective d’urgence et un programme de fertilisation d’entretien pour les années suivantes. Précisez les types d’engrais et les doses à apporter par arbre. » Le corrigé détaillera le raisonnement qui mène au diagnostic (carence en potassium, très fréquente chez le palmier), et montrera comment calculer les doses d’engrais (ex: chlorure de potassium) en se basant sur les normes de fumure pour un palmier de cet âge.
Projets techniques détaillés
Cette partie simule les questions d’examen les plus complètes, qui demandent de concevoir un projet de A à Z en réponse à un cahier des charges. Il ne s’agit pas seulement de décrire un itinéraire technique, mais de structurer une réponse comme un mini-dossier de projet. Un exemple : « Une ONG vous charge de concevoir un projet de promotion de la culture du piment (type ‘pili-pili’) pour un groupement de femmes dans les environs de Matadi (Kongo-Central), en vue de sa transformation en purée pour le marché de Kinshasa. Rédigez une note technique de 4 pages présentant les grandes lignes de ce projet. » La réponse attendue, et donc le corrigé modèle, devra inclure :
- Le choix d’une variété de piment adaptée et la méthode de production des plants.
- L’itinéraire technique de production sur une parcelle de 0,25 ha.
- La description de la méthode de récolte et de traitement post-récolte (séchage).
- Un schéma simple du processus de transformation en purée.
- Un calcul simplifié de la rentabilité du projet, de la production à la vente du produit transformé.


