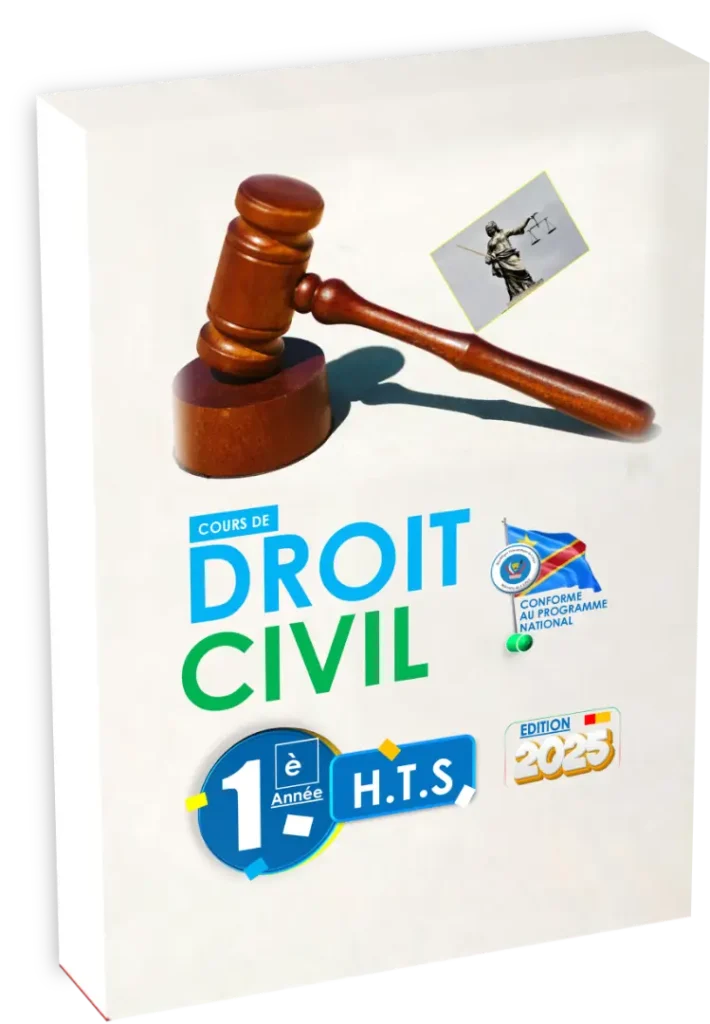
COURS DE DROIT CIVIL, 1ère année, option TECHNIQUES SOCIALES
Edition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
Préliminaires
1. Objectifs du cours
L’objectif principal de ce cours est d’initier les élèves aux règles fondamentales qui régissent les rapports entre les personnes privées en République Démocratique du Congo. 
2. Directives méthodologiques
Une approche pédagogique combinant l’exposé théorique et l’analyse de cas pratiques guidera cet enseignement. Le professeur s’appuiera sur des exemples concrets, tels qu’un conflit de voisinage à Lubumbashi, la rédaction d’un contrat de bail à Kinshasa ou une procédure d’adoption à Goma, pour illustrer les concepts. 
3. Compétences visées
À l’issue de cette formation, l’élève sera apte à :
- Distinguer les personnes physiques des personnes morales et comprendre leurs capacités juridiques respectives.
- Maîtriser les notions essentielles de l’état civil, de la filiation et du mariage selon le droit congolais actuel.
- Classifier les biens et comprendre les attributs du droit de propriété.
- Identifier les sources des obligations (contrats, responsabilité civile) et leurs effets.
- Analyser un contrat simple et en évaluer les conditions de validité.
4. Outils et supports didactiques
La transmission des savoirs mobilisera des supports variés pour un apprentissage dynamique. 
Partie I : Les Sujets de Droit : Les Personnes et la Famille
Cette première partie est consacrée à l’étude des acteurs de la vie juridique. Elle définit qui sont les sujets de droit, qu’il s’agisse des individus (personnes physiques) ou des groupements (personnes morales), et explore le cadre juridique fondamental de leurs relations : la famille, telle que régie par le Code de 2016.
Chapitre 1 : Introduction au Droit Civil Congolais
1.1. Définition et objet du Droit Civil
Le droit civil est présenté comme le droit commun applicable aux relations entre les individus. Son objet consiste à encadrer les aspects fondamentaux de la vie en société : la naissance, le nom, le mariage, la propriété, les contrats, et la fin de la personnalité juridique.
1.2. Les sources du Droit Civil : Loi, coutume et jurisprudence
Cette section détaille l’origine des règles du droit civil. La loi, votée par le Parlement, constitue la source principale, complétée par la coutume, source non écrite et essentielle dans de nombreuses régions, ainsi que par la jurisprudence, qui représente l’interprétation de la loi par les tribunaux.
1.3. L’articulation entre le droit écrit et le droit coutumier
L’élève étudie la coexistence et parfois la confrontation entre le droit d’inspiration occidentale et les coutumes locales. Le cours explique comment la loi tente d’harmoniser ces deux systèmes, notamment en matière familiale, tout en affirmant la primauté du droit écrit en cas de conflit.
1.4. Le rôle du Code Civil et du Code de la Famille de 2016
Le Code civil (Livre III sur les obligations et contrats) et le Code de la famille sont présentés comme les textes de référence. Un accent particulier est mis sur le Code de la famille de 2016 qui a modernisé en profondeur le droit du mariage, de la filiation et des régimes matrimoniaux en RDC.
Chapitre 2 : Les Personnes Physiques
2.1. La notion de personnalité juridique
La personnalité juridique est définie comme l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. 
2.2. La capacité juridique
La distinction entre la capacité de jouissance (l’aptitude à avoir des droits) et la capacité d’exercice (l’aptitude à exercer soi-même ces droits) est expliquée. Toute personne physique jouit de la première, mais la seconde peut être limitée.
2.3. Les incapacités : Le cas du mineur d’âge
Le mineur est présenté comme l’incapable par excellence. Le cours détaille son incapacité d’exercice générale, qui l’oblige à être représenté par ses parents ou son tuteur pour les actes de la vie juridique, afin de le protéger contre son inexpérience.
2.4. Les incapacités : Le cas des majeurs protégés
Cette section aborde les régimes de protection des personnes majeures dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées. Les notions de tutelle et de curatelle pour majeurs sont introduites comme des mécanismes de protection adaptés à leur degré d’incapacité.
Chapitre 3 : Les Personnes Morales
3.1. Définition et types de personnes morales
Une personne morale est un groupement de personnes ou de biens doté de la personnalité juridique. 
3.2. Les sociétés commerciales
Les sociétés sont étudiées comme des groupements de personnes visant à réaliser et à partager des bénéfices. Les formes courantes comme la Société à Responsabilité Limitée (SARL) sont présentées, en lien avec le droit OHADA applicable en RDC.
3.3. Les associations sans but lucratif (ASBL)
L’ASBL est définie comme un groupement dont le but est désintéressé. Elle constitue l’outil juridique privilégié pour les projets sociaux, culturels ou humanitaires, et son régime spécifique en droit congolais est détaillé.
3.4. Le régime juridique des personnes morales
Le cycle de vie d’une personne morale est exploré. Sont étudiées sa création (par la signature des statuts et l’accomplissement des formalités), sa capacité juridique (limitée à son objet social) et sa dissolution.
Chapitre 4 : L’Identification des Personnes Physiques
4.1. L’État Civil et ses actes
L’état civil est présenté comme le service public chargé de constater officiellement les grands événements de la vie d’une personne. 
4.2. Le nom : Attribution et protection
Le nom est étudié comme l’élément principal d’identification d’une personne. Le cours explique les règles d’attribution du nom de famille et du ou des prénoms, ainsi que les actions en justice permettant de protéger son nom contre toute usurpation.
4.3. Le domicile et la résidence
La distinction entre le domicile (le lieu du principal établissement, où la personne est rattachée juridiquement) et la résidence (le lieu de séjour effectif) est clarifiée. L’importance du domicile pour les actes de procédure est soulignée.
4.4. La nationalité congolaise
La nationalité est définie comme le lien juridique et politique qui rattache un individu à l’État congolais. Les modes d’acquisition (par filiation, par naissance sur le territoire, par naturalisation) et de perte de la nationalité sont exposés.
Partie II : Le Droit de la Famille selon le Code de 2016
Cette deuxième partie est une immersion dans le droit de la famille congolais, profondément réformé en 2016. Elle analyse l’institution du mariage, les différentes manières de gérer les biens des époux (régimes matrimoniaux) et les divers liens de filiation reconnus par la loi.
Chapitre 5 : Le Mariage
5.1. Les conditions de fond et de forme du mariage
Les exigences légales pour contracter mariage sont détaillées. Les conditions de fond (différence de sexe, consentement, âge légal) sont distinguées des conditions de forme (célébration par l’officier de l’état civil), qui garantissent la validité de l’union.
5.2. Les effets personnels du mariage
Le mariage crée des droits et des devoirs réciproques entre les époux. 
5.3. Les effets patrimoniaux : Le régime matrimonial
Ce point introduit la question de la gestion des biens des époux pendant le mariage. Le régime matrimonial est le statut juridique qui organise cette gestion et qui détermine le sort des biens en cas de dissolution du mariage.
5.4. La dissolution du mariage
Les causes de la fin du mariage sont examinées. Outre le décès, le divorce est étudié en détail, en présentant les différentes causes admises par la loi (comme la rupture irrémédiable de l’union) et les procédures à suivre devant le tribunal.
Chapitre 6 : Les Régimes Matrimoniaux
6.1. Le principe de la liberté du choix du régime matrimonial
Le Code de la famille de 2016 a consacré la liberté pour les futurs époux de choisir leur régime par contrat de mariage. Ce principe d’autonomie de la volonté est une innovation majeure par rapport à l’ancien code.
6.2. Le régime de la communauté universelle
Sous ce régime, tous les biens des époux, présents et à venir, qu’ils soient acquis avant ou pendant le mariage, sont mis en commun. L’élève en comprend les avantages en termes de solidarité et les risques en cas de dettes.
6.3. Le régime de la séparation des biens
Ce régime est l’opposé du précédent : chaque époux conserve la propriété et la gestion exclusive de ses biens personnels. Il garantit une indépendance patrimoniale totale, mais requiert une gestion rigoureuse des contributions aux charges du ménage.
6.4. Le régime de la communauté réduite aux acquêts
Ce régime est le régime légal, qui s’applique par défaut en l’absence de contrat de mariage. 
Chapitre 7 : La Filiation
7.1. La filiation légitime et la présomption de paternité
La filiation d’un enfant né de parents mariés est abordée. Le cours explique la présomption « pater is est » : l’enfant conçu pendant le mariage est présumé avoir pour père le mari de la mère, ce qui simplifie l’établissement du lien de filiation.
7.2. La filiation naturelle
Ce point traite de la filiation de l’enfant né hors mariage. Le lien est établi différemment à l’égard de la mère (par l’acte de naissance) et du père (par un acte de reconnaissance volontaire ou un jugement).
7.3. La filiation adoptive
L’adoption est présentée comme un mécanisme juridique qui crée un lien de filiation artificiel. Les deux formes d’adoption en droit congolais (simple et plénière) sont distinguées par leurs conditions et leurs effets sur les liens avec la famille d’origine.
7.4. Les actions relatives à la filiation
Les actions en justice permettant d’établir ou de contester un lien de filiation sont étudiées. Celles-ci incluent l’action en recherche de paternité pour l’enfant naturel et l’action en contestation de paternité pour l’enfant né dans le mariage.
Partie III : Le Droit des Biens
Cette troisième partie s’intéresse aux relations juridiques entre les personnes et les choses. L’élève découvre la notion de patrimoine, apprend à classifier les différents types de biens, et étudie en profondeur le droit le plus complet sur une chose : le droit de propriété, ainsi que ses démembrements.
Chapitre 8 : Le Patrimoine et la Classification des Biens
8.1. La notion de patrimoine
Le patrimoine est défini comme l’ensemble des droits et obligations à caractère économique d’une personne, envisagé comme une universalité juridique. Il comprend un actif (les biens) et un passif (les dettes).
8.2. La distinction fondamentale : Biens meubles et biens immeubles
C’est la classification principale des biens. 
8.3. Les autres classifications
D’autres distinctions utiles sont présentées. Sont étudiés les biens corporels (matériels) et incorporels (droits d’auteur), ainsi que les biens fongibles (interchangeables, comme l’argent) et non fongibles (uniques, comme une œuvre d’art).
8.4. Les biens dans et hors du commerce
Le cours explique que certains biens, en raison de leur nature ou de leur affectation (domaine public), ne peuvent faire l’objet de transactions privées. Ils sont « hors du commerce juridique », contrairement à la majorité des biens.
Chapitre 9 : Le Droit de Propriété
9.1. Les attributs du droit de propriété
Le droit de propriété est le droit le plus complet sur une chose, décomposé en trois prérogatives. L’élève apprend à distinguer l’usus (le droit d’utiliser le bien), le fructus (le droit d’en percevoir les fruits) et l’abusus (le droit d’en disposer).
9.2. L’étendue et les limites du droit de propriété
Bien qu’absolu, le droit de propriété connaît des limites imposées par la loi dans l’intérêt général (règles d’urbanisme) ou dans l’intérêt des voisins (troubles anormaux de voisinage), illustrant l’adage « la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres ».
9.3. Les modes d’acquisition de la propriété
Les différentes manières de devenir propriétaire sont passées en revue. 
9.4. L’extinction et la protection du droit de propriété
Le droit de propriété est perpétuel, il ne se perd pas par le non-usage. Le cours examine les actions en justice qui permettent au propriétaire de défendre son droit, notamment l’action en revendication pour récupérer un bien indûment détenu par un tiers.
Chapitre 10 : Les Démembrements du Droit de Propriété
10.1. L’usufruit : Droit d’usage et de jouissance
L’usufruit est le droit d’utiliser un bien (usus) et d’en percevoir les fruits (fructus), sans en être propriétaire. Le propriétaire, appelé nu-propriétaire, ne conserve que le droit de disposer du bien (abusus).
10.2. L’usage et l’habitation
Ces droits sont des formes plus restreintes de l’usufruit. Le droit d’usage permet d’utiliser un bien et d’en percevoir les fruits uniquement dans la limite de ses besoins et de ceux de sa famille, tandis que le droit d’habitation se limite à la faculté d’habiter une maison.
10.3. Les servitudes
Une servitude est une charge imposée à un immeuble (le fonds servant) au profit d’un autre immeuble (le fonds dominant). L’exemple classique est le droit de passage qu’un propriétaire enclavé obtient sur le terrain de son voisin pour accéder à la voie publique.
10.4. L’emphytéose et le droit de superficie
Ces droits, souvent liés au droit foncier congolais, sont expliqués. L’emphytéose est un bail de très longue durée qui confère au preneur un droit réel sur le bien. Le droit de superficie permet d’être propriétaire de constructions sur un terrain appartenant à autrui.
Chapitre 11 : La Possession et la Prescription
11.1. La notion de possession
La possession est le fait de se comporter comme le véritable propriétaire d’un bien, que l’on ait ou non le droit de le faire. 
11.2. Les effets juridiques de la possession
La possession, même sans droit, produit des effets juridiques importants. Elle fait présumer la propriété et est protégée en elle-même par des actions en justice spécifiques (les actions possessoires).
11.3. La prescription acquisitive (usucapion)
C’est le mécanisme par lequel une possession prolongée et paisible peut transformer le possesseur en propriétaire légal du bien. Les conditions et les délais requis pour l’usucapion immobilière sont étudiés.
11.4. La prescription extinctive
Ce concept symétrique est le mécanisme par lequel un droit s’éteint après l’écoulement d’un certain délai pendant lequel son titulaire est resté inactif. Il s’applique principalement aux droits de créance.
Partie IV : Le Droit des Obligations
Cette dernière partie explore la dynamique des relations économiques entre les personnes. Elle est au cœur du droit civil et explique comment naissent, se transmettent et s’éteignent les liens de droit par lesquels une personne (le créancier) peut exiger d’une autre (le débiteur) l’accomplissement d’une prestation.
Chapitre 12 : Introduction au Droit des Obligations
12.1. Définition de l’obligation
L’obligation est définie comme le lien de droit entre un créancier et un débiteur. Ce lien contraint le débiteur à exécuter une prestation (donner, faire ou ne pas faire quelque chose) au profit du créancier, qui dispose d’un pouvoir de contrainte en cas d’inexécution.
12.2. Les sources des obligations
D’où viennent les obligations ? Le cours présente les deux grandes sources : l’acte juridique (principalement le contrat), qui est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit, et le fait juridique (comme un accident), qui produit des effets de droit sans que ceux-ci aient été voulus.
12.3. La distinction entre obligations civiles et naturelles
L’obligation civile est celle qui est sanctionnée par le droit ; le créancier peut en forcer l’exécution en justice. L’obligation naturelle, fondée sur un devoir de conscience (comme une aide entre frères), ne peut être exigée, mais si elle est exécutée volontairement, elle ne peut être restituée.
12.4. Les modalités des obligations
Les obligations peuvent être affectées de modalités qui en modifient les effets. Sont étudiés le terme (un événement futur et certain qui retarde l’exigibilité) et la condition (un événement futur et incertain dont dépend la naissance ou la disparition de l’obligation).
Chapitre 13 : Le Contrat comme Source d’Obligations
13.1. Définition et classification des contrats
Le contrat est défini comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer des obligations. 
13.2. Les conditions de validité d’un contrat
Pour être valable, un contrat doit respecter quatre conditions essentielles. L’élève les étudie en détail : le consentement libre et éclairé des parties, leur capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement, et une cause licite.
13.3. Les effets du contrat
Le principe de la force obligatoire du contrat est central : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Est également étudié le principe de l’effet relatif, selon lequel le contrat ne produit d’effets qu’entre les parties contractantes.
13.4. L’extinction des obligations contractuelles
Les différentes manières dont une obligation prend fin sont examinées. Le mode normal est le paiement (l’exécution de la prestation). D’autres modes sont étudiés, comme la novation, la remise de dette ou la compensation.
Chapitre 14 : La Responsabilité Civile
14.1. Les sources non contractuelles : Délit et quasi-délit
La responsabilité civile est l’obligation de réparer le dommage causé à autrui. 
14.2. La responsabilité du fait personnel
Le principe fondamental est posé : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Les trois conditions de cette responsabilité (une faute, un dommage, un lien de causalité) sont analysées.
14.3. La responsabilité du fait d’autrui
Dans certains cas, on est responsable non seulement de son propre fait, mais aussi de celui des personnes dont on doit répondre. Sont étudiés les cas de la responsabilité des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs et celle des employeurs pour leurs salariés.
14.4. La responsabilité du fait des choses
On peut également être responsable du dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde (un animal, un bâtiment en ruine). Ce régime de responsabilité, souvent sans qu’une faute doive être prouvée, est exploré.
Chapitre 15 : Les Contrats Usuels et les Sûretés
15.1. Étude du contrat de vente
La vente est le contrat par lequel une personne transfère la propriété d’un bien à une autre, moyennant un prix. Les obligations du vendeur (délivrance, garantie) et de l’acheteur (paiement du prix) sont détaillées.
15.2. Étude du contrat de louage
Le contrat de louage, ou bail, est celui par lequel une partie s’engage à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, moyennant un loyer. Un focus est mis sur le bail d’habitation et la législation protectrice des locataires.
15.3. Étude du contrat de société
Les notions de base du contrat de société sont reprises ici pour illustrer la création d’une personne morale par un acte juridique. L’intention de collaborer sur un pied d’égalité (affectio societatis) et le partage des bénéfices ou des pertes sont ses éléments essentiels.
15.4. Les sûretés pour garantir les obligations
Les sûretés sont des mécanismes juridiques destinés à garantir un créancier contre le risque d’insolvabilité de son débiteur. 
Annexes
1. Glossaire des termes juridiques
Un lexique définit de manière simple et accessible les principaux concepts et expressions latines rencontrés dans le cours (jurisprudence, synallagmatique, usufruit, pater is est, etc.), afin de faciliter la maîtrise du vocabulaire juridique.
2. Modèles d’actes juridiques simples
Des exemples de contrats courants sont fournis pour illustrer la théorie. Ces modèles incluent un contrat de bail d’habitation, un contrat de vente simple et un acte de reconnaissance de dette, commentés pour en expliquer les clauses essentielles.
3. Schéma de la procédure de divorce
Une représentation visuelle et simplifiée des étapes d’une procédure de divorce en RDC est proposée, de la requête initiale au jugement. Ce schéma permet de mieux comprendre le déroulement concret d’une action en justice en matière familiale.
4. Extraits du Code de la Famille de 2016
Une sélection d’articles clés du nouveau Code de la famille est présentée, notamment ceux relatifs à la gestion du ménage, aux régimes matrimoniaux et à l’autorité parentale. Cela permet un contact direct avec la source légale la plus importante en la matière.




