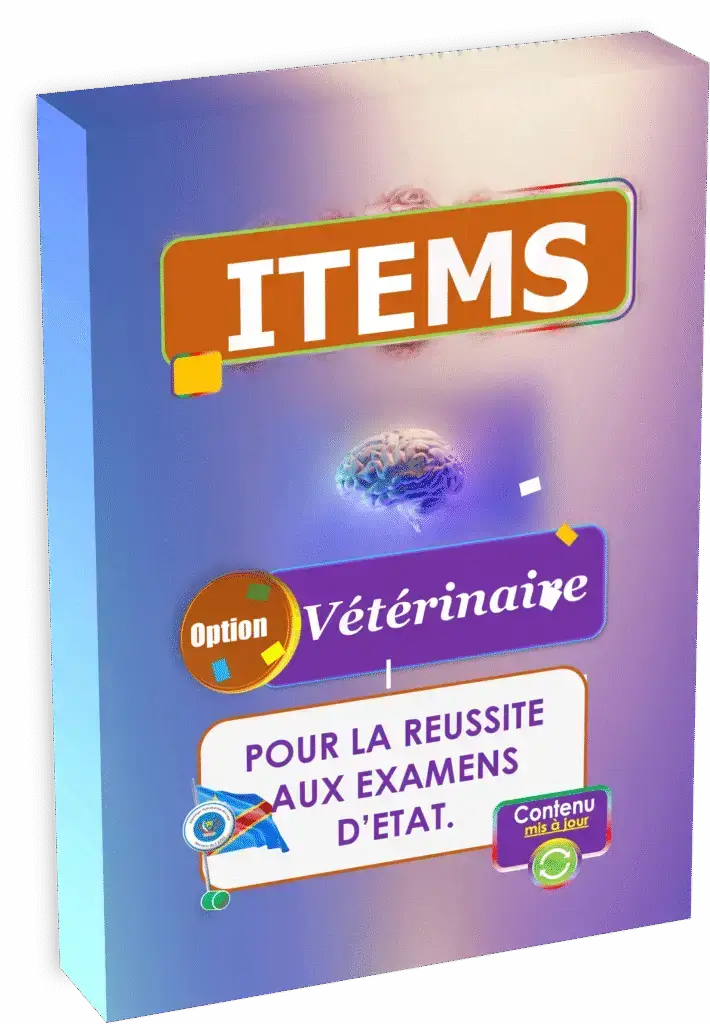
RECUEIL D’ITEMS, EXERCICES ET SITUATIONS D’INTEGRATION POUR L’OPTION CONSTRUCTION
Contenu mis à jour en 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
Pour la préparation à la réussite aux examens d’état
PARTIE I : DESSIN TECHNIQUE DU BÂTIMENT ET LECTURE DE PLANS
Cette première partie établit le socle fondamental de la communication technique dans le secteur de la construction. Elle vise à développer une maîtrise absolue du langage graphique normalisé, indispensable à la lecture, l’interprétation et la production de tout document technique. La progression didactique est conçue pour mener l’élève d’une compréhension des conventions de base à la capacité d’analyser et de concevoir des dossiers de plans complexes, en intégrant systématiquement les spécificités réglementaires et constructives de la République Démocratique du Congo. L’objectif est de garantir que chaque finaliste puisse, face à un plan, en déchiffrer instantanément toutes les informations, anticiper les étapes de construction et identifier les points critiques, une compétence transversale évaluée dans toutes les sections de l’examen d’État.
Chapitre 1 : Normalisation et Conventions de Représentation
Ce chapitre d’introduction constitue l’alphabet et la grammaire du dessin technique. 
A. Rappels Essentiels
Cette section consolide les connaissances théoriques indispensables à toute production graphique. Elle fournit un référentiel normatif clair et directement applicable.
Formats normalisés (A0 à A4) et échelles conventionnelles
La maîtrise des formats et des échelles est la première étape vers la production de plans professionnels. Ce point détaille l’utilisation rationnelle des formats de la série A, depuis le format A4 pour les notes de calcul et les détails, jusqu’au format A0 pour les plans d’ensemble de grands projets. L’enseignement se concentre sur le choix judicieux de l’échelle, une compétence essentielle pour garantir la lisibilité de l’information. Un exercice contextualisé pourrait, par exemple, demander de justifier le choix d’une échelle de 1:2000 pour le plan de masse d’un nouveau lotissement à la périphérie de Kananga, tout en exigeant une échelle de 1:50 pour les plans d’exécution des villas types et de 1:10 pour les détails de fondation, démontrant ainsi la capacité de l’élève à adapter l’outil graphique à la nature de l’information à communiquer.
Traits normalisés et leur signification dans le BTP
Ce sous-point aborde le vocabulaire visuel du dessin technique. Il présente de manière systématique la typologie des traits (continu fort, continu fin, interrompu, mixte) et leur sémantique précise dans le domaine du bâtiment. L’élève apprend à différencier sans ambiguïté une arête visible (trait continu fort) d’une arête cachée (trait interrompu fin), un axe de symétrie (trait mixte fin) ou un plan de coupe (trait mixte fort aux extrémités). L’objectif est de développer un réflexe de lecture instantané, permettant, par exemple, de comprendre sur un plan de coffrage complexe la superposition des éléments et la position des armatures non visibles, une compétence cruciale pour l’interprétation des sujets d’examen.
Cartouches, nomenclatures et symboles graphiques du bâtiment
Le cartouche est la carte d’identité de tout plan technique. Cette section détaille les éléments obligatoires qui doivent y figurer conformément aux standards professionnels en RDC : identification du projet, nom du maître d’ouvrage, localisation du chantier (par exemple, « Projet de construction d’un entrepôt frigorifique, Port de Boma, Kongo Central »), indice de révision, date et échelle. Une attention particulière est portée aux nomenclatures, qui listent de manière structurée les différents éléments d’un plan (portes, fenêtres, équipements sanitaires) avec leurs spécifications. Enfin, une bibliothèque de symboles graphiques normalisés est fournie, couvrant les matériaux (béton, maçonnerie de moellons, bois), les ouvertures, les appareils électriques et les éléments de plomberie, assurant une communication graphique univoque.
Cotation fonctionnelle et tolérances géométriques
Savoir dessiner une forme est une chose ; savoir la coter pour qu’elle soit réalisable en est une autre. Cette partie enseigne les principes de la cotation fonctionnelle, qui consiste à placer les dimensions en fonction des exigences d’assemblage et de fonctionnement de l’ouvrage. L’élève apprend à éviter la surabondance ou l’ambiguïté des cotes. Un exemple concret serait la cotation d’une ouverture de fenêtre, où les dimensions doivent garantir non seulement le passage de la menuiserie mais aussi l’espace nécessaire pour le calfeutrement et les finitions. Le concept de tolérance géométrique est également introduit pour préparer les élèves aux exigences de la construction moderne, notamment pour les éléments préfabriqués où la précision de l’ajustement entre des composants fabriqués séparément, par exemple entre des poutres en acier produites à Kinshasa et des poteaux en béton coulés sur un chantier à Mbuji-Mayi, est une condition impérative de réussite.
B. Exercices d’Application Directe
Ces exercices visent à transformer la connaissance théorique des normes en compétence pratique par la manipulation et la création de dessins techniques concrets.
Reproduction de plans d’implantation de maisons à Goma
Cet exercice n’est pas une simple copie. En demandant la reproduction de plans d’implantation spécifiques à Goma, il force l’élève à appliquer les normes de représentation dans un contexte où les contraintes sismiques et la nature du sol volcanique sont prépondérantes. L’élève devra dessiner avec précision les reculs par rapport aux limites de parcelle, représenter correctement les chaînages de fondation spécifiques aux constructions parasismiques et utiliser les symboles adéquats pour les murs en moellons de pierre volcanique. Le contexte de Goma est ici intrinsèquement pertinent car il impose des choix graphiques et des détails constructifs qui ne seraient pas présents dans un projet à Mbandaka, par exemple.
Lecture et interprétation de plans de fondations sur sol volcanique
Ici, la compétence évaluée est la capacité d’analyse. L’élève est confronté à un plan de fondations existant pour un bâtiment situé sur les sols meubles et potentiellement instables de la région des Virunga. Il doit être capable d’identifier le type de fondation (semelles isolées, filantes, radier général), de comprendre la disposition des armatures et des chaînages bas, et d’interpréter les cotes de niveau qui dictent la profondeur d’ancrage dans le bon sol. L’exercice peut inclure des questions ciblées : « Quelle est la section des aciers de chaînage ? Pourquoi le concepteur a-t-il prévu un radier plutôt que des semelles isolées pour cette partie du bâtiment ? ». La référence au sol volcanique est essentielle, car elle justifie les choix techniques représentés sur le plan.
Tracés géométriques appliqués au BTP (raccordements, tangentes)
Cet exercice renforce la maîtrise de la géométrie constructive, une compétence fondamentale pour le dessin de formes non rectilignes. L’élève s’entraîne à réaliser des tracés précis pour des éléments architecturaux comme des arcs en plein cintre, des raccordements de murs courbes, des limons d’escalier ou des profils de voirie. Un cas pratique pourrait être le tracé du raccordement tangentiel entre deux alignements de route pour un projet d’aménagement urbain à Lubumbashi, nécessitant une application rigoureuse des constructions géométriques pour garantir la fluidité et la sécurité de la circulation.
C. Problèmes de Synthèse
Ces problèmes exigent de mobiliser l’ensemble des compétences acquises dans le chapitre pour analyser et évaluer des documents techniques complets.
Analyse complète d’un dossier technique : école primaire type RDC
L’élève reçoit un dossier de plans (plan de masse, plans des niveaux, coupes, façades) pour un projet standardisé d’école, tel que ceux déployés par le gouvernement congolais. La tâche consiste à mener une analyse critique du dossier. L’élève doit vérifier l’application correcte de toutes les normes de représentation (traits, cotation, cartouche), la cohérence entre les différentes vues (par exemple, s’assurer qu’une fenêtre visible en façade apparaît bien en plan et en coupe), et la lisibilité générale des documents. Cet exercice développe un œil critique et prépare à la détection d’erreurs, une compétence clé pour un technicien sur chantier.
Vérification de cohérence entre plans d’architecture et plans d’exécution
Ce problème de synthèse met l’élève dans la peau d’un dessinateur-projeteur ou d’un conducteur de travaux. Il reçoit deux jeux de plans pour un même projet : le plan d’architecte (axé sur la conception et l’esthétique) et le plan d’exécution en béton armé (axé sur la structure). La mission est d’identifier les éventuelles discordances : un poteau structurel qui apparaît au milieu d’une pièce sur le plan d’architecte, des dimensions de fenêtres qui diffèrent entre les deux documents, des niveaux de plancher incohérents. Cet exercice est crucial car il simule une étape fondamentale du processus de construction où la coordination entre les différents corps de métier est assurée par la cohérence des plans.
D. Items Type Examen
Cette section familiarise l’élève avec le format et le niveau d’exigence des questions qui seront posées à l’examen d’État.
Correction d’erreurs dans des plans techniques
Un plan contenant plusieurs erreurs délibérées de normalisation (mauvais type de trait, cotation en surcharge, symbole incorrect, information manquante dans le cartouche) est fourni à l’élève. Sa tâche est d’identifier, de lister et de corriger chacune de ces erreurs en justifiant sa correction par la norme correspondante. Cet item teste de manière très directe et efficace la maîtrise des conventions graphiques et l’attention au détail.
Complétion de vues manquantes selon normes congolaises
Partant de deux vues données d’un objet ou d’un bâtiment simple (par exemple, la vue de face et la vue de dessus), l’élève doit dessiner la troisième vue manquante (la vue de gauche ou une coupe) en respectant scrupuleusement les règles de projection orthogonale et les conventions de représentation. Cet exercice évalue à la fois la capacité de visualisation spatiale et la rigueur dans l’application des normes graphiques, deux compétences indissociables pour un futur technicien en construction.
Chapitre 2 : Plans d’Architecture et d’Implantation
Ce chapitre se concentre sur les premières phases de la conception d’un projet, de son inscription dans un site à la définition de ses volumes. 
A. Rappels Essentiels
Cette section fournit les définitions et les concepts clés pour comprendre comment un projet de construction s’ancre dans son territoire.
Plan de situation et plan de masse
Le plan de situation et le plan de masse sont les premiers documents d’un dossier de permis de construire. Ce point explique de manière distincte leur fonction : le plan de situation localise la parcelle à une échelle large (quartier, commune), en montrant les principales voies d’accès et les repères environnants. Le plan de masse, à une échelle plus serrée, représente le projet sur sa parcelle, indiquant la position exacte du bâtiment, les limites de propriété, les distances par rapport aux voisins et à la voirie, les réseaux existants et projetés, ainsi que les aménagements extérieurs. La distinction claire entre ces deux documents et leur contenu normatif est un prérequis pour tout finaliste.
Nivellement et cotes altimétriques pour terrain en pente
La plupart des terrains ne sont pas parfaitement plats. Cette section aborde les techniques de représentation du relief. Elle explique comment lire et interpréter les courbes de niveau sur un plan topographique et comment utiliser les cotes altimétriques (points cotés) pour comprendre la topographie d’un site. L’élève apprend à calculer des pentes et à visualiser le profil naturel du terrain, des informations indispensables pour concevoir l’implantation d’un bâtiment, prévoir les travaux de terrassement (déblais/remblais) et concevoir les systèmes d’évacuation des eaux pluviales. L’application de ces principes est fondamentale, que ce soit pour un projet sur les collines de Mont-Ngafula à Kinshasa ou sur les flancs d’un volcan à Goma.
Réglementation urbaine de Kinshasa : reculs, hauteurs, emprise
Ce point ancre directement l’apprentissage dans le cadre réglementaire congolais. En utilisant l’exemple concret du plan d’urbanisme de Kinshasa, il détaille les règles qui gouvernent la construction : les distances minimales à respecter par rapport aux limites de la parcelle et à la voirie (reculs), les hauteurs maximales autorisées pour les bâtiments, et le coefficient d’emprise au sol (CES) qui limite la surface constructible sur une parcelle. Comprendre et savoir appliquer ces règles est essentiel pour concevoir un projet légal et est souvent un point de vérification dans les sujets d’examen qui simulent un dépôt de permis de construire. Le choix de Kinshasa est pertinent car son cadre réglementaire est l’un des plus développés et sert de référence.
Orientation bioclimatique adaptée au climat équatorial
Construire en RDC impose de prendre en compte un climat chaud et humide. Cette section introduit les principes de base de la conception bioclimatique. Elle explique comment l’orientation d’un bâtiment peut influencer son confort thermique et sa consommation d’énergie. L’élève apprend les stratégies pour minimiser l’exposition aux façades Est et Ouest (les plus ensoleillées) tout en favorisant la ventilation naturelle traversante pour évacuer l’humidité et rafraîchir les locaux. Il s’agit de positionner judicieusement les ouvertures et de prévoir des protections solaires (auvents, brise-soleil), des compétences qui démontrent une approche intelligente et durable de la conception.
B. Exercices d’Application Directe
Ces exercices permettent de mettre en pratique les concepts d’implantation et de conception architecturale dans des contextes spécifiques.
Implantation d’un bâtiment R+1 sur terrain volcanique (Goma)
Cet exercice combine plusieurs contraintes. L’élève reçoit le relevé topographique d’une parcelle en pente à Goma et le plan d’un bâtiment R+1. Sa tâche est de proposer la meilleure implantation possible. Il devra positionner le bâtiment de manière à minimiser les travaux de terrassement, orienter les pièces de vie pour bénéficier de la vue sur le lac Kivu tout en se protégeant du soleil de l’après-midi, et respecter les règles d’urbanisme locales. La mention du terrain volcanique n’est pas anecdotique : elle implique de prendre en compte la capacité portante spécifique du sol et d’anticiper la gestion des eaux de ruissellement sur une surface potentiellement très perméable, rendant le contexte de Goma indispensable à la complexité pédagogique de l’exercice.
Calcul d’emprise et coefficient d’occupation des sols
À partir du plan d’un projet et des dimensions d’une parcelle, l’élève doit effectuer des calculs réglementaires. Il calcule la surface d’emprise au sol du bâtiment (la projection verticale de sa volumétrie) et la divise par la surface de la parcelle pour obtenir le coefficient d’emprise au sol (CES). Il doit ensuite comparer ce résultat au CES maximal autorisé par le règlement d’urbanisme (fourni dans l’énoncé) pour déterminer si le projet est conforme. Cet exercice très concret évalue la capacité à traduire des règles juridiques en calculs géométriques simples, une tâche courante pour un technicien.
Tracé de voies d’accès et réseaux d’évacuation pluviale
Cet exercice se concentre sur les aménagements extérieurs. Sur un plan de masse, l’élève doit dessiner le tracé d’une voie d’accès pour véhicules depuis la rue jusqu’au garage, en respectant les rayons de braquage minimaux. Il doit également concevoir le réseau de collecte des eaux de pluie provenant de la toiture et des surfaces imperméabilisées (terrasses, allées), en positionnant les caniveaux, les regards et en indiquant les pentes nécessaires pour assurer un écoulement gravitaire vers l’exutoire public. La pertinence de cet exercice est particulièrement forte dans des villes comme Kinshasa ou Matadi, où les pluies torrentielles rendent la gestion des eaux pluviales un enjeu majeur pour prévenir les inondations et l’érosion.
Positionnement optimal selon vents dominants et ensoleillement
Dans cet exercice, l’élève reçoit des données climatiques pour une localité donnée (par exemple, Kisangani), incluant une rose des vents et la trajectoire du soleil aux solstices. Le but est de positionner et d’orienter un bâtiment simple sur une parcelle pour maximiser la ventilation naturelle (en alignant les ouvertures principales avec les vents dominants) et minimiser les surchauffes estivales (en protégeant les façades les plus exposées). Cet exercice développe la sensibilité à la conception environnementale et montre comment des choix simples en phase de conception peuvent avoir un impact significatif sur le confort des occupants.
C. Problèmes de Synthèse
Ces projets demandent une intégration de toutes les compétences du chapitre pour produire un dossier d’implantation cohérent.
Projet complet : centre de santé rural (plans masse, situation, réseaux)
L’élève est chargé de produire le dossier d’implantation complet pour un centre de santé dans une localité rurale, par exemple près de Boende dans la province de la Tshuapa. Le programme inclut un bâtiment principal, un logement pour le personnel et une latrine. L’élève doit produire le plan de situation, le plan de masse montrant l’agencement des différents bâtiments, l’accès pour les ambulances, les cheminements piétons, ainsi que les plans des réseaux essentiels : adduction d’eau (depuis un puits ou une source) et assainissement (fosse septique et puits perdu). Le contexte rural est clé, car il impose de concevoir des solutions autonomes pour les réseaux, contrairement à un projet en milieu urbain.
Étude d’impact environnemental pour construction en zone sensible
Ce problème de synthèse aborde une dimension plus contemporaine de la construction. Le scénario propose un projet de construction d’un petit lodge touristique près d’une zone protégée, comme le parc de la Garamba. L’élève doit analyser l’implantation proposée et identifier les impacts potentiels sur l’environnement : déforestation, perturbation de la faune, risque de pollution des sols ou des cours d’eau. Il doit ensuite proposer des mesures correctives sur le plan de masse : ajuster la position du bâtiment pour préserver des arbres remarquables, prévoir un système de traitement des eaux usées plus performant, ou utiliser des matériaux de construction locaux à faible impact. Cet exercice évalue la capacité à intégrer des préoccupations environnementales dans la conception technique.
D. Items Type Examen
Ces questions ciblées préparent aux épreuves en se focalisant sur des points réglementaires et calculatoires.
Calculs de surfaces et volumes réglementaires
Cet item teste la capacité à appliquer des formules géométriques dans un contexte réglementaire. À partir d’un plan et d’un règlement d’urbanisme simplifié, l’élève devra calculer des grandeurs comme la surface de plancher, l’emprise au sol, le volume total du bâtiment, ou la surface d’espaces verts minimale à conserver sur la parcelle. La précision des calculs et la correcte interprétation des définitions réglementaires sont les principaux critères d’évaluation.
Vérification conformité urbanistique selon code congolais
L’élève reçoit un dossier de permis de construire simplifié pour un projet, par exemple, à Goma, ainsi qu’un extrait du code de l’urbanisme local. Sa mission est de jouer le rôle de l’instructeur du service de l’urbanisme : il doit vérifier point par point si le projet respecte toutes les prescriptions (hauteur, reculs, emprise, stationnement, etc.). Il doit ensuite rédiger un court rapport indiquant les points de conformité et les éventuelles non-conformités, en citant les articles du règlement concernés. Cet exercice simule une situation professionnelle réelle et évalue la rigueur et la méthode.
Chapitre 3 : Plans de Coffrage et d’Armatures Béton Armé
Ce chapitre est au cœur du métier de technicien en construction. Il traite du langage graphique spécifique au béton armé, un matériau omniprésent dans la construction en RDC. 
A. Rappels Essentiels
Cette section établit les conventions et les règles fondamentales pour la représentation des ouvrages en béton armé.
Représentation conventionnelle des armatures (HA, ronds lisses)
Pour comprendre un plan de ferraillage, il faut d’abord connaître les symboles. Ce point présente la nomenclature des aciers utilisés en RDC : les aciers à Haute Adhérence (HA) et les ronds lisses (RL). Il détaille la manière normalisée de les désigner sur un plan (par exemple, 3 HA 12 signifie trois barres à haute adhérence de 12 mm de diamètre) et de les représenter graphiquement (traits forts pour les barres principales, traits plus fins pour les cadres et étriers). La distinction entre ces types d’acier est cruciale car leurs propriétés mécaniques et leurs conditions d’utilisation sont différentes.
Façonnage et nomenclature des aciers selon BAEL adapté RDC
Un plan de ferraillage n’indique pas seulement la position des aciers, mais aussi leur forme. Cette section explique comment dessiner et coter les différentes formes de barres (droites, avec crosses d’ancrage, en U, etc.) et comment les répertorier dans une nomenclature (ou « bordereau d’aciers »). Cette nomenclature est un document essentiel pour l’atelier de ferraillage, car elle spécifie pour chaque « repère » (chaque type de barre) le diamètre, la forme, la longueur développée et la quantité. L’apprentissage se base sur les règles du BAEL (Béton Armé aux États Limites), qui reste la référence en RDC, en soulignant les adaptations pratiques locales.
Plans de coffrage : poutres, poteaux, dalles, voiles
Le plan de coffrage est le « négatif » de la structure en béton. Il représente la « boîte » en bois ou en métal dans laquelle le béton sera coulé. Cette section enseigne comment dessiner ces plans pour les éléments structurels de base : les poutres (vues en élévation et en coupe), les poteaux (vus en plan et en élévation), les dalles (vues en plan avec indication des épaisseurs et des niveaux) et les voiles (murs en béton). L’accent est mis sur la cotation précise des dimensions, qui déterminera la géométrie finale de l’ouvrage.
Chaînages horizontaux et verticaux (normes parasismiques Goma)
Les chaînages sont des ceintures en béton armé qui lient les murs et les planchers pour assurer la cohésion de la structure. Leur rôle est vital, en particulier dans les zones sismiques. Ce point détaille les règles de conception et de représentation des chaînages horizontaux (au niveau des planchers) et verticaux (dans les angles et les jonctions de murs). L’utilisation du contexte de Goma est ici une nécessité pédagogique. Les normes parasismiques imposent en effet des sections de béton et des quantités d’acier pour les chaînages qui sont beaucoup plus importantes que dans les zones non sismiques. L’élève apprend donc à dessiner les détails de ferraillage spécifiques (croisement des aciers dans les angles, densité des cadres) qui garantissent le comportement ductile du bâtiment en cas de tremblement de terre.
B. Exercices d’Application Directe
Ces exercices sont conçus pour développer la fluidité dans la lecture et la production de plans de béton armé.
Lecture de plans de ferraillage pour villa R+1 standard RDC
L’élève est mis en situation face à un jeu de plans de ferraillage typique pour une petite villa, comme on en construit partout en RDC. Il doit naviguer entre la vue en plan du plancher, les coupes sur les poutres et les détails des poteaux. Des questions précises guident sa lecture : « Quelle est la section d’aciers en travée et sur appuis de la poutre P2 ? Combien de cadres au mètre linéaire sont prévus dans la zone courante du poteau C1 ? Quel est le diamètre des aciers d’attente pour l’escalier ? ». Cet exercice développe la capacité à extraire rapidement des informations techniques précises d’un plan.
Calcul de métrés d’acier à partir de plans d’armatures
Cet exercice fait le lien entre le dessin et le chantier. À partir d’un plan de ferraillage d’un élément simple (une semelle de fondation ou une poutre), l’élève doit utiliser la nomenclature des aciers pour calculer la quantité totale d’acier nécessaire. Il doit calculer la longueur totale pour chaque diamètre d’acier, puis la convertir en poids (en utilisant la masse linéique de l’acier). Cet exercice est très concret et prépare à une tâche essentielle du métreur ou du préparateur de chantier : la commande des matériaux.
Dessin de détails : ancrages, recouvrements, épures de façonnage
La solidité d’une structure en béton armé réside dans ses détails. Cet exercice se concentre sur le dessin à grande échelle de points singuliers. L’élève doit dessiner, en respectant les règles de l’art, le recouvrement de deux barres pour assurer la continuité de l’effort, l’ancrage d’une poutre dans un poteau, ou encore l’épure de façonnage d’un cadre (le dessin « à plat » de la barre avant pliage). Ces détails sont cruciaux pour la sécurité et sont souvent des points d’attention lors de l’examen.
Représentation 3D de nœuds poteaux-poutres avec chaînages
Pour aider à la visualisation spatiale, cet exercice demande de passer du 2D au 3D. À partir des vues en plan et en coupe d’une jonction entre un poteau, des poutres et les chaînages, l’élève doit dessiner une perspective simple (isométrique ou cavalière) montrant l’enchevêtrement complexe des aciers dans cette zone. Cet exercice est particulièrement utile pour comprendre comment les différents aciers s’assemblent dans les nœuds structurels, un point souvent difficile à visualiser pour les débutants.
C. Problèmes de Synthèse
Ces projets complexes demandent de concevoir et de dessiner des solutions de ferraillage complètes et optimisées.
Conception complète du ferraillage d’un bâtiment parasismique à Goma
Ce projet de synthèse est un cas d’étude complet. L’élève reçoit les plans de coffrage d’un petit bâtiment à Goma, ainsi que les résultats d’un calcul de structure simplifié (qui lui donnent les sections d’acier théoriques à mettre en place). Sa mission est de produire les plans de ferraillage complets : choix des diamètres et du nombre de barres, dessin de leur disposition dans les poutres et poteaux, conception des cadres et étriers, et dessin de tous les détails de chaînage et de jonction conformément aux normes parasismiques. L’ancrage à Goma est ici non seulement pertinent mais indispensable, car il dicte toutes les règles de conception du ferraillage.
Optimisation de la disposition des armatures selon contraintes locales
Ce problème aborde une contrainte très pratique en RDC : la disponibilité des matériaux. Le scénario stipule que, pour un chantier à Kindu, seuls des aciers de diamètres 10, 12 et 14 mm sont disponibles. L’élève doit, à partir d’une section d’acier théorique requise (par exemple, 4,5 cm²), proposer une disposition de barres réaliste et constructible en utilisant uniquement les diamètres disponibles (par exemple, 4 HA 12, qui donnent 4,52 cm²). Il doit ensuite dessiner la section correspondante en s’assurant que les barres ne sont pas trop serrées pour permettre une bonne mise en place du béton. Cet exercice développe la capacité d’adaptation et de résolution de problèmes concrets.
Intégration des prescriptions anti-sismiques dans les détails constructifs
Ce problème se focalise sur les « règles de l’art » du ferraillage parasismique. L’élève reçoit des schémas de principe de jonctions poteau-poutre ou de chaînages et doit les transformer en dessins d’exécution détaillés. Il devra porter une attention particulière à la densité des cadres dans les zones critiques (près des appuis), à la forme des ancrages (crosses à 135° au lieu de 90° pour mieux confiner le béton), et à la continuité des armatures. C’est un exercice de précision qui vise à inculquer les bonnes pratiques pour la construction en zone à risque.
D. Items Type Examen
Ces questions sont formatées pour simuler les conditions de l’épreuve finale.
Vérification de conformité des plans d’armatures
Un plan de ferraillage contenant des erreurs de conception (non-respect des enrobages, longueurs de recouvrement insuffisantes, mauvais positionnement des aciers porteurs) est soumis à l’élève. Comme pour les normes de dessin, il doit identifier les non-conformités, les entourer sur le plan et expliquer en quoi elles contreviennent aux règles du BAEL ou aux règles parasismiques. Cet item évalue le sens critique et la connaissance des règlements techniques.
Correction d’erreurs de ferraillage et justification technique
Cet item va un peu plus loin que le précédent. Après avoir identifié une erreur (par exemple, un manque d’aciers supérieurs sur un appui de poutre continue), l’élève doit proposer et dessiner une solution de correction. Il doit également rédiger une courte note pour justifier sa correction d’un point de vue technique (« L’ajout de ces aciers est nécessaire pour reprendre le moment fléchissant négatif sur l’appui, qui met la fibre supérieure de la poutre en traction »). Cela teste non seulement la connaissance des règles, mais aussi la compréhension des principes de la résistance des matériaux qui les sous-tendent.
Chapitre 4 : Coupes et Détails Constructifs
Ce dernier chapitre de la première partie se concentre sur la représentation des éléments qui composent l’enveloppe du bâtiment et ses finitions. 
A. Rappels Essentiels
Cette section passe en revue les principes et techniques pour la conception de détails constructifs performants.
Techniques de représentation en coupe (verticale, horizontale)
Une coupe est une « tranche » du bâtiment qui révèle son organisation interne et la composition de ses parois. Ce point rappelle les conventions de représentation en coupe : le tracé du plan de coupe sur la vue en plan, l’orientation des flèches de vision, la différenciation par des hachures des différents matériaux coupés (béton, maçonnerie, isolant, bois), et la représentation en trait plus fin des éléments vus en arrière-plan. La maîtrise de la coupe est fondamentale pour expliquer une solution constructive.
Détails d’étanchéité adaptés au climat tropical humide
L’omniprésence de la pluie en RDC fait de l’étanchéité un enjeu majeur. Cette section présente les solutions techniques pour traiter les points faibles de l’enveloppe : les relevés d’étanchéité sur les toitures-terrasses, les raccordements entre la toiture et les murs, l’étanchéité des fondations et des murs enterrés pour lutter contre les remontées d’humidité, et les appuis de fenêtre avec « goutte d’eau » pour éloigner l’eau de la façade. Les schémas de principe montrent la superposition correcte des différentes couches (pare-vapeur, isolant, revêtement d’étanchéité).
Isolation thermique avec matériaux locaux
Bien que l’isolation contre le froid soit moins un enjeu, l’isolation contre la chaleur est cruciale pour le confort en climat équatorial. Ce point explore les principes de l’isolation thermique, notamment pour les toitures, qui sont la principale surface d’absorption de la chaleur solaire. Il présente les matériaux isolants conventionnels mais met aussi l’accent sur les solutions possibles avec des matériaux locaux ou biosourcés (fibre de bois, liège, ou même des techniques traditionnelles comme les toitures en paille épaisses), dans une perspective de construction durable et économique.
Détails de menuiseries et quincaillerie tropicalisée
Les portes et fenêtres sont des éléments clés de l’enveloppe. Cette section traite de leur mise en œuvre. Elle montre comment dessiner en coupe le raccordement d’un dormant de fenêtre avec la maçonnerie, en assurant à la fois l’étanchéité à l’air et à l’eau. Un point d’attention spécifique est porté sur le choix de la quincaillerie (paumelles, serrures, etc.) qui doit être « tropicalisée », c’est-à-dire traitée contre la corrosion qui est très agressive en climat humide.
B. Exercices d’Application Directe
Ces exercices pratiques permettent de s’entraîner au dessin de solutions techniques spécifiques.
Coupes de murs en pierre volcanique avec isolation
Cet exercice est directement lié au contexte constructif de l’Est de la RDC. L’élève doit dessiner une coupe verticale détaillée d’un mur extérieur en moellons de pierre volcanique. Le dessin doit montrer la composition complète du mur : la maçonnerie de pierre, une lame d’air ou un isolant intérieur (pour le confort thermique), un parement de finition (enduit ou plaques de plâtre) et les liaisons avec le plancher et la toiture. Cet exercice permet de valoriser un matériau local tout en l’intégrant dans une conception moderne et performante.
Détails d’évacuation d’eaux pluviales torrentielles (Kinshasa)
La violence des pluies à Kinshasa exige des systèmes d’évacuation surdimensionnés. L’élève doit concevoir et dessiner le détail d’une chéneau et d’une descente d’eau pluviale pour une grande toiture. Le dessin devra montrer la section du chéneau, sa pente, le positionnement de la naissance et le diamètre de la descente, en justifiant ces dimensions par un calcul simple de débit basé sur une intensité pluviométrique fournie. Le contexte de Kinshasa justifie la nécessité de concevoir des systèmes robustes et de grande capacité pour éviter les débordements et les infiltrations.
Représentation de toitures en tôles avec systèmes anti-cycloniques
Dans certaines régions de la RDC, notamment le Bas-Congo, les vents peuvent être très violents. Cet exercice porte sur la conception des fixations pour les toitures en tôle, qui sont très vulnérables à l’arrachement par le vent. L’élève doit dessiner en détail la fixation des tôles sur la charpente en bois ou en métal, en utilisant des tirefonds avec cavaliers et rondelles d’étanchéité, et en montrant comment renforcer la fixation sur les bords de la toiture (rives et faîtage), là où la prise au vent est la plus forte.
C. Problèmes de Synthèse
Ces problèmes demandent d’intégrer plusieurs détails techniques dans une conception cohérente.
Conception de détails pour construction mixte pierre/béton (Goma)
Ce projet de synthèse retourne dans le contexte de Goma pour aborder la construction mixte. L’élève doit concevoir et dessiner les détails de jonction clés entre les éléments en béton armé (poteaux, poutres, chaînages) et les remplissages en maçonnerie de pierre volcanique. Les dessins devront montrer comment assurer une bonne liaison mécanique entre les deux matériaux pour garantir un comportement monolithique en cas de séisme, et comment traiter l’étanchéité à l’interface entre la pierre (poreuse) et le béton (étanche).
Optimisation thermique et acoustique selon contraintes climatiques
Dans ce problème, l’élève doit proposer des détails constructifs pour améliorer la performance d’un bâtiment existant. Le scénario pourrait être une salle de classe à Mbandaka, surchauffée et bruyante pendant la saison des pluies. L’élève devra proposer et dessiner des solutions : ajout d’une sur-toiture ventilée pour réduire l’apport de chaleur, installation de brise-soleil devant les fenêtres, ou encore conception de faux-plafonds avec un matériau absorbant acoustique pour réduire la réverbération du bruit de la pluie sur la toiture en tôle.
D. Items Type Examen
Cette question finale prépare à l’épreuve en se concentrant sur la capacité à produire un dessin technique détaillé et correct.
Complétion de détails constructifs selon règles de l’art
L’élève reçoit un dessin de détail constructif incomplet (par exemple, un raccordement entre une toiture-terrasse et un mur). Il manque des éléments essentiels comme le relevé d’étanchéité, la protection en tête du relevé (solin), ou la goutte d’eau. La tâche de l’élève est de compléter le dessin en y ajoutant tous les éléments manquants, en les nommant et en les représentant correctement. Cet item évalue la connaissance des « règles de l’art », c’est-à-dire l’ensemble des bonnes pratiques qui garantissent la performance et la durabilité d’un ouvrage.



