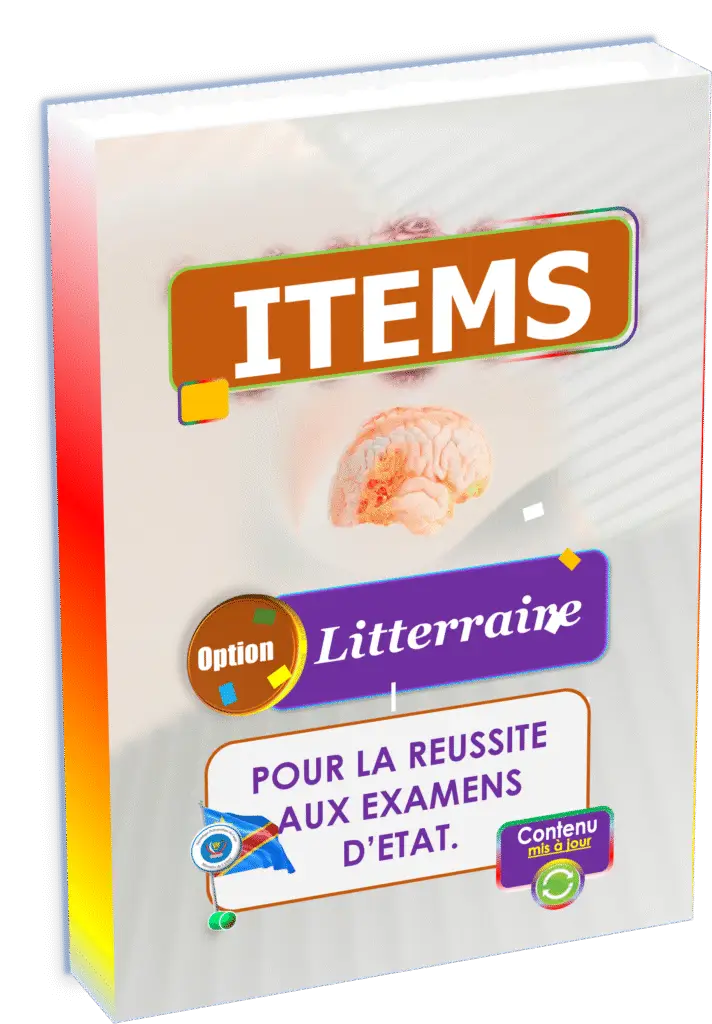
RECUEIL D’ITEMS, EXERCICES ET SITUATIONS D’INTEGRATION POUR L’OPTION HUMANITES LITTERAIRES (LATIN-PHILOSOPHIE)
Contenu mis à jour en 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC.
Pour la préparation à la réussite aux examens d’état
PARTIE I : PHILOSOPHIE GÉNÉRALE ET AFRICAINE
Cette première partie a pour vocation de structurer la pensée critique de l’élève. Elle établit les fondations méthodologiques du philosopher, parcourt les grands courants de l’histoire de la pensée, et ancre la réflexion dans les questionnements éthiques et politiques fondamentaux, en créant un dialogue constant entre les traditions universelles et les perspectives congolaises et africaines. L’objectif est de forger un esprit capable d’analyser, d’argumenter et de problématiser avec rigueur.
Chapitre 1 : Fondements et Méthodes Philosophiques
Ce chapitre inaugural outille l’élève avec les instruments essentiels de l’analyse philosophique. Il clarifie l’identité de la discipline, ses méthodes et ses champs d’application, en insistant sur la validité et la spécificité des traditions de pensée africaines comme corpus de savoirs à part entière.
A. Rappels Essentiels
🧠 Cette section consolide la maîtrise des concepts fondateurs. Elle articule avec précision la définition et l’objet de la philosophie pour en délimiter le champ d’investigation. La démarche expose les méthodes cardinales du philosopher : l’analyse conceptuelle, la critique des évidences et la synthèse des idées. Une clarification rigoureuse établit la distinction épistémologique entre le corpus philosophique occidental et la richesse des philosophies africaines, en insistant sur la validité de leurs paradigmes respectifs. L’accent est mis sur les spécificités de la pensée africaine traditionnelle, notamment le rôle structurant de l’oralité et la transmission de la sagesse au sein des cultures bantoues, illustrée par des exemples tirés des traditions Kongo et Luba.
B. Exercices d’Application
✍️ Les exercices de cette section visent la mise en pratique directe des méthodes étudiées. L’élève est conduit à réaliser l’analyse philosophique de proverbes congolais, par exemple un proverbe Tetela sur la communauté ou un adage Shi sur la justice, afin d’en extraire la portée universelle. Des études de cas concrets permettent d’explorer le concept d’Ubuntu comme philosophie communautaire appliquée, par exemple, dans la résolution de conflits locaux à Kananga. Des commentaires dirigés sur des textes philosophiques élémentaires de Platon ou de Meinrad Hebga initient à la lecture critique. Enfin, des exercices de définition conceptuelle (la liberté, la justice, le bonheur) entraînent à la précision et à la rigueur terminologique.
C. Sujets de Synthèse
🌐 Les sujets de synthèse exigent une réflexion plus large et la construction d’une argumentation personnelle structurée. La dissertation « La philosophie peut-elle être authentiquement africaine ? » pousse à dépasser le débat sur l’ethnophilosophie pour interroger les conditions d’universalité d’une pensée. Le sujet « Oralité versus écriture dans la transmission du savoir philosophique » invite à une analyse comparative des modes de conservation et de diffusion de la connaissance, en s’appuyant sur l’héritage des griots et la tradition manuscrite occidentale. « L’homme africain face aux défis de la modernité » est un sujet qui demande une analyse dialectique des tensions entre tradition et innovation dans le contexte congolais actuel.
D. Items Type Examen
🎯 Cette dernière section confronte l’élève aux formats d’évaluation de l’examen d’État. Elle propose des sujets de dissertation calibrés sur le modèle officiel, qui reprennent les thématiques du chapitre dans une formulation exigeante. Des questionnaires à choix multiples (QCM) permettent de vérifier l’assimilation précise des concepts fondamentaux et des distinctions opérées. Des analyses de citations de philosophes comme Tshiamalenga Ntumba ou Paulin Hountondji entraînent à identifier rapidement la thèse d’un auteur et son contexte argumentatif.
Chapitre 2 : Histoire de la Philosophie et Grands Courants
Ce chapitre propose un parcours chronologique et thématique des moments clés de l’histoire de la pensée. L’objectif est de donner à l’élève des repères solides pour situer les auteurs et les doctrines, et pour comprendre comment les idées dialoguent, s’opposent et évoluent à travers les époques et les cultures.
A. Rappels Essentiels
📚 Cette section offre une cartographie des grandes étapes de l’histoire de la philosophie. Elle synthétise les apports de la philosophie antique à travers les figures de Socrate, Platon et Aristote, en se concentrant sur leurs concepts centraux (maïeutique, allégorie de la caverne, syllogisme). La pensée médiévale est abordée sous l’angle de son dialogue avec la théologie chrétienne. La modernité philosophique est introduite par le rationalisme de Descartes, l’idéalisme critique de Kant et la dialectique de Hegel. La philosophie contemporaine est explorée à travers l’existentialisme et la phénoménologie. Un volet substantiel est consacré aux penseurs africains majeurs comme Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah et V.Y. Mudimbe, en présentant leurs contributions à la pensée de la décolonisation et à la critique épistémologique.
B. Exercices d’Application
🔍 Les exercices visent à créer des ponts entre les différentes traditions philosophiques. Des analyses comparées stimulent la réflexion, par exemple en mettant en parallèle la logique d’Aristote et les principes de la palabre africaine comme méthode de recherche de la vérité. L’étude de textes de Léopold Sédar Senghor permet de disséquer le concept de « négritude philosophique » et d’en évaluer la pertinence. Des commentaires dirigés sur des extraits de « L’Odeur du père » de V.Y. Mudimbe initient à la complexité de sa critique de la « gnose africaine » et de la construction du savoir sur l’Afrique.
C. Sujets de Synthèse
🌍 Ces sujets amènent l’élève à penser les interactions et les influences entre les courants de pensée. Une dissertation comme « La notion de progrès chez les philosophes des Lumières et sa réception en Afrique » demande une analyse critique de l’universalisme des Lumières et de son application dans le contexte colonial et postcolonial. Le sujet « Tradition et modernité dans la pensée africaine contemporaine » impose de structurer une réflexion sur les dynamiques de syncrétisme, de rupture et de continuité qui caractérisent la production intellectuelle en RDC et en Afrique.
D. Items Type Examen
✍️ Cette section aligne la préparation sur les exigences de l’épreuve finale. Elle contient des sujets de dissertation focalisés sur les grands courants (« Le rationalisme a-t-il encore un sens aujourd’hui ? ») ou sur des comparaisons (« Comparer la conception de l’État chez Platon et chez Rousseau »). Des commentaires de textes d’auteurs africains comme Marcien Towa ou Fabien Eboussi Boulaga sont proposés, calqués sur le format de l’examen pour entraîner à l’analyse rapide et pertinente.
Chapitre 3 : Anthropologie Philosophique et Éthique
Ce chapitre centre la réflexion sur la question de l’homme et de l’action morale. Il explore les grandes conceptions de la nature humaine, les fondements du jugement moral et les dilemmes éthiques contemporains, enracinant ces questions universelles dans la réalité socioculturelle congolaise.
A. Rappels Essentiels
👤 Cette section explore les concepts clés de l’anthropologie philosophique et de l’éthique. Elle définit la notion de nature humaine et le concept de dignité de la personne. Le débat classique entre liberté et déterminisme est exposé à travers ses principaux arguments. La distinction entre éthique et morale est clarifiée, menant à une analyse de l’opposition entre universalisme moral et relativisme culturel. Une attention particulière est portée aux valeurs cardinales des cultures africaines, telles que l’hospitalité, la solidarité (illustrée par le concept de « muziki » dans la région de Bandundu) et le respect des ancêtres. Enfin, des questions de bioéthique sont introduites, liées aux défis contemporains.
B. Exercices d’Application
🤔 Les exercices sont conçus pour appliquer les principes éthiques à des situations concrètes. Des analyses de dilemmes moraux tirés du contexte congolais sont proposées, par exemple un cas lié à la gestion des ressources naturelles dans une communauté du Lualaba, opposant éthique environnementale et impératifs de développement. Des études de cas examinent les tensions entre la médecine traditionnelle et l’éthique médicale moderne, notamment sur la question du consentement éclairé du patient. Des commentaires ciblés sur le concept d’éthique ubuntu permettent d’en comprendre les implications pratiques pour la cohésion sociale.
C. Sujets de Synthèse
🤝 Ces sujets demandent une réflexion approfondie et comparative. La dissertation « L’homme est-il naturellement bon ? Perspective africaine » invite à confronter la vision de Rousseau avec les cosmogonies bantoues qui postulent une harmonie originelle. « Éthique individuelle et éthique communautaire en Afrique » pousse à analyser la complémentarité et les possibles conflits entre les droits de la personne et les impératifs du groupe, un enjeu central dans les sociétés congolaises contemporaines.
D. Items Type Examen
⚖️ Cette section prépare spécifiquement à l’évaluation certificative. Elle contient des sujets de dissertation sur les grandes questions anthropologiques (« La conscience fait-elle la grandeur de l’homme ? »). Elle propose également des analyses de situations éthiques concrètes, où l’élève doit identifier les enjeux, mobiliser des concepts pertinents (utilitarisme, déontologisme, éthique de la discussion) et proposer une argumentation justifiée, simulant ainsi les questions complexes de l’examen.
Chapitre 4 : Philosophie Politique et Sociale
Ce chapitre aborde les questions relatives à la vie en commun, au pouvoir et à la justice. Il présente les théories fondamentales du contrat social, de l’État et de la démocratie, tout en les mettant en perspective avec les structures politiques traditionnelles africaines et les défis de la gouvernance moderne en RDC.
A. Rappels Essentiels
🏛️ Cette section synthétise les concepts fondamentaux de la philosophie politique. Elle expose les théories classiques du pouvoir de Machiavel, Hobbes et Rousseau, en clarifiant leurs divergences sur l’origine et la légitimité de l’autorité. Les concepts de démocratie, de gouvernance, d’État de droit et de justice sociale sont définis avec précision. Un volet important est dédié à la philosophie politique africaine, en analysant la structure et les principes de la chefferie traditionnelle comme modèle de régulation sociale. La thématique de la réconciliation et du pardon est abordée à travers la pensée de Paul Ricœur, en montrant sa pertinence pour penser la sortie des conflits, notamment dans les Kivu.
B. Exercices d’Application
🎤 Les exercices ancrent la théorie dans la pratique politique et sociale. Des analyses du discours politique congolais contemporain sont proposées, où l’élève doit repérer les stratégies rhétoriques et les soubassements idéologiques. Des études comparatives mettent en balance les modèles de la démocratie représentative occidentale et les mécanismes de décision des conseils d’anciens, comme on en trouve dans le Kasaï. Des commentaires de textes sur la justice réparatrice permettent de saisir les alternatives à la justice punitive dans des contextes post-conflit.
C. Sujets de Synthèse
🗳️ Les sujets de synthèse exigent une réflexion critique sur des enjeux politiques majeurs. La dissertation « Le pouvoir corrompt-il nécessairement ? Leçons africaines » demande à l’élève de discuter la célèbre formule de Lord Acton à la lumière d’exemples tirés de l’histoire politique africaine, en mobilisant des auteurs comme Achille Mbembe. Le sujet « Réconciliation nationale et philosophie du pardon en RDC » impose de construire une argumentation sur les conditions philosophiques, politiques et sociales nécessaires à la reconstruction du lien social après des traumatismes collectifs.
D. Items Type Examen
📑 Cette section prépare directement aux types de questions posées à l’examen d’État. Elle inclut des sujets de dissertation sur les théories politiques (« La loi est-elle un obstacle à la liberté ? »). Elle propose aussi des analyses de situations politiques concrètes, par exemple un scénario fictif de crise institutionnelle, où l’élève doit mobiliser les concepts de légalité, de légitimité et de souveraineté pour proposer une analyse argumentée.
PARTIE II : LITTÉRATURE FRANÇAISE, FRANCOPHONE ET CONGOLAISE
Cette deuxième partie vise à développer la culture littéraire et les compétences d’analyse textuelle de l’élève. Elle couvre les grands mouvements et auteurs des littératures française, francophone africaine et spécifiquement congolaise, tout en fournissant les outils méthodologiques indispensables pour aborder le commentaire composé et la dissertation littéraire.
Chapitre 5 : Littérature Française Classique et Moderne
Ce chapitre établit le socle de la culture littéraire en présentant les œuvres, les auteurs et les mouvements qui ont façonné la littérature d’expression française. L’objectif est de permettre à l’élève de maîtriser les références canoniques et de comprendre les évolutions esthétiques.
A. Rappels Essentiels
📜 Cette section dresse un panorama des grands jalons de la littérature française. Elle synthétise les caractéristiques des principaux mouvements littéraires (Humanisme, Classicisme, Lumières, Romantisme, Symbolisme). Les auteurs incontournables comme Molière, Racine, Voltaire, Hugo et Baudelaire sont présentés à travers leurs œuvres majeures et leurs apports esthétiques. Les spécificités des grands genres littéraires (théâtre, poésie, roman) sont rappelées, ainsi que l’évolution de leurs formes et de leurs thèmes au fil des siècles.
B. Exercices d’Application
🖋️ Les exercices pratiques permettent de s’approprier les œuvres. Des analyses stylistiques guidées sur des extraits de textes classiques (une tirade de Corneille, une description de Balzac) affûtent le regard de l’élève. Des études comparées sur l’universalité de thèmes comme l’amour, la mort ou l’injustice, chez des auteurs d’époques différentes, développent la capacité à tisser des liens. Des commentaires littéraires sont proposés avec des plans détaillés pour entraîner à la structuration de l’analyse.
C. Sujets de Synthèse
↔️ Ces sujets invitent à des réflexions transversales et comparatistes. La dissertation « La critique sociale chez Molière et Sony Labou Tansi » pousse à comparer les stratégies de dénonciation du pouvoir et des mœurs à deux époques et dans deux contextes culturels distincts, révélant des convergences inattendues. Le sujet « Universalité et particularisme dans la littérature française » demande de réfléchir à la manière dont des œuvres ancrées dans un contexte spécifique peuvent atteindre une portée universelle.
D. Items Type Examen
📄 Cette section prépare aux épreuves écrites de français. Elle propose des sujets de commentaires composés sur des textes classiques et modernes, conformes aux attentes de l’examen. Des sujets de dissertations littéraires générales (« Le personnage de roman doit-il nécessairement être un héros ? ») permettent de s’entraîner à mobiliser sa culture littéraire pour construire une argumentation personnelle.
Chapitre 6 : Littérature Francophone Africaine
Ce chapitre explore la richesse et la diversité des littératures africaines d’expression française. Il s’agit de familiariser l’élève avec les auteurs, les thèmes et les enjeux qui caractérisent ce champ littéraire, de la Négritude aux écritures les plus contemporaines.
A. Rappels Essentiels
🌍 Cette section cartographie le champ littéraire francophone africain. Elle présente le mouvement de la Négritude à travers ses trois figures tutélaires : Senghor, Césaire et Damas. L’évolution du roman africain post-colonial est retracée, en abordant les thèmes de la désillusion, de la critique des nouveaux pouvoirs et de la quête d’identité. Le théâtre et la poésie africains contemporains sont également explorés, en mettant en lumière leur vitalité et leur inventivité formelle. Un point d’attention est porté à l’émergence des voix féminines (Mariama Bâ, Calixthe Beyala) et à leur contribution spécifique.
B. Exercices d’Application
✍️ Les exercices sont centrés sur l’analyse des spécificités de ces littératures. Des analyses thématiques sont menées sur des corpus de textes traitant de l’identité, de la colonisation ou de l’indépendance. Des études stylistiques permettent de repérer les marques de l’oralité dans l’écrit, une caractéristique majeure de nombreux auteurs. Des commentaires dirigés sur des textes représentatifs (un extrait d’une œuvre d’Ahmadou Kourouma, un poème de Tchicaya U Tam’si) guident l’élève dans l’interprétation.
C. Sujets de Synthèse
🗣️ Les sujets de synthèse engagent une réflexion sur les enjeux profonds de la littérature africaine. La dissertation « Littérature africaine et quête d’identité » amène à analyser comment l’écriture devient un lieu de construction et de revendication identitaire face à l’histoire. Le sujet « Langue française et expression de l’africanité » pousse à explorer le paradoxe de l’usage de la langue de l’ancien colon pour exprimer des réalités culturelles et des visions du monde propres à l’Afrique, en s’appuyant sur le concept de « langue prise en otage ».
D. Items Type Examen
📝 Cette section cible la préparation à l’examen. Elle propose des commentaires composés sur des textes d’auteurs africains non congolais, souvent présents dans les sujets d’examen. Elle inclut également des sujets de dissertation portant sur les thèmes majeurs de cette littérature, comme « Le rôle de l’écrivain dans la société africaine post-indépendance ».
Chapitre 7 : Littérature Congolaise
Ce chapitre est dédié au patrimoine littéraire national. Il vise à donner aux élèves une connaissance approfondie des auteurs, des œuvres et des courants qui constituent la littérature de la République Démocratique du Congo, en soulignant son originalité et sa contribution au champ littéraire mondial.
A. Rappels Essentiels
🇨🇩 Cette section retrace l’histoire de la littérature congolaise. Elle présente les pionniers comme Paul Lomami-Tshibamba et Antoine-Roger Bolamba. Une place centrale est accordée à Sony Labou Tansi, analysé comme une figure révolutionnaire qui a dynamité la langue et les formes romanesques et théâtrales. Le théâtre congolais contemporain, dans sa diversité, est également étudié. La nouvelle génération d’écrivains, incarnée par Fiston Mwanza Mujila ou Sinzo Aanza, est introduite pour montrer la vitalité actuelle de la scène littéraire. Un regard est également porté sur la littérature en langues nationales (lingala, swahili, etc.) et ses enjeux.
B. Exercices d’Application
📖 Les exercices permettent une immersion dans les œuvres congolaises. Une analyse approfondie de « La Vie et demie » de Sony Labou Tansi sert de cas d’école pour comprendre sa poétique de la violence et du merveilleux. L’étude du concept de « baroque africain » est appliquée à son style pour en saisir toute la complexité. Des commentaires de textes d’auteurs congolais contemporains entraînent à analyser des écritures plus récentes, comme celle qui dépeint le chaos urbain de Kinshasa ou de Lubumbashi.
C. Sujets de Synthèse
💡 Ces sujets poussent à une réflexion critique sur les spécificités de la littérature nationale. La dissertation « Sony Labou Tansi, héritier de Rabelais en Afrique » invite à une comparaison audacieuse pour mettre en lumière l’universalité de son projet littéraire. Le sujet « Tradition orale et écriture moderne en RDC » amène à analyser comment les conteurs et les poètes contemporains intègrent et transforment l’héritage des épopées orales Mbochi ou Mongo.
D. Items Type Examen
🏆 Cette section prépare aux questions spécifiques sur la littérature nationale à l’examen d’État. Elle propose des analyses d’œuvres complètes d’auteurs congolais, exercice souvent demandé. Des sujets de dissertations sur la spécificité de la littérature congolaise (« Peut-on parler d’une ‘école de Kinshasa’ en littérature ? ») sont également fournis pour préparer aux questions les plus pointues.
Chapitre 8 : Techniques d’Analyse Littéraire
Ce chapitre est une boîte à outils méthodologique. Il a pour but de doter l’élève de toutes les compétences techniques nécessaires pour analyser un texte littéraire de manière rigoureuse et pertinente, quel que soit son genre ou son époque.
A. Rappels Essentiels
🛠️ Cette section expose de manière systématique les outils de l’analyse littéraire. Les différentes méthodes (structuralisme, analyse thématique, stylistique) sont présentées et illustrées. Un inventaire détaillé des figures de style et des procédés rhétoriques est fourni, avec des exemples clairs pour chacun. Les notions de genres et de registres littéraires sont définies et mises en relation. Les bases de la narratologie (focalisation, statut du narrateur, structure du récit) et de la versification (mètre, rime, rythme) sont solidement établies.
B. Exercices d’Application
🔬 Les exercices sont progressifs et visent la maîtrise technique. Des analyses stylistiques sur des textes courts permettent de s’entraîner à repérer et interpréter les procédés. Des exercices systématiques de reconnaissance des figures de style, des registres ou des types de focalisation consolident les connaissances. Ces applications pratiques sont menées sur un corpus de textes très varié, allant de la poésie classique au roman contemporain.
C. Sujets de Synthèse
📊 Ces sujets demandent de mobiliser les outils d’analyse dans une perspective plus large. Des analyses comparatives de styles d’auteurs ou d’époques différentes (par exemple, le style de Flaubert face à celui de Céline) sont proposées. Des synthèses méthodologiques demandent à l’élève d’expliquer, par exemple, comment mener une analyse de la dimension polyphonique d’un texte.
D. Items Type Examen
🔖 Cette section contient des exercices calibrés sur les attentes de l’examen en matière de technicité. Il peut s’agir de questions précises sur un texte (« Identifiez et analysez la valeur des temps verbaux dans ce paragraphe ») ou d’exercices d’application directe des techniques d’analyse sur un passage donné, préparant ainsi aux questions qui accompagnent souvent le commentaire composé.
PARTIE III : LANGUE ET CIVILISATION LATINES
Cette troisième partie constitue un pilier de l’option, visant à donner à l’élève une maîtrise solide de la langue latine et une connaissance approfondie de la civilisation romaine. L’objectif est double : développer la rigueur logique à travers l’étude de la grammaire et enrichir la culture humaniste par l’accès direct aux grands textes fondateurs de la pensée occidentale.
Chapitre 9 : Grammaire Latine Approfondie
Ce chapitre a pour objectif de consolider et d’approfondir la maîtrise des structures de la langue latine. Une connaissance grammaticale précise est le prérequis indispensable pour aborder la traduction (version) avec assurance et exactitude.
A. Rappels Essentiels
🏛️ Cette section est une révision systématique et exhaustive des fondamentaux de la grammaire latine. La morphologie nominale et verbale (déclinaisons, conjugaisons régulières et irrégulières) est présentée sous forme de tableaux synoptiques. La syntaxe des cas et des propositions (notamment les propositions subordonnées complétives, circonstancielles et relatives) est expliquée en détail, avec un accent sur les constructions complexes. Un vocabulaire thématique essentiel (politique, guerre, vie quotidienne) est fourni. Des points sur l’étymologie et la dérivation montrent comment le latin a façonné le français.
B. Exercices d’Application
✍️ L’entraînement est la clé de cette section. Des séries d’exercices systématiques de déclinaison et de conjugaison permettent d’automatiser les réflexes. Des analyses grammaticales progressives sur des phrases de plus en plus complexes développent la capacité à décomposer la structure logique d’un énoncé latin. Des exercices spécifiques sont consacrés aux constructions syntaxiques difficiles (ablatif absolu, proposition infinitive). Des études étymologiques demandent de retrouver la racine latine de mots français complexes.
C. Sujets de Synthèse
🔗 Ces sujets visent à intégrer les différents aspects de la grammaire. Des synthèses grammaticales thématiques (par exemple, « Les différentes manières d’exprimer le but en latin ») obligent l’élève à organiser ses connaissances. Des analyses comparées entre des structures syntaxiques latines et leurs équivalents dans les langues modernes (français, anglais) favorisent une compréhension plus profonde des systèmes linguistiques.
D. Items Type Examen
🎯 Cette section propose des questions grammaticales formulées sur le modèle de celles de l’examen d’État. Il peut s’agir d’identifier la fonction d’un mot, de justifier l’emploi d’un cas ou d’un mode, ou de transformer une structure de phrase. Des QCM de révision rapide permettent de balayer l’ensemble du programme grammatical avant l’épreuve.
Chapitre 10 : Textes et Auteurs Latins
Ce chapitre met l’élève au contact direct des grandes œuvres de la latinité. L’objectif est de passer de la connaissance de la langue à la compréhension de la littérature, de l’histoire et de la pensée romaines, à travers l’étude des auteurs majeurs du programme.
A. Rappels Essentiels
📜 Cette section présente les auteurs et œuvres incontournables. Cicéron est abordé à travers son plaidoyer « Pro Archia Poeta », comme modèle de l’éloquence et de la défense des humanités. Salluste et son « De Conjuratione Catilinae » servent d’exemple pour l’écriture de l’histoire et l’analyse politique. Les « Commentarii de Bello Gallico » de César sont étudiés pour leur style sobre et leur intérêt stratégique. L' »Énéide » de Virgile est présentée comme l’épopée fondatrice de Rome, et les « Métamorphoses » d’Ovide comme un chef-d’œuvre de la poésie mythologique.
B. Exercices d’Application
📖 Le cœur de cette section est la pratique de la version latine. Des textes des auteurs étudiés sont proposés avec une difficulté graduée, accompagnés de notes de vocabulaire et de points de grammaire. Au-delà de la traduction, des exercices d’analyse littéraire (étude du style, des images), thématique, philosophique et historique sont proposés pour chaque texte, afin d’en exploiter toute la richesse.
C. Sujets de Synthèse
🏛️ Ces sujets invitent à une prise de recul sur le corpus. Des synthèses sur un auteur (par exemple, « Qu’est-ce qui caractérise le style de César ? ») demandent de rassembler les observations faites au fil des textes. Des études comparatives (« Comparer la vision du pouvoir chez Cicéron et Salluste ») développent l’esprit critique et la capacité à mettre en relation les œuvres.
D. Items Type Examen
📄 Cette section est une préparation intensive à l’épreuve de version latine de l’examen d’État. Elle propose une série de textes d’annales ou de difficulté équivalente, principalement tirés de Cicéron, Salluste et César. Des questions de civilisation, en lien direct avec le contenu des textes à traduire, sont également ajoutées pour simuler les conditions réelles de l’épreuve.
Chapitre 11 : Civilisation Romaine
Ce chapitre a pour but de fournir le contexte culturel, politique et social indispensable à la compréhension des textes latins. Il offre une immersion dans le monde romain pour que les œuvres étudiées ne soient pas des objets linguistiques désincarnés, mais les témoins d’une civilisation fascinante.
A. Rappels Essentiels
🏟️ Cette section brosse un tableau complet de la civilisation romaine. Elle décrit les institutions politiques de la République puis de l’Empire. La structure de la société, avec ses classes sociales (patriciens, plébéiens, esclaves), est expliquée. La religion polythéiste et la mythologie gréco-romaine sont présentées. L’art et l’architecture sont abordés à travers leurs réalisations emblématiques (Colisée, aqueducs). Enfin, un point est fait sur l’héritage immense de Rome dans le monde moderne (droit, langue, architecture).
B. Exercices d’Application
🗺️ Les exercices visent à rendre la civilisation romaine concrète. Des études de documents historiques (inscriptions, extraits de lois) permettent de toucher du doigt la réalité de l’époque. Des analyses d’œuvres d’art (sculptures, mosaïques) développent le sens de l’observation. Des recherches guidées sur l’héritage romain dans les villes congolaises (par exemple, l’influence de l’urbanisme romain sur les plans des villes coloniales) créent des ponts avec le présent. Des comparaisons audacieuses entre des aspects de la civilisation romaine et des traditions africaines (par exemple, le culte des ancêtres) stimulent la réflexion interculturelle.
C. Sujets de Synthèse
🏛️ Les sujets de synthèse demandent de mettre en perspective les connaissances acquises. Des dissertations sur des thèmes civilisationnels (« Le citoyen romain : droits et devoirs ») sont proposées. Des réflexions sur l’héritage antique (« En quoi sommes-nous encore des Romains ? ») invitent à une appropriation personnelle de cette culture.
D. Items Type Examen
📜 Cette section prépare aux questions de civilisation qui peuvent apparaître à l’examen. Il s’agit de questions de connaissance précises sur les institutions, l’histoire ou la vie quotidienne. Des études de cas historiques (par exemple, « Analysez les causes de la chute de la République romaine ») entraînent à mobiliser ses connaissances pour construire un raisonnement historique.
PARTIE IV : MÉTHODOLOGIE DE LA DISSERTATION ET DU COMMENTAIRE
Cette quatrième partie est purement méthodologique. Elle est conçue comme un guide pratique et détaillé pour maîtriser les deux exercices académiques fondamentaux de l’option littéraire : la dissertation philosophique et le commentaire littéraire. L’excellence formelle est un objectif central pour la réussite à l’examen d’État.
Chapitre 12 : Technique de la Dissertation Philosophique
Ce chapitre décompose chaque étape de la construction de la dissertation philosophique, de l’analyse du sujet à la rédaction finale. L’objectif est de transformer un exercice souvent redouté en une démarche logique et maîtrisée.
A. Rappels Essentiels
✒️ Cette section expose la structure canonique de la dissertation. L’introduction (amorce, analyse du sujet, problématique, annonce du plan), le développement (thèse, antithèse, synthèse) et la conclusion (bilan, réponse à la problématique, ouverture) sont détaillés pas à pas. Un accent particulier est mis sur l’art de la problématisation et sur la construction d’un plan dialectique rigoureux. Les techniques d’argumentation (utilisation d’exemples, de citations, de connecteurs logiques) sont expliquées pour assurer la solidité du raisonnement.
B. Exercices d’Application
✍️ La pratique est au cœur de cette section. Des exercices d’analyse de sujets variés permettent de s’entraîner à identifier les notions clés et les présupposés. Des ateliers de construction de plans détaillés sur des sujets types sont proposés. Des exercices ciblés sur la rédaction d’introductions et de conclusions efficaces sont inclus. Des paragraphes argumentatifs sont à construire sur des thèses données pour travailler la qualité de l’argumentation.
C. Sujets de Synthèse
📑 Cette section propose un accompagnement complet. Des dissertations entièrement rédigées sur des sujets classiques servent de modèles. Des corrigés très détaillés montrent non seulement le contenu attendu, mais aussi la démarche de construction, les articulations logiques et les choix stylistiques.
D. Items Type Examen
🎯 Cette section met l’élève en situation d’examen. Elle propose une liste de sujets de dissertation tombés les années précédentes ou de formulation similaire. Les barèmes et critères d’évaluation officiels sont expliqués pour que l’élève comprenne précisément ce qui est attendu de lui en termes de réflexion, de culture, d’argumentation et de maîtrise de la langue.
Chapitre 13 : Technique du Commentaire Littéraire
Ce chapitre fournit une méthode claire et efficace pour réussir le commentaire composé (ou littéraire). Il s’agit de guider l’élève de la lecture analytique du texte à l’organisation structurée de ses remarques.
A. Rappels Essentiels
📖 Cette section détaille la méthodologie du commentaire. Elle explique la différence entre le plan thématique et le plan linéaire, et indique dans quels cas privilégier l’un ou l’autre. La structure (introduction, développement, conclusion) est déclinée pour cet exercice spécifique, avec un focus sur la formulation du projet de lecture. La technique de la citation et de l’analyse textuelle précise (identifier un procédé et l’interpréter) est au centre de la démarche.
B. Exercices d’Application
🔍 Les exercices sont progressifs. Des analyses de textes courts permettent de s’exercer à repérer les axes de lecture possibles. Des ateliers de construction de plans de commentaire sur des textes variés (poésie, théâtre, roman) sont proposés. Des exercices spécifiques sur l’intégration harmonieuse des citations et leur analyse détaillée affinent la technique rédactionnelle. La rédaction de paragraphes de commentaire ou de développements partiels permet de se concentrer sur la qualité de l’analyse.
C. Sujets de Synthèse
📚 Cette section offre des exemples aboutis. Des commentaires entièrement rédigés sur des textes de genres différents servent de modèles concrets. Des corrigés très détaillés justifient le plan choisi, expliquent l’interprétation des procédés stylistiques et commentent la qualité de la rédaction, offrant un véritable guide pour l’auto-correction.
D. Items Type Examen
📄 Cette section prépare directement à l’épreuve. Elle contient une sélection de textes (poèmes, extraits de roman ou de théâtre) du type de ceux proposés à l’examen d’État. Des grilles d’évaluation détaillées, inspirées des critères officiels, sont fournies pour permettre à l’élève et à l’enseignant d’évaluer les productions de manière objective.
Chapitre 14 : Expression Écrite et Orale
Ce chapitre transversal a pour objectif le perfectionnement de la maîtrise de la langue française, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. Il s’agit d’un enjeu crucial non seulement pour l’examen, mais pour la poursuite d’études supérieures et la vie citoyenne.
A. Rappels Essentiels
🗣️ Cette section revient sur les fondamentaux d’une expression de qualité. Elle insiste sur la correction de la langue (orthographe, grammaire, syntaxe) et la richesse du vocabulaire. Les principales techniques rhétoriques de la persuasion sont rappelées. Un point est fait sur l’importance d’adapter son registre de langue au contexte (soutenu, courant). Les bases de l’argumentation orale et de la prise de parole en public (débat) sont également posées.
B. Exercices d’Application
✍️ Les exercices sont variés et pratiques. Des exercices de réécriture et d’amélioration de phrases mal formulées développent la conscience stylistique. Les techniques d’argumentation sont appliquées à des sujets de débat concrets. Des fiches guident la préparation d’exposés oraux structurés. Des simulations de débats philosophiques sur des thèmes du programme entraînent à la répartie et à la clarté de l’expression orale.
C. Sujets de Synthèse
📈 Cette section vise l’autonomie. Des synthèses méthodologiques récapitulent les « bonnes pratiques » de l’expression écrite et orale. Des exercices d’auto-évaluation, avec des grilles de critères, permettent à l’élève de juger la qualité de ses propres productions et d’identifier ses points faibles.
D. Items Type Examen
🎤 Bien que l’oral soit moins présent à l’examen d’État, cette section prépare à toute forme d’évaluation de l’expression. Elle propose des exercices d’expression écrite calibrés sur les exigences de clarté et de correction de l’examen. Elle fournit également les critères d’évaluation qui seraient utilisés pour un grand oral, préparant ainsi les élèves aux exigences de l’enseignement supérieur.
PARTIE V : SITUATIONS D’INTÉGRATION COMPLEXES
Cette cinquième partie constitue le cœur stratégique du recueil. Elle a pour objectif de briser les cloisons entre les disciplines en proposant des sujets transversaux qui forcent l’élève à mobiliser simultanément ses compétences en philosophie, en littérature et en latin. C’est la préparation ultime à la résolution de problèmes complexes.
Chapitre 15 : Sujets Transversaux Philosophie-Littérature
Ce chapitre propose des sujets de dissertation qui exigent un dialogue fécond entre une œuvre ou un courant littéraire et des concepts philosophiques. L’élève doit démontrer sa capacité à utiliser la littérature comme matière à penser et la philosophie comme outil d’analyse littéraire.
Sujets Proposés
💡 Chaque sujet est une invitation à une réflexion de haut niveau. Par exemple, « La figure du tyran chez Tacite et dans le théâtre de Sony Labou Tansi : analyse croisée littéraire et philosophique » demande de mobiliser des concepts de philosophie politique (tyrannie, légitimité, résistance) pour analyser deux représentations littéraires du pouvoir absolu. « L’existentialisme de Sartre face aux expériences de résilience dans l’est de la RDC » exige d’appliquer des concepts sartriens (liberté, situation, projet) à l’analyse de témoignages ou d’œuvres de fiction inspirées par les réalités des Kivu. « Poésie de la négritude et philosophie de l’identité : Senghor penseur » traite le texte poétique comme un véritable discours philosophique sur l’être et la culture.
Chapitre 16 : Sujets Transversaux Latin-Philosophie-Littérature
Ce chapitre pousse la logique d’intégration à son paroxysme. Les sujets proposés exigent de puiser dans les trois disciplines fondamentales de l’option pour construire une argumentation riche et multidimensionnelle. La maîtrise de la version latine devient ici un atout pour accéder à la source des textes.
Sujets Proposés
🔗 Ces sujets sont conçus pour révéler la cohérence profonde de la formation humaniste. « Stoïcisme antique et sagesse africaine : Sénèque et les proverbes bantous » demande une analyse comparative des éthiques de la maîtrise de soi et de l’acceptation du destin dans deux contextes culturels très différents. « L’art oratoire de Cicéron et la palabre traditionnelle africaine : étude comparative » met en parallèle deux arts de la parole, l’un codifié par la rhétorique classique, l’autre par la tradition. « L’héroïsme épique : de l’Énéide aux épopées orales congolaises » compare les figures héroïques et les valeurs qu’elles incarnent, d’Enée au héros de l’épopée Mvet, par exemple.
PARTIE VI : ÉPREUVES BLANCHES COMPLÈTES
Cette dernière partie est une mise en situation réelle. Elle propose deux sujets complets d’examen d’État, conçus pour être réalisés dans les conditions de temps et d’exigence de l’épreuve officielle. C’est l’ultime étape de la préparation, permettant de tester ses connaissances, sa méthodologie et sa gestion du stress.
Épreuve Blanche N°1 : Simulation Complète Examen d’État
Cette première épreuve est conçue sur le modèle « classique » de l’examen, en se basant sur les types de sujets les plus fréquents des années passées. Elle permet une révision sécurisante et une évaluation fiable du niveau de l’élève.
Contenu de l’épreuve
⏱️ L’épreuve comprend : une dissertation philosophique (avec trois sujets au choix, portant sur la morale, la politique et l’épistémologie), un commentaire littéraire sur un texte d’un auteur majeur de la littérature francophone africaine, une version latine extraite du « Pro Archia » de Cicéron, et des questions de culture générale et de civilisation. Chaque partie est accompagnée de corrigés extrêmement détaillés et du barème officiel pour une auto-évaluation précise.
Épreuve Blanche N°2 : Simulation Complète Examen d’État
Cette seconde épreuve est un modèle « prospectif ». Elle est conçue en anticipant les évolutions possibles de l’examen, avec des sujets peut-être plus transversaux ou portant sur des auteurs plus contemporains. Elle vise à préparer l’élève à toute éventualité.
Contenu de l’épreuve
🚀 L’épreuve propose : une dissertation philosophique avec des sujets plus originaux, un commentaire littéraire sur un texte d’un auteur congolais contemporain, une version latine de Salluste (style plus ardu que Cicéron), et des questions d’intégration demandant de faire des liens entre les disciplines. Les corrigés détaillés insistent sur les conseils méthodologiques pour aborder des sujets inattendus et démontrer son agilité intellectuelle.



